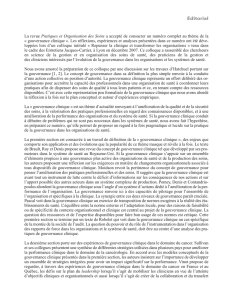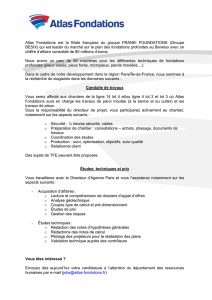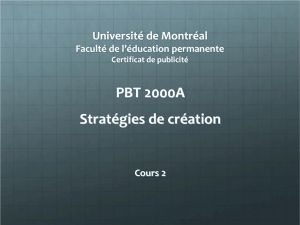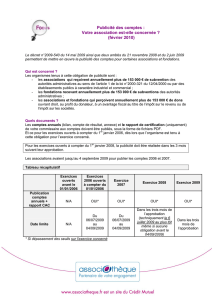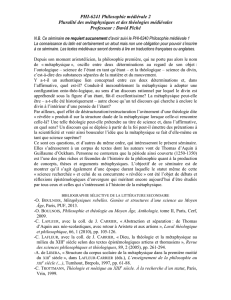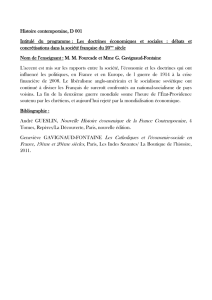Untitled - Presses des Mines


A. David, A. Hatchuel, R. Laufer, Les Nouvelles Fondations des sciences de gestion, Paris : Presses des
MINES, collection Economie et gestion, 2012.
© Presses des MINES - TRANSVALOR, 2012
60, boulevard Saint-Michel - 75272 Paris Cedex 06 - France
email : [email protected]
www.pressesdesmines.com
© Photo de couverture : Centre Energétique et Procédés MINES ParisTech, calculs effectués sur
les plates-formes Salomé (CEA, EdF, OpenCASCADE) et Code Saturne (EdF).
ISBN : 978-2-911256-90-5
Dépôt légal : 2012
Achevé d’imprimer en 2012 (Paris)
Tous droits de reproduction, de traduction, d’adaptation et d’exécution réservés pour tous les pays.

Les Nouvelles Fondations
des sciences de gestion

Collection Économie et Gestion
Dans la même collection :
TIC ET INNOVATION
ORGANISATIONNELLE
Pierre-Michel Riccio, Daniel Bonnet
ENTRE COMMUNAUTÉS ET MOBILITÉ :
UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE
DES MÉDIAS
Ouvrage coordonné par Serge Agostinelli,
Dominique Augey, Frédéric Laurie
FRAGILES COMPÉTENCES
Sophie Brétécher, Cathy Krohmer
CONSTRUIRE LA BIODIVERSITÉ
Julie Labatut
L’ACTIVITÉ MARCHANDE SANS LE
MARCHÉ ?
Armand Hatchuel, Olivier Favereau,
Franck Aggeri (sous la direction de)
MANAGEMENT DES TECHNOLOGIES
ORGANISATIONNELLES
Pierre-Michel Riccio, Daniel Bonnet
L’ÉVALUATION DES CHERCHEURS
Daniel Fixari, Jean-Claude Moisdon,
Frédérique Pallez
SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET FACTEURS
HUMAINS
Grégory Rolina
PROCEEDINGS OF THE THIRD
RESILIENCE ENGINEERING
SYMPOSIUM
Erik Hollnagel, François Pieri,
Eric Rigaud (editors)
PROCEEDINGS OF THE SECOND
RESILIENCE ENGINEERING
SYMPOSIUM
Erik Hollnagel, Eric Rigaud (editors)
MODEM LE MAUDIT
Olivier Bomsel, Anne-Gaëlle Geffroy,
Gilles Le Blanc
ÉVALUATION DES COÛTS
Claude Riveline
LE LEADERSHIP DANS LES
ORGANISATIONS
James G. March, Thierry Weil
DERNIER TANGO ARGENTIQUE
Olivier Bomsel, Gilles Le Blanc
LES NOUVEAUX CIRCUITS
DU COMMERCE MONDIAL
François Huwart, Bertrand Collomb
INVITATION À LA LECTURE
DE JAMES MARCH
Thierry Weil
NEW NEIGHBOURS IN EASTERN
EUROPE
Economic and Industrial Reform in
Lithuania, Latvia and Estonia

Les Nouvelles Fondations
des sciences de gestion
Eléments d’épistémologie de la recherche
en management
Coordonné par
Albert David
Armand Hatchuel
Romain Laufer
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%