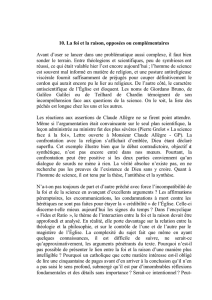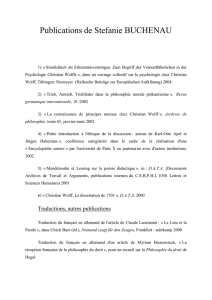Avenir: Mode d`Emploi

ROGER GARAUDY
L’AVENIR : MODE D'EMPLOI
AAARGH
Ce livre de Roger Garaudy, L’avenir : mode d'emploi, a été édité en 1998 par les éditions Vent du
Large et se trouve en librairie (ISBN : 2-912341-15-9). On peut s'adresser, au choix, à l'éditeur, 1 av.
Alphand, 75116, Paris ; à la Librairie de l'Orient, 18 rue des Fossés Saint Bernard, 75005, Tel. : 01 40
51 85 33, Fax : 01 40 46 06 46 ; ou à l'Association Roger Garaudy pour le dialogue des civilisations, 69
rue de Sucy, 94430 Chennevières sur Marne.
Ce livre est affiché sur Internet à des fins d'étude, de recherche, sans but lucratif et pour un usage
raisonnable. Pour nous, l'affichage électronique d'un document revient exactement à placer ce
document sur les rayons d'une bibliothèque ouverte au public. Nous y avons mis du travail et un peu
d'argent. Le seul bénéficiaire en est le lecteur de bonne foi, que nous supposons capable de juger par
lui-même. Au lecteur intéressé, nous suggérons d'acheter le livre. Nous n'avons pas de raison de
supposer que l'auteur de ce texte puisse être considéré comme responsable d'aucun autre texte publié
sur ce site.
Le secrétariat international de l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste.
Notre adresse est : aaargh@abbc.com. Notre adresse postale : PO Box 81475, Chicago, IL 60681-0475,
Etats-Unis.

2
TABLE DES MATIÈRES
Le but de ce livre : arrêter la marche au chaos
I — D'où vient le danger de mort du XXIe siècle ?
1) — La planète est malade : un monde cassé
2) — L'Occident est un accident : Il a cassé le monde par trois
3) — Hitler a gagné la guerre
— La destruction de l'Union soviétique
— La vassalisation de l'Europe
— L'exclusion des races inférieures dans le monde
II — Comment construire l'unité humaine pour empêcher ce suicide planétaire
1) — Par une mutation économique
A) Un contre Bretton Woods
B) pour un nouveau Bandoeng
2) — Par une mutation politique
— Qu'est-ce qu'une démocratie ? (Le monothéisme du marché détruit l'homme et sa
liberté.)
— D'une Déclaration des droits à une Déclaration des devoirs
— La télévision contre la société
3 — Par une mutation de l'éducation
— qu'est-ce que l’éducation ? (Lire des mots ou lire le monde ?)
— Mythologie ou histoire ?
a — La mystification de l'idée de nation
b — Le colonialisme culturel
c — Le mythe et l'histoire en Israël
— Philosophie de l'être ou philosophie de l’acte ?
4 — Par une mutation de la foi
Et maintenant ?
— Ce que les corrompus d'aujourd'hui appellent mes rêves.

3
ANNEXES
I — Trajectoire d'un siècle et d'une vie
1 — Avoir vécu un siècle en feu
2 — Les rencontres sur le chemin d'en haut
3 — 1968 : Soyons raisonnables : demandons l'impossible
4 — Philosophie de l'Etre et philosophie de l'Acte
II — L'Occident est un accident (ses trois sécessions)
1re sécession : de Socrate à la Renaissance
2e sécession : les trois postulats de la mort
a) — d'Adam Smith au monothéisme du marché. (De la philosophie anglaise)
b) — de Descartes à l'ordinanthrope. (De la philosophie française)
c) — de Faust au monde du non-sens. (De la philosophie allemande)
3e sécession :
a) — Les Etats-Unis, avant-garde de la décadence
b) — Les Etats-Unis, colonie d'Israël
III — Une autre voie était possible
a) — Les précurseurs : de Joachim de Flore au cardinal de Cues
b) — Les occasions manquées : de Thomas More à Montaigne
IV — L'avenir a déjà commencé
Graines d’espoir :
— Le réveil de l’Asie : la nouvelle route de la soie
— Le réveil de l'Amérique latine : la civilisation des tropiques
Bibliographie

4
Introduction
Le but de ce livre : Arrêter la marche au chaos
Le XXe siècle est derrière nous, avec ses incendies ses ruines, ses déserts.
Le XXIe siècle, s'il continue cette marche au chaos, ne durera pas cent ans.
Que faire ?
Ce livre essaie d'apporter un commencement de réponse à cette question : comment
bâtir le XXIe siècle pour qu'il n'assassine pas nos petits enfants ?
Nous ne sous-estimons pas l'immensité de la tâche. Nous vivons l'angoisse de tout un
cycle historique où l'Occident a cru constituer la seule culture et la seule civilisation
et, en sa qualité de peuple élu, imposer au monde sa domination.
Il faut donc retrouver le moment où s'est produite l'erreur d'aiguillage, et les
successives catastrophes qui en ont résulté : trois sécessions de l'Occident conduisent
à un monde cassé.
Deux millénaires à repenser et un troisième à bâtir pour en créer l'unité.
Une entreprise folle ! Oui, mais qu'il est nécessaire d'aborder au moment où la
sagesse des sages nous a conduits au bord du gouffre.
Prendre conscience de l'absurdité de ce qui est, et de ce que l'on peut faire pour
retrouver un sens à nos vies, un sens à notre monde.
- Mais, direz-vous, ce n'est pas mon métier d'être philosophe !
- Ni le mien d'être veilleur de nuit. Mais j'ai vu le feu prendre aux maisons voisines et
la tempête le pousser vers vous.
Alors, ayant vécu la totalité du siècle maudit, je n'ai pas voulu mourir sans pousser ce
cri d'éveil. Debout ! Ouvrez vos yeux. Il les faut clairs pour voir l'horizon. Il faut
aussi des mains pour empoigner la barre, tourner le dos à la nuit, et n'attendre pas midi
pour croire au soleil.

5
I
D'où vient le danger de mort du XXIe siècle ?
Le problème central de cette fin de siècle est celui de l'unité du monde. C'est un
monde interdépendant, et un monde cassé. Contradiction mortelle.
Interdépendant, car lorsqu'il est militairement possible à partir de n'importe quelle
base d'atteindre n'importe quelle cible; lorsqu'un krach boursier à Londres, à Tokyo ou
à New-York entraîne crise et chômage en tous les points du monde; lorsque par
télévision et satellite toutes les formes de culture ou d'inculture sont présentes sur tous
les continents, aucun problème ne peut être résolu de façon isolée et indépendante ni à
l'échelle d'une nation, ni même à celle d'un continent.
Cassé parce que, du point de vue économique (selon le rapport du Programme de
développement des Nations Unies de 1992) 80 % des ressources de la planète sont
contrôlées et consommées par 20 %. Cette croissance du monde occidental coûte
au monde, par la malnutrition ou la faim, l'équivalent de morts de un Hiroshima
tous les deux jours.
* * *
Trois problèmes majeurs semblent à l'heure actuelle insolubles : celui de la faim,
celui du chômage, celui de l'immigration. Les trois n'en font-ils pas qu’un ? Tant
que trois milliards d'êtres humains sur cinq demeurent insolvables, peut-on parler d'un
marché mondial ? ou d'un marché entre occidentaux correspondant à leurs besoins et à
leur culture et exportant dans le Tiers-monde leurs surplus ? Faut-il admettre
l'inéluctabilité de ce déséquilibre et accepter cette réalité qui engendre les exclusions,
les violences, les nationalismes, les intégrismes, sans remettre en question les
fondements de l'actuel désordre ?
* * *
Une époque historique est en train de mourir : celle qui fut dominée, depuis cinq
siècles, par l'Occident (le pays où le soleil se couche, selon l'étymologie).
Une autre est en train de naître, du côté où le soleil se lève : l'Orient.
Le cycle, commencé à la Renaissance, arrivait, par la logique de son développement,
à son terme, par la domination d'un seul, comme il advint de tous les pillards : de
l'empire romain à celui de Napoléon ou d'Hitler, de celui de Charles Quint ou de
l'empire britannique qui, tous, crurent invincibles leurs armadas et éternelles leurs
hégémonies.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
1
/
217
100%