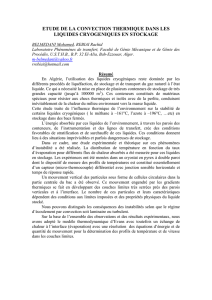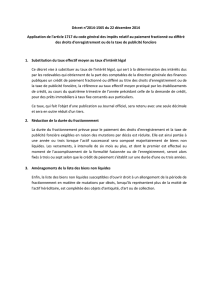Phonologie du français contemporain : usages, variations, structures

Langue française
http://www.necplus.eu/LFR
Additional services for Langue française:
Email alerts: Click here
Subscriptions: Click here
Commercial reprints: Click here
Terms of use : Click here
Le conditionnement lexical de l’élision des liquides en contexte post-
consonantique nal
Elissa Pustka
Langue française / Volume 2011 / Issue 169 / March 2011, pp 19 - 38
DOI: 10.3917/lf.169.0019, Published online: 02 April 2012
Link to this article: http://www.necplus.eu/abstract_S0023836811169027
How to cite this article:
Elissa Pustka (2011). Le conditionnement lexical de l’élision des liquides en contexte post-consonantique nal. Langue
française, 2011, pp 19-38 doi:10.3917/lf.169.0019
Request Permissions : Click here
Downloaded from http://www.necplus.eu/LFR, IP address: 88.99.165.207 on 20 Apr 2017

Elissa Pustka
Ludwig-Maximilians-Universität München & Laboratoire MoDyCo (CNRS UMR 7114),
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Le conditionnement lexical de l’élision des liquides
en contexte post-consonantique final
1. INTRODUCTION
Les liquides (les sons du type (/r/ ou /l/) sont connues pour leur marginalité
dans les systèmes phonologiques des langues du monde (Trubetzkoy 1939 ; Mar-
tinet 1969) ainsi que pour leur grande variabilité phonétique, qui les prédestinent
à la variation diasystématique (Laks 1980 ; Wiese 2003). En français, elles sont,
entre autres, sujettes à élision en position post-consonantique finale, position
dans laquelle elles se retrouvent quand un <e> final n’est pas prononcé (p. ex.
quatre [kat], table [tab]). L’élision s’explique par le fait que la liquide, plus sonore
que la plosive ou fricative qui la précède, présente un maximum de sonorité
non-syllabique
1
, contredisant la courbe de sonorité idéale (Pustka 2007). Quand,
en revanche, le groupe obstruante-liquide est suivi d’un schwa, il se retrouve en
attaque (p. ex. [ka.tK@]) et la sonorité de la syllabe croît continuellement jusqu’au
noyau. Dans ce cas, la liquide est généralement réalisée
2
.
À
l’intérieur du mot
devant consonne, l’élision est extrêmement rare, voire impossible (p. ex. entrete-
nir [˜A.tK@.t(@)niK], ?[˜A.t(@).t(@)niK] ; cf. aussi Dell 1977) 3.
1. Pour la possibilité d’un /r/ syllabique en français, cf. Grammont (1914), Pustka (2007).
2.
Pour une prononciation [kat@], il faudrait admettre un schwa épenthétique qui s’ajouterait à une représenta-
tion dépourvue de schwa et liquide, c’est-à-dire /kat/.
3.
Des contre-exemples se trouvent entre autres dans les enquêtes PFC en Vendée et parmi la bourgeoisie pari-
sienne : aut(re)fois, prononcé sans /r/
–
et sans schwa
–
(cf. Lyche & ∅sby 2009 ; Pustka 2009), prononciation
également mentionnée par Carton et al. (1983) pour le français tourangeau.
LANGUE FRANÇAISE 169
rticle on line
rticle on line
19
“LF_169” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2011/4/21 — 22:46 — page 19 — #19
i
i
i
i
i
i
i
i

Phonologie du français contemporain : usages, variations, structures
Le comportement des liquides post-consonantiques finales montre une forte
variation inter-locuteur. Parmi les français régionaux, les cas extrêmes sont pro-
bablement ceux du français méridional, où les schwas finals sont traditionnelle-
ment réalisés, ce qui protège les liquides de l’élision, et le français antillais, où
le cas typique est la non-réalisation, ce qui suggère des entrées lexicales sans
schwa ni liquide (p. ex. /kat/, /tab/), comme en créole (p. ex. cr. kat ‘quatre’, tab
‘table’). Mais on constate aussi que (presque) aucun locuteur réel ne correspond
entièrement à ces cas prototypiques. Ce sont surtout les jeunes et les personnes
avec un niveau d’études élevé qui présentent un comportement plus proche
du français d’oïl (possédant des liquides variables, que l’on pourrait modeler
comme flottantes
4
), avec lequel ils se trouvent en contact. Ces grammaires de
production ‘mixtes’ posent un problème sérieux à la modélisation phonologique,
si l’on ne veut pas se contenter d’étiqueter ces différences de ‘variation libre’.
Le but de cet article est de trouver des régularités dans ces variations inter- et
intra-locuteur et de les expliquer.
L’analyse se base sur six enquêtes menées entre 2001 et 2004 dans le cadre
du projet Phonologie du Français Contemporain (Durand et al. 2002 ; Durand
et al. 2005 ; http://www.projet-pfc.net/) par l’auteur de cet article : les enquêtes
de Rodez et de Salles-Curan (Aveyron) pour le français méridional, l’enquête
de Guadeloupe pour le français antillais ainsi qu’une enquête de Paris pour le
français d’oïl ; de plus, les enquêtes sur les Aveyronnais et les Guadeloupéens
à Paris livrent des cas extrêmes de ‘mixité’ linguistique (pour les détails de ces
enquêtes, cf. Pustka 2007). Au total, 20 minutes de parole spontanée pour chacun
des 100 locuteurs analysés (de tous âges et de différents milieux sociaux) ont été
prises en compte, c’est-à-dire 33 heures d’enregistrements orthographiquement
transcrits et annotés selon le codage de PFC, qui note également si la consonne
précédant le schwa est produite ou non
5
. Les 4 314 liquides de ce corpus ont
été soumises à une analyse corrélationnelle. La quantité des données, largement
supérieure aux analyses précédentes, permettra de préciser et de consolider la
description du phénomène et d’affiner les explications.
L’analyse du corpus confirme, en effet, que l’élision des liquides est condi-
tionnée par le lexique (cf. Thurot 1883 ; Martinon 1913 ; Laks 1977 ; Dell 1977 ;
Pooley 1996 ; Armstrong 2001). L’objectif de cet article est d’explorer la systé-
maticité de cette variation lexicale. Il commencera par un passage en revue
épistémologique de l’importance du lexique en phonologie (section 2). Ensuite,
sera présenté l’état de l’art sur le conditionnement lexical de l’élision des liquides
4.
Je propose de postuler des liquides flottantes dans les cas d’absence de variations lexicales, quand la présence
ou l’absence de la liquide peut être prédite par des facteurs phonologiques (segmentaux et prosodiques) ainsi
que sociolinguistiques (fidélité à la graphie dans les registres élevés et les couches sociales favorisées).
5.
Pour une analyse plus détaillée, un certain nombre d’informations supplémentaires a été ajouté dans une
base de données Access, en particulier la nature de la liquide devant le schwa (/r/ ou /l/) et celle de l’obstruante
qui précède celle-ci (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/ ou /g/).
20
“LF_169” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2011/4/21 — 22:46 — page 20 — #20
i
i
i
i
i
i
i
i

Le conditionnement lexical de l’élision des liquides post-consonantiques
en contexte post-consonantique final (section 3). Enfin, en section 4, seront expo-
sés les résultats empiriques de l’enquête. La section 5 sera consacrée, quant à
elle, à l’explication de la variation lexicale observée.
2. LEXIQUE ET PHONOLOGIE
2.1. Lexique et changement phonique
Les lois des néogrammairiens (Leskien 1876 ; Brugmann & Osthoff 1898) sont
dites ‘sans exceptions’ : les changements physiologiquement motivés se pro-
pagent parallèlement dans tous les mots du lexique. Mais déjà en 1885, H. Schu-
chardt remet en cause ce postulat. Il fait remarquer que la différence de fréquence
des mots dans la parole mène à un décalage dans la saisie par le changement
phonique, les mots rarement utilisés restant en arrière, les mots fréquemment
utilisés se retrouvant en tête. Cette idée est reprise par W. Wang (1969), qui
développe une théorie de la diffusion lexicale, dans le cadre de laquelle excep-
tions, supplétions et variantes libres peuvent être interprétées comme les indices
d’un changement en cours. Il a pu être montré par la suite que les changements
réductifs commencent par les mots fréquents, les positions non-accentuées, les
mots à fonction et le vocabulaire appartenant au registre familier (Philips 1983 ;
Bybee 2000a ; Hansen 2001). Le cas des liquides post-consonantiques finales du
français permettra de tester cette théorie.
L’hypothèse selon laquelle la diffusion lexicale et les lois dites ‘sans excep-
tions’ sont à considérer comme contradictoires (Wang 1969 ; Schuchardt 1885 ;
Hansen 2001 ; Bybee 2002) ou complémentaires (Labov 1981) est elle-même
sujette à discussion. Quoi qu’il en soit, il faut souligner que les néogrammai-
riens avaient eux-mêmes reconnu un certain nombre d’exceptions, entre autres
liées au contact dialectal (nommées alternances phonétiques, en opposition aux
changements phonétiques ; cf. Paul 1880 ; Brugmann & Osthoff 1898). Celui-ci joue
incontestablement un rôle dans les cas étudiés ici : les français aveyronnais et
guadeloupéen sont probablement influencés, chacun pour ce qui le concerne,
par le français d’oïl.
Le rôle du lexique est en revanche incontesté dans le cas du contact linguis-
tique, notamment quand il s’agit de l’influence d’une L2 prestigieuse sur la L1 :
“words first, grammar later (if at all)” (Thomason, 2001 : 64). Cela n’est pas seule-
ment valable pour le contact entre deux langues différentes, mais aussi pour le
contact entre variétés :
The point is that during accommodation speakers do not modify their phonological systems, as
such, so that they more closely resemble those of the speakers they are accommodating
to. Rather, they modify their pronunciations of particular words, in the first instance, with
some words being affected before others. Speakers’ motivation, moreover, is phonetic
rather than phonological: their purpose is to make individual words sound the same
as when they are pronounced by speakers of the target variety. (Trudgill, 1986 : 58 ;
c’est moi qui souligne)
LANGUE FRANÇAISE 169
21
“LF_169” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2011/4/21 — 22:46 — page 21 — #21
i
i
i
i
i
i
i
i

Phonologie du français contemporain : usages, variations, structures
Selon l’échelle d’emprunt de S. Thomason et T. Kaufman (1988), pour l’em-
prunt de lexèmes (avant tout celui d’un vocabulaire spécialisé qui se trouve
en relation avec la culture dominante), un contact sporadique est la condition
suffisante. Un contact plus intensif est par contre nécessaire pour l’emprunt de
conjonctions et d’adverbes, et un contact encore plus intensif est nécessaire pour
celui de prépositions, pronoms et numéraux.
On ne peut bien évidemment pas exclure un scénario selon lequel un chan-
gement par contact et un changement interne se déroulent en même temps : le
contact peut déclencher un développement interne (Van Coetsem 1988) ou l’ac-
célérer (Weinreich 1953). Dans une perspective microscopique, on pourrait aller
jusqu’à dire que tout changement se fait par contact, puisque même les processus
physiologiquement motivés se diffusent dans la communauté linguistique par
le contact entre les locuteurs.
2.2. Lexique et modélisation phonologique
Alors que la phonologie néo-générative marginalise le lexique comme une
liste d’idiosyncrasies (Chomsky & Halle, 1968 : 175, 375 sqq. ; Dell, 1973 : 138 ;
cf. Corbin 1976), l’exemplarisme
6
lui attribue une place centrale (Bybee 2001 ;
Pierrehumbert 2001). Dans ce cadre, les représentations sont considérées comme
primaires et les généralisations phonotactiques n’ont qu’un statut secondaire.
De plus, l’usage reçoit un rôle central. Cette phonologie basée sur la parole part
du principe que chaque token a des effets sur les représentations. Cela ne veut
néanmoins pas dire que la distinction entre input et output soit complètement
abandonnée : on admet un certain processus d’abstraction, dans lequel les tokens
sont catégorisés
7
. Il n’y a donc pas une seule forme sous-jacente, mais tout un
cluster, p. ex. /Egz
˜A
pl@/, /Egz
˜A
pl/ et /Egz
˜A
p/ pour exemple. Les exemplaires des
tokens fréquents gagnent par l’usage en force lexicale et deviennent centraux (ils
sont plus rapidement consultables), tandis que les exemplaires correspondant
aux tokens rares deviennent marginaux dans les représentations.
Se situant dans le cadre de la linguistique cognitive, la phonologie exempla-
riste, à l’instar des Grammaires de Construction (Goldberg 1995 ; Croft 2001),
part du principe que non seulement les mots font partie du lexique, mais aussi
les constructions figées (p. ex. c’est-à-dire,de temps en temps) ainsi que toutes les
autres suites de mots souvent employés ensemble (Bybee 2000b, 2005). Le degré
de figement d’une séquence peut varier selon sa fonction ; angl. I don’t know
et fr. je sais pas ont, par exemple, plus de cohésion interne quand la séquence
possède une fonction discursive que quand elle a la signification transparente
6.
L’exemplarisme n’est pas forcément à considérer comme une alternative aux théories néo-génératives, mais
elle peut les compléter (cf. Pustka 2007).
7.
“As a result, an individual exemplar – which is a detailed perceptual memory
–
does not correspond to a
single perceptual experience, but rather to an equivalence class of perceptual experiences.” (Pierrehumbert,
2001 : 4)
22
“LF_169” (Col. : RevueLangueFrançaise) — 2011/4/21 — 22:46 — page 22 — #22
i
i
i
i
i
i
i
i
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%