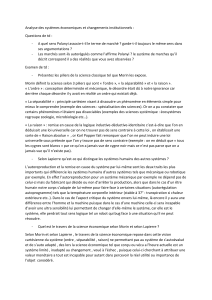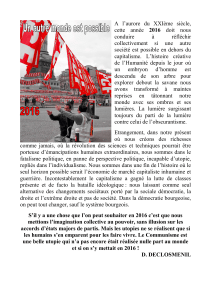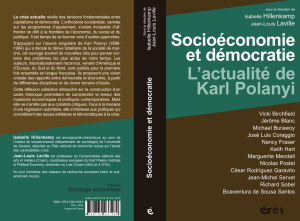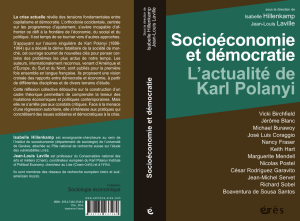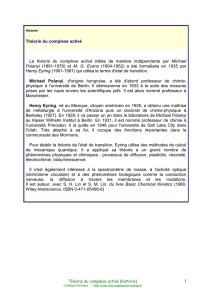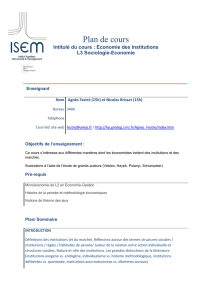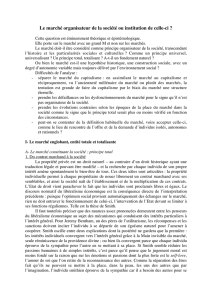Polanyi et Perroux : le socialisme démocratique en question.

0
Polanyi et Perroux : le socialisme démocratique en question.
Sylvie CONSTANTINOU
Chercheur indépendant
Colloque organisé par l’ISMÉA, le CIAPHS et l’IMEC en partenariat avec :
Sylvie Constantinou

1
Les sociétés contemporaines sont marquées par deux phénomènes catastrophiques, le
capitalisme libéral et le totalitarisme, phénomènes qui rejettent au rang d’idéaux utopiques
deux autres projets politiques et économiques eux aussi propres à l’époque moderne, la
démocratie et le socialisme. Les années d’entre deux guerres furent peut-être le moment où
ces quatre alternatives sont le plus ouvertement entrées en concurrence. Deux économistes,
Karl Polanyi et François Perroux, témoins directs de ces événements et tous deux attentifs aux
moyens d’éviter que le capitalisme libéral et le totalitarisme ne l’emportent, se sont intéressés,
parallèlement, et probablement sans le savoir, à un système économique, le corporatisme, qui
connaissait durant cette période un regain notable d’intérêt dans de nombreux pays européens,
en tant qu’alternative au capitalisme. Dans certains pays, en Allemagne, en Italie et en
Autriche, ces tentatives à la fois politiques et économiques, se sont terminées par des régimes
autoritaires. Une certaine forme de corporatisme apparaissait pourtant initialement, et en
particulier aux yeux de nos deux auteurs, comme un moyen d’instituer une véritable
démocratie fondée sur une organisation fonctionnelle de la société. Perroux a formulé en 1938
une théorie de l’économie corporative sous le nom de Communauté de Travail, expression qui
visait à la différencier du corporatisme fasciste. Les néo-socialistes anglais avaient, de leur
côté, développé depuis les années 1920 une théorie politique corporatiste sous le nom de
socialisme fonctionnel. Polanyi avait formulé à la suite, en 1922, les fondements
institutionnels de l’économie socialiste démocratique. Toutes ces tentatives se sont perdues
dans les décombres du totalitarisme et de la 2nde guerre mondiale.
Or l’actualité n’est pas sans redonner un intérêt au retour à cette thématique oubliée du
corporatisme en tant qu’alternative au capitalisme libéral et au socialisme. En effet la
recherche d’une alternative semble à nouveau dans l’impasse et donne lieu à un phénomène
d’opinion étonnant. Le développement de la contestation du capitalisme en de nombreux pays
ne semble pas se traduire par le renforcement de ce qui devrait apparaître comme son

2
alternative politique et économique, le socialisme. A sa place, des dérives autoritaires
semblent menacer de nombreux régimes démocratiques, en particulier en Europe. En cela
notre époque rappelle les années 1930, années d’une crise économique sans précédent qui a
déclenché un mouvement anticapitaliste et antilibéral dont les effets politiques et
institutionnels hésitèrent entre socialisme et fascisme. Le parallèle est significatif avec notre
actualité. Les démocraties se sont montrées impuissantes à se défendre contre des formes
autoritaires de gouvernement. Alors qu’il semblait dans les années 1920, que les peuples
allaient s’engager résolument vers la voie nouvelle du socialisme, c’est le fascisme qui a peu à
peu gagné tous les pays européens durant les décennies suivantes. Il semble donc opportun de
reprendre ces textes oubliés et la trace qu’y a laissé le processus d’évolution vers le socialisme
au point où il s’est arrêté et a dû laisser place au totalitarisme. Nous nous appuierons sur les
monographies réalisées par Perroux sur les corporatismes réalisés, pour valider les intuitions
audacieuses de Polanyi, tandis que celles-ci nous permettront de dissiper les ambiguïtés des
recherches d’une troisième voie chez Perroux.
1. Sur l’obsolescence de l’alternative entre capitalisme et socialisme.
Polanyi et Perroux ont eu en commun le souci de rechercher les conditions d’une coexistence
entre les « deux Nations »1, ou encore entre les intérêts du capital et ceux du travail. Au début
des années 1960, Polanyi avait le projet d’une revue au titre symbolique, Coexistence ;
Perroux est de son côté l’auteur d’une somme en 3 volumes, intitulée La coexistence
pacifique [Perroux, F.(1958)]. Cette recherche les a conduit à critiquer la pertinence de la
notion de lutte des classes et de l’opposition entre travail et capital pour rendre compte de la
crise économique et sociale du capitalisme [Perroux, F. (1938), p.16]. Polanyi a ironisé sur les
limites de la problématique marxiste / antimarxiste : « Une seule des deux solutions suivantes
1 Titre d’un roman de B. Disraeli qui aborde l’une des premières formes de la lutte des classes, au milieu du
19ème siècle en Angleterre, entre les chartistes, réclamant le suffrage universel et l’abolition des privilèges de la
propriété, et les aristocrates et les bourgeois qui gouvernaient la Chambre des Communes.[Polanyi, K. (1983),
annexe XI, p.377].

3
est possible : soit la classe ouvrière dirige, soit la classe des capitalistes. La première est
synonyme de socialisme, la seconde de capitalisme. C’est une question de pouvoir. D’où le
peu d’intérêt de toutes ces discussions sur la perversion des fonctions politique et
économique, ainsi que sur la mise en place d’une démocratie fonctionnelle fondée sur une
économie socialiste… » [Polanyi, K. (2008), p.432]. Ce manque d’intérêt s’observe encore de
nos jours. Ni Polanyi, ni Perroux n’ont jugé possible de re publier leurs travaux relatifs à la
démocratie fonctionnelle. La non-publication des manuscrits, intitulés dans l’édition des
Essais de K. Polanyi « Marx et le corporatisme », renvoie aux difficultés similaires
rencontrées par Polanyi pour maintenir la question de l’économie socialiste fonctionnelle au
centre du débat politique.
Perroux ne se satisfait pas non plus de l’explication marxiste. Les transformations de
l’économie et de la politique ont en effet, selon lui, rendu secondaire le rôle de la propriété
privée dans la crise économique et sociale. Cette position est presque devenue un poncif
aujourd’hui. Nous la discuterons à la lumière des réflexions de Polanyi sur la montée du
fascisme dans les années d’entre deux guerres. Dans quelle mesure l’opposition capitalisme
contre socialisme est-elle décidément obsolète ? Peut-on soutenir qu’elle contribue à obscurcir
et même à pervertir le débat politique ? Quel rôle la lutte des classes entre propriétaires et
non-propriétaires d’actifs a-t-elle encore dans la crise actuelle ?
1.1- L’impasse fonctionnelle de la politique dans un monde industriel.
D’un point de vue fonctionnel, le développement du capitalisme libéral est allé de pair avec
l’industrialisation de l’économie grâce à la libération des marchés et à la libre concurrence
entre les initiatives de libres entrepreneurs. La modernisation industrielle s’est traduite par un
double phénomène sociologique, la subordination de la majorité de la population dans de
grandes entreprises (à l’échelle du monde parce que l’industrie a besoin d’élargir ses marchés

4
pour s’assurer de la rémunération des capitaux investis) et la libération politique et sociale des
individus.
1.2- Les transformations de l’économie.
Les réflexions de Perroux l’ont conduit en 1958 à s’interroger sur l’évolution de l’économie
mondiale, et à considérer le problème de l’industrialisation, de « l’Ere de la Machine »
[Polanyi, K. (2008), p.505] comme le cœur de la crise subie par le capitalisme des pays
occidentaux et le socialisme soviétique. Le monde de la production est marqué par une
profonde division du travail et un besoin de coordination par des pouvoirs qui se renforcent
naturellement dans cette tâche. Ce point de départ sociologique est commun à Polanyi
[notamment (2008), p.426] et à Perroux [notamment (1958), tome I]. La complexité des
sociétés industrielles se manifeste notamment par un mode de production en filières
dépendantes les unes des autres. Les risques d’échec économique (avec leurs hécatombes de
chômage ou de déplacements de population) s’accroissent avec le poids de la
commercialisation des produits dans l’économie, lorsque les consommateurs ne confirment
pas les choix effectués en amont par les « investisseurs ». Le fonctionnement solidaire des
parties du système de production, neutralise les oppositions de classe, qu’elles s’analysent
comme des oppositions entre les intérêts du capital et du travail, ou comme des oppositions
entre les motivations économiques (efficacité, productivité technique, croissance) et les
motivations politiques (liberté, justice sociale, équilibre écologique), selon la polarité utilisée
dans la Comptabilité Socialiste. Le fait que les dimensions de cette interdépendance se soient
étendues au monde entier a accru la rigidité d’ensemble du système. Les enjeux politiques et
sociaux passent au second plan par rapport aux contraintes imposées par la machine
économique. Les individus sont conduit à l’alimenter de toutes leurs forces vitales et en
impliquant toutes les dimensions de leur personnalité [Coutrot, T. (2005)]. La servitude
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%