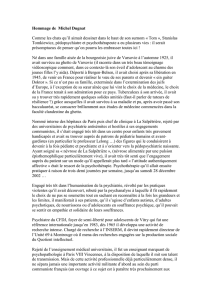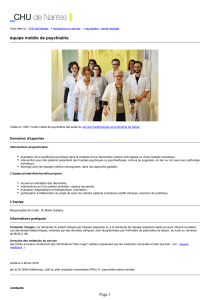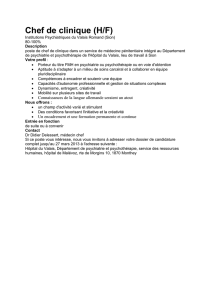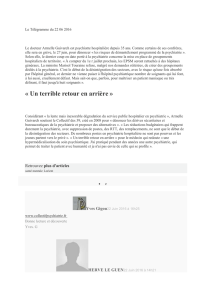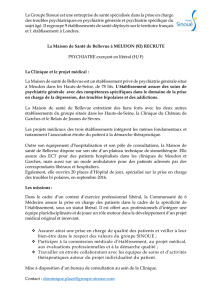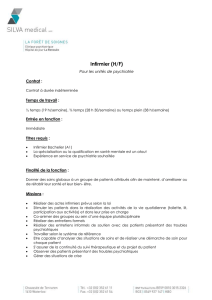info document

1
Le sujet au risque des nouvelles organisations
Congrès Croix Marine Caen lundi 30 septembre 2013
Restaurer le sujet dans l’homme
Pierre Delion
Venant à la rescousse de la parole prophétique de Tosquelles : « Sans
la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est l’homme
même qui disparaît », Henri Maldiney, avec la puissance qui le
caractérise, déclarait lors d’une conférence que j’organisai avec
Salomon Resnik à Angers en 1999 sur le thème « Penser l’homme et
sa psychose » : « L’homme est de plus en plus absent de la
psychiatrie, mais peu s’en aperçoivent parce que l’homme est de plus
en plus absent de l’homme
1
». On ne saurait si bien dire ce qui est en
passe de nous arriver et contre lequel nous devons lutter
collectivement de toutes nos forces éthiques, intellectuelles et
affectives pour en empêcher la survenue. Non pas dans une attitude
romantique ou esthétisante, ce qui pourrait laisser penser à une
position nostalgique voire dépressive, mais dans un mouvement de
rassemblement de tous les éléments épars que seule l’Histoire de la
psychiatrie éclaire de la réalité de ses errements délétères et des
espoirs de ses révolutions inachevées. Car enfin, il faut le dire haut et
fort, une certaine idée de la psychiatrie a prévalu pendant quelques
décennies, qui a permis d’accomplir de profondes modifications de
son exercice auprès des personnes concernées par cette pathologie si
singulière. Et tout cela pourrait tout simplement disparaître ? Et de
surcroît pour de mauvaises raisons ? Il en va de cette psychiatrie à
visage humain comme de la démocratie : nous ne prenons conscience
de son immense importance que lorsqu’elle en vient à risquer de
1
Maldiney, H., « Comme Husserl avait alerté la philosophie, par son mot d’ordre « Zur Sache selbst », « aller
à la Chose elle-même », à ce qui est réellement en cause dans l’affaire ... Ludwig Binswanger entendait alerter
la psychiatrie par un propos avertisseur qui lui rappelait son champ propre : « l’Homme dans la psychiatrie ».
On ne saurait dire qu’il a été entendu. L’homme est de plus en plus absent de la psychiatrie. Mais peu s’en
aperçoivent parce que l’homme est de plus en plus absent de l’homme ! Il est possible de comprendre comment
ce retrait de l’homme s’effectue en somme de façon humaine et ce qu’il implique d’humain. Car l’homme, dans
son retirement suit cette voie spécifiquement humaine qui s’appelle, depuis Heidegger, le « projet » lequel est au
principe de toute entreprise. Or c’est à une entreprise que tend à ressembler, de plus en plus, l’action
psychiatrique. Aussi est-il possible d’apercevoir en même temps ce qui se montre de l’homme dans cette
déshumanisation humaine, et d’en tirer des éclaircissements sur le procès humain que constitue la folie. »
Angers samedi 16 octobre 1999 : Penser l’homme et sa psychose

2
disparaître, nous révélant à la fois son caractère précaire et la fragilité
des équilibres qui l’ont installée dans l’Histoire de nos contrées et de
nos vies quotidiennes, menacée à chaque instant d’en être chassée par
le côté obscure de la force ... il n’est pas facile d’admettre que les
avancées de l’homme ne peuvent jamais être considérées comme
acquises une fois pour toute, et la correspondance entre Freud et
Einstein est là pour nous rappeler avec une rigueur toujours aussi
actuelle que les processus d’idéalisation, considérant la destructivité
de l’homme comme amendable, sont nos pires ennemis sur le chemin
de la civilisation de l’homme lui-même par les processus de Culture,
seuls susceptibles de transformer la violence dans certaines
circonstances. Ça n’est que lorsque l’on connaît bien ses limites
qu’une évaluation des forces en présence est envisageable dans la
réalité, sinon, les pièges de l’inflation imaginaire se referment sur les
utopies avant même leur possibilisation. C’est en partie ce qui est
arrivé à notre psychiatrie, que je qualifie de transférentielle, de ne pas
l’avoir assez explicitée ou d’avoir trop négligé les attentes de
psychiatrie sécuritaire qu’un socius contemporain, pétri d’un malaise
entretenu par des démagogues à courte vue, et excité par des médias
de plus en plus complaisants à force de simplifications, semblait
préférer à toute humanisation de ses modes d’exercice. D’un certain
point de vue, une guerre larvée contre l’humanité des pratiques
relationnelles est déclarée, et la psychiatrie, avec la pédagogie, la
justice et quelques autres grandes causes comparables, est en première
ligne de ce combat. Une psychiatrie sans sujet serait une psychiatrie
mortifère.
Avant d’explorer plus en profondeur les avatars de la psychiatrie
d’aujourd’hui risquant de se refermer sur ses démons connus et
inconnus, il me semble utile de parcourir l’histoire de ses évolutions et
révolutions pour mieux percevoir d’où s’originent les lignes de force
qui président à la restauration du sujet dans l’homme.
La révolution psychiatrique
La révolution psychiatrique commence avec Pinel
2
et Pussin
3
sur les
épaules des Encyclopédistes et dans le sillage de la Révolution
2
Pinel, P., Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, Paris, Brosson, 1809.

3
française : le fou est un citoyen, et en tant que tel, le médecin peut
l’aider ; il est ainsi libéré des prisons et des culs de basse fosse dans
lesquels il croupissait antérieurement sur la seule action d’une lettre de
cachet ; le désormais malade mental a le droit d’être soigné dans une
tentative de compréhension humanisante, par un traitement moral qui
repose sur une position philosophique révolutionnaire. Mais cette
position pionnière, éclairée différemment par Foucault
4
, par Gauchet
et Swain
5
, et plus récemment par Laure Murat
6
, tenant en grande partie
au charisme de ses deux premiers fondateurs, se dévoiera peu à peu
dans une réforme centrée par Esquirol sur les espaces dédiés aux
désormais malades mentaux, au détriment de l’art de les habiter avec
humanité. La loi de 1838 commence par cette fondation : « Il est créé
dans chaque département un asile d’aliénés
7
», traduction législative
de la pensée opératoire d’Esquirol pour qui ce nouvel espace constitue
« un instrument de guérison à la condition d’être gouverné par un
médecin habile »…Une fois passées les quelques années de la lune de
miel consécutive à cette réalisation oblitérant le caractère relationnel
que l’utopie du traitement moral portait en elle, et minéralisant ses
potentialités libératrices dans les désormais célèbres « murs de
l’asile », l’expérience a montré que sans l’inspiration qui guidait les
premiers philosophes-psychistes, cette projection de la folie dans des
lieux médicalisés, était purement et simplement vouée à échouer sur le
roc de l’inconnue transférentielle. Dans l’après coup nous avons
compris que sans l’invention freudienne réhabilitant le monde des
névroses, et permettant la découverte de ce levier puissant du transfert
pour mieux approcher la présence de l’infantile dans l’actualité de son
rapport au monde de l’intersubjectivité, le piège de l’aliénation
mentale ne pouvait être déjoué sans le recours obligé à la
surdétermination inconsciente. Cette première étape ne répondait que
partiellement aux questions posées par les destins entropiques
asilaires, dans le mesure où les transferts de personnes névrosées
n’avaient que peu à voir avec ceux des personnes psychotiques,
3
Didier, M., Dans la nuit de Bicêtre, Paris, Gallimard, 2006.
4
Foucault, M., Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1971.
5
Gauchet, M., Swain, G., La pratique de l’esprit humain, Gallimard, Paris, 1980.
6
Murat, L. L’homme qui se prenait pour Napoléon, Gallimard, Paris, 2011.
7
Article 1 de la Loi du 30 juin 1838.

4
sédimentant dans un établissement d’aliénés. Il aura fallu attendre
encore quelques décennies et la survenue d’une deuxième guerre
mondiale pour que la métapsychologie freudienne soit visitée à son
tour par les pères de la psychothérapie institutionnelle et plus
précisément par Tosquelles et Oury. En venant proposer une réflexion
qui visait à étendre à l’ensemble de la psychiatrie les découvertes
freudiennes à condition de les repenser en fonction des pathologies
envisagées, un lieu spécifié et clos ne pouvait en aucun cas parvenir à
transformer (au sens de Bion) les éléments d’une double aliénation (
sur le plan psychopathologique et sur le plan social) existant
préalablement dans le socius et conduisant le patient vers l’asile, en
autre chose que la reproduction des mêmes mécanismes à l’intérieur
même de l’asile : ségrégation, cloisonnement, isolement, pathoplastie,
sédimentation.
Si pour Freud le sujet de la névrose n’est pas là où on l’attend (« wo es
war, zoll ich werden » /« là où ça est, je dois advenir »), c’est parce
qu’il est surdéterminé par un inconscient et, dans une moindre mesure,
par un sur moi qui entretiennent tous les deux avec le moi des rapports
de forces pulsionnelles qui produisent les symptômes de la névrose
occidentale poids moyen ; dans certains cas, les forces en question
débordent les capacités du système et déclenchent une névrose
pathologique, mais les deux idées freudiennes novatrices sont que,
même dans de telles occurrences, il n’y a pas de différence définitive
entre le normal et le pathologique et que les symptômes ont un sens
pour le sujet serti dans sa névrose normale ou pathologique : à charge
pour le psychanalyste, devenu fin limier, d’en trouver le sens, non pas
à la place du patient mais avec lui, co-acteur de sa thérapie. Pour y
parvenir, Freud conseille, troisième idée-force, de prendre appui sur la
la relation entre le patient et son psychanalyste, mise en forme par le
vécu subjectal de son enfance, et actualisant ses premières interactions
avec ses parents lors de sa période infantile, autrement dit sur le
transfert. Difficile, après ces découvertes, de continuer à nier que le
projet freudien soit de restaurer le sujet dans l’homme, même au prix
de sa folie névrotique. Et insupportable d’entendre que la
psychothérapie institutionnelle n’aurait pas comme projet de restaurer
le sujet dans l’homme psychotique, et chez l’enfant autiste, tout en
l’accompagnant dans la cité tout le temps nécessaire.

5
Mais la cure-type a ses limites, et notamment dès lors qu’il s’agit de
soigner des personnes psychotiques et de se soumettre à leurs formes
singulières de transferts, notamment le transfert dissocié, concept
spécifique de la schizophrénie inventé par Oury, mais aussi le transfert
psychotique ou projectif et le transfert autistique ou adhésif, et leurs
corollaires obligés, les constellations transférentielles
8
de chaque
patient en tant que créations institutionnelles répondant à la spécificité
des « êtres-au-monde » de chacun. La psychothérapie institutionnelle
est née pour partie de la réponse à la question posée par un Freud
visionnaire en conclusion du Vème Congrès International
Psychanalytique de Budapest en Septembre 1918, survenant sur les
décombres de la première guerre mondiale, en proposant, sans le
formuler aussi clairement, que l’institution figure le chaînon manquant
dans l’instauration de la relation transférentielle entre le patient
psychotique et les soignants qui l’accueillent, et en pensant le
déploiement de cette institution de telle sorte que l’humain y soit
cultivé de façon prévalente à toute autre qualité. Je ne peux résister ici
au plaisir de vous citer cette parole freudienne qui a pour moi
beaucoup d’importance : « Pour conclure, dit Freud, je tiens à
examiner une situation qui appartient au domaine de l’avenir et que
nombre d’entre vous considéreront comme fantaisiste mais qui, à
mon avis, mérite que nos esprits s’y préparent. Vous savez que le
champ de notre action thérapeutique n’est pas très vaste. (…)On
peut prévoir qu’un jour la conscience sociale s’éveillera et
rappellera à la collectivité que les pauvres ont les mêmes droits à un
secours psychique qu’à l’aide chirurgicale qui leur est déjà assurée
par la chirurgie salvatrice. La société reconnaîtra aussi que la santé
publique n’est pas moins menacée par les névroses que par la
tuberculose (…). A ce moment-là on édifiera des établissements, des
cliniques, ayant à leur tête des médecins psychanalystes qualifiés et
où l’on s’efforcera, à l’aide de l’analyse, de conserver leur résistance
et leur activité à des hommes, qui sans cela, s’adonneraient à la
boisson, à des femmes qui succombent sous le poids des frustrations,
à des enfants qui n’ont le choix qu’entre la dépravation et la
8
Delion, P., Soigner la personne psychotique, Dunod, Paris, 2010.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%