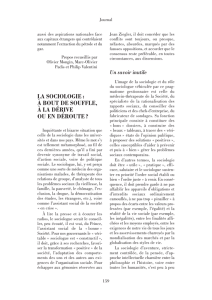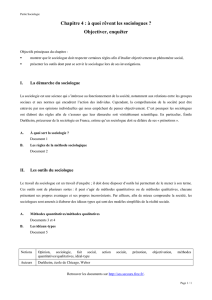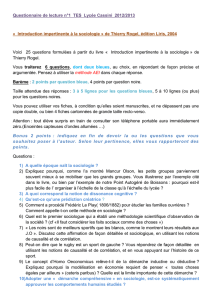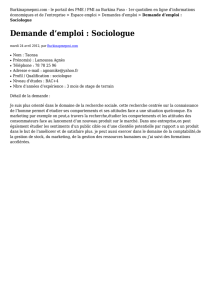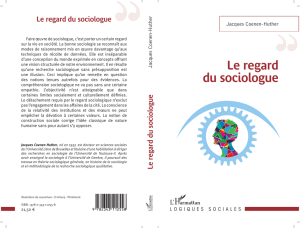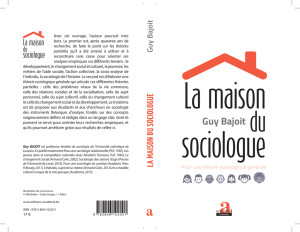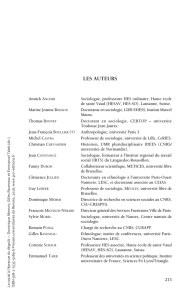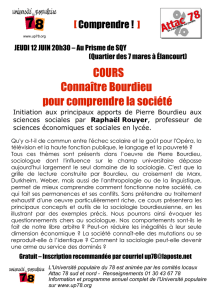L`engagement du sociologue comme obligation éthique et politique

L’engagement du sociologue comme obligation éthique et politique.
Jean-Louis Genard
Lorsque nous portons nos réflexions sur l’engagement des sociologues, nous mêlons souvent
deux questions qui, bien que se chevauchant, méritent, je pense, des traitements distincts.
D’un premier côté, nous nous demandons si les sociologues doivent ou à tout le moins font
bien de s’engager avec comme horizon le fait que le sociologue, en plus d’être sociologue, est
évidemment un citoyen. D’un second côté, sous l’horizon cette fois non plus de la citoyenneté
mais plutôt de la sociologie elle-même, nous nous demandons si celle-ci est
fondamentalement engagée, si elle doit l’être ou si son exigence d’objectivité doit maintenir
ceux qui la pratiquent dans une position de réserve par rapport à l’engagement. Pour le dire de
manière lapidaire, il y a là deux questions en réalité différentes : celle de l’engagement du
sociologue comme citoyen, celle du statut épistémologique de la discipline sociologique et en
particulier de la sociologie critique. Très différentes mais néanmoins imbriquées puisque par
son travail disciplinaire, le sociologue dispose de savoirs étayés sur le social qui peuvent
constituer des ressources pour la prise de parole publique et la critique.
Du point de vue de la citoyenneté, la réponse à la première question « le sociologue devrait-il
s’engager ? » dépend fondamentalement des intuitions de justice à partir desquelles nous
envisageons ce qui se passe. Et il y a bien sûr suffisamment de situations inacceptables,
insupportables ou intolérables pour que la réponse soit évidemment positive. Et bien sûr aussi,
les travaux sociologiques peuvent venir à l’appui de ces prises de paroles publiques en
mettant au jour des mensonges politiques, des injustices sociales, en décrivant des
oppressions. Il ne fait pas de doute non plus que de telles mises au jour puissent être autant
d’appels à la prise de parole et à l’engagement, interdisant moralement en quelque sorte au
sociologue de se taire. Comme l’ont mis en évidence de nombreux sociologues, comme y a
insisté Antony Giddens, la sociologie constitue un des leviers de la réflexivité que nous
sociétés pratiquent sur elle-même et cela fait porter au sociologue des responsabilités éthiques
et politiques par rapport auxquelles le désengagement constitue une échappatoire
difficilement justifiable. Plus encore, si les travaux sociologiques participent de la réflexivité
sociale et pèsent donc sur le gouvernement des sociétés, il me semble alors y avoir de la part
du sociologue une exigence d’engagement, à moins qu’il ne fasse « comme si » sa discipline
ne jouait pas ce rôle ou « comme si » de cela il pouvait se laver les mains.
Cela dit, comme je l’ai évoqué plus haut, ces engagements dépendent d’intuitions de justice
dont on ne peut présupposer qu’elles font l’objet d’un consensus au sein de la communauté
des sociologues, pas plus, comme on le verra, que l’on puisse s’attendre à ce qu’elles
découlent et s’imposent avec nécessité en fonction des analyses que mène la sociologie.
Loin de la relative évidence des propos qui précèdent, la situation va se compliquer dès lors
que la question de l’engagement public du sociologue ne se posera plus sous l’horizon de sa
citoyenneté mais sous l’angle de l’épistémologie de la discipline. En effet un des traits
constitutifs de l’histoire de celle-ci semble bien être la fascination-hantise que constitue pour
la sociologie la figure du sociologue engagé. Sociologie critique d’un côté, neutralisation
axiologique de l’autre. Sociologie critique d’un côté, dévoiement de la sociologie dans une
expertise dévolue au pouvoir de l’autre… Pourquoi donc cette double hantise – abandon de
l’exigence scientifique, collusion avec le pouvoir- que la sociologie se perde lorsqu’elle
entend s’engager ? Pourquoi à l’inverse cette fascination constante pour la figure du
sociologie engagé ? Pourquoi donc les « bons » sociologues devraient-ils se mettre en retrait

de la cité ou ne feraient-ils plus vraiment de la sociologie lorsqu’ils « deviennent » citoyens ?
Mais, à l’inverse, au nom de quoi les « bons » sociologues devraient-ils faire de leur
engagement une dimension de leur travail de sociologue ? Le travail sociologique porterait-il
en lui-même vers des résultats qui le conduiraient nécessairement à ne pas pouvoir se tenir en
retrait ? L’histoire de la sociologie a tenté d’apporter de multiples réponses à ces questions,
sans jamais pleinement convaincre, sans jamais à tout le moins convaincre à partir d’une
spécification de ce qu’est ou devrait-être la sociologie.
Pour tenter d’éclaircir cette difficile question, le fait que le sociologue est aussi un citoyen
ordinaire me conduira à partir d’une situation de conversation banale. Ce détour me paraît
doublement pertinent dans le cadre d’une réflexion sur l’engagement du sociologue. D’une
part parce que j’ai la conviction que le travail du sociologue est une continuation –par d’autres
moyens, d’autres méthodes, avec d’autres finalités…- des conversations ordinaires (Genard,
1994) . Le sociologue se préoccupe en effet de ce dont les gens se préoccupent, l’école, le
chômage, le travail, la santé, les loisirs… Bien entendu dans les conversations ordinaires se
posent des questions qui à un moment demandent des éclaircissements. Ceux-ci peuvent
prendre différentes orientations. On peut tout d’abord se poser des questions dont l’horizon
est l’objectivité. Les descriptions de ce qui arrive, de ce dont on parle… sont–elles correctes,
les explications causales qui sont mises en avant tiennent-elles vraiment ? C’est une première
forme d’enjeu de validité que de chercher à décrire ou à expliquer plus correctement. Les
demandes d’éclaircissements peuvent toutefois prendre une orientation différente lorsqu’elles
se construisent à partir de doutes que nous avons sur la manière dont nous saisissons ce que
nous disent nos interlocuteurs. Nous cherchons alors à mieux les comprendre en leur posant
des questions, en leur soumettant la manière dont nous les avons compris et en leur
demandant si c’est bien cela. Nous ne sommes plus là dans une posture objectivante, mais
plutôt dans une posture d’intercompréhension, dans une posture disons participante. A vrai
dire, nous ne cessons d’ailleurs de jongler avec ces postures. Par exemple, c’est après nous
être assuré que nous avons bien compris ce que pensait notre interlocuteur que nous basculons
vers une posture objectivante : si tu penses cela, maintenant que je t’ai bien compris, c’est
parce que tu n’arrives pas à te détacher de ce blocage… En poursuivant notre conversation
ordinaire, nous pouvons aussi bien sûr, à certains moments, marquer notre désaccord en
adoptant alors une posture critique. Nous ne contestons pas les descriptions ou les
explications de ce qui se passe, nous sommes convaincus d’avoir bien compris ce que notre
interlocuteur nous veut, mais nous ne sommes pas d’accord avec lui. Encore une fois, ces
postures ne cessent de s’interpénétrer et si nous nous mettons à critiquer c’est par exemple
après que nous nous soyons assuré d’avoir bien compris ce que notre interlocuteur nous
voulait ou c’est en apportant la preuve que les descriptions auxquelles il se référait n’étaient
pas correctes.
La distinction sans doute un peu abstraite de ces trois postures est loin d’être arbitraire, elle
s’appuie en réalité sur une structure très profonde des ressources à partir desquelles nous
conversons : la grammaire des pronoms personnels. Le pronom Il correspond à la posture
objectivante, Tu à la posture intercompréhensive et Je à la posture engagée. Et cela renvoie au
fait que lorsque nous parlons nous nous adressons à quelqu’un (Tu), à propos de quelque
chose (Il) et en nous engageant (Je). Ou pour le dire autrement cela renvoie aux trois
dimensions du langage ordinaire que distingue souvent la linguistique : dimension
référentielle (Il), dimension illocutionnaire (Tu) et dimension performative (Je).
Bien qu’interconnectées et enchevêtrées dans les conversations ordinaires, bien que se
nourrissant l’une l’autre… ces trois postures sont toutefois différenciables. Qu’est-ce que ce

détour par une analyse sommaire des conversations ordinaires peut bien nous apprendre sur la
sociologie et sur l’engagement du sociologue dans la cité ?
Je pense que les grandes querelles épistémologiques sur le statut de la sociologie - de la
querelle expliquer-comprendre aux querelles plus récentes sur la sociologie critique, en
passant par l’exigence de neutralisation axiologique- s’éclairent et se dédramatisent si on les
rapporte aux distinctions précédentes (Genard, 2003). Expliquer-décrire, comprendre-
interpréter, critiquer… telles sont somme toute les trois manières dont, dans son histoire, la
sociologie a tenté de se positionner et de s’articuler (Genard, 2011). Avec le positivisme, elle
a pu tenter de se construire sur la seule posture objectivante (Il). Dans la querelle expliquer-
comprendre, elle a pu chercher sa spécificité à la suite de Dilthey dans la seule posture
intercompréhensive (Tu), herméneutique ou phénoménologique… Elle a pu chercher, comme
K.O. Apel, à fonder son ambition critique (Je) sur la dialectique entre expliquer et
comprendre. Jamais elle ne nous a convaincu, pas plus en séparant et en isolant (le
positivisme, l’herméneutique…) qu’en déniant la pertinence des séparations comme le fait
aujourd’hui Latour en récusant tout en la mobilisant sans cesse d’ailleurs la distinction entre
les faits et les valeurs.
Revenons-en maintenant à la sociologie et à la question de l’engagement du sociologue.
Par rapport aux conditions habituelles d’une conversation ordinaire, le sociologue possède un
avantage cognitif incontestable, un avantage qui bien évidemment ne le dispense pas pour
autant de se soumettre à l’exercice critique, y compris venant du citoyen ordinaire. C’est ce
que nous rappelle opportunément Dewey lorsqu’il souligne dans le même temps les capacités
d’enquête du citoyen ordinaire et les « avantages » des spécialistes qui ont approfondi,
formalisé et systématisé ce pouvoir d’enquête. Cet avantage cognitif se traduit
fondamentalement au niveau des dimensions objectivantes et intercompréhensives par rapport
auxquelles le sociologue a accumulé un savoir théorique et déployé d’importantes ressources
méthodiques. Il est donc bien placé pour apporter sa contribution aux descriptions et aux
explications des phénomènes sociaux, ou pour mettre au jour, révéler la manière dont les
acteurs vivent, comprennent, interprètent, ressentent… leurs situations. Là se situent déjà
d’importantes ressources critiques, non encore directement en termes de dénonciation, mais
déjà à la fois – dans la voie objectivante- en mettant au jour des faits ignorés, des
inexactitudes dans la description du monde, ou dans les explications de ce qui arrive, mais
aussi –dans la voie intercompréhensive- en révélant des formes ignorées, méconnues,
différentes… dans lesquelles se vivent des rapports au monde ou à des situations.
En prenant comme horizon de réflexion la conversation ordinaire, j’avais insisté sur
l’enchevêtrement des accentuations du langage référées aux trois pronoms personnels. Dans
les conversations ordinaires, nous ne critiquons pas arbitrairement. Nous le faisons toujours
aussi en référence à des descriptions et à des compréhensions du monde. Si nous admettons
cela nous saisissons immédiatement en quoi le travail sociologique constitue en soi une
ressource incomparable pour la critique, du simple fait qu’il nous offre des descriptions et des
explications mieux étayées, plus robustes et qu’il nous permet de mieux comprendre la
manière dont ceux dont nous parlons vivent, comprennent, interprètent, ressentent leur
situation.
Là commence donc à s’ouvrir une première porte de réponse à la question de la sociologie
publique. Celle-ci revient à se demander si, confronté à des situations telles que je viens de les
évoquer, le sociologue doit ou peut se taire, dès lors qu’il sait que les choses ne se passent pas

comme cela se dit dans la sphère publique, essentiellement dans le discours politique et dans
les présentations médiatiques, dès lors qu’il est convaincu que l’on se trompe sur ce que
pensent certaines populations, que l’on ignore ce qu’elles vivent ou ressentent… A moins
d’envisager qu’il puisse considérer les enjeux de validité et d’intercompréhension comme de
peu d’importance, ou comme ne concernant que lui-même et ses pairs – alors rappelons-le que
ces enjeux sont au fondement de ses investigations – on voit mal à tout le moins pourquoi le
sociologue s’interdirait ou se refuserait d’occuper le terrain public.
La figure du sociologue engagé qui se profile ici demeure toutefois limitée, puisqu’elle se
contente –ce qui n’est pas rien malgré tout- de mettre au jour des erreurs, de signaler des
méconnaissances… Bref des écarts à la réalité telle qu’il a pu, par son travail méthodique,
l’approcher.
Bien entendu, ces écarts, une fois mis au jour, deviennent des données que le sociologue peut
très naturellement être conduit à chercher à comprendre et interpréter. Là se manifeste alors
un approfondissement notable dans l’intensification de la critique. C’est ce qui sépare la mise
à plat d’une erreur ou d’un déficit de compréhension d’une part et d’autre part la dénonciation
de mensonges, de manipulations, ou encore pour prendre une autre illustration, ce qui sépare
la méconnaissance d’une souffrance et l’explication de sa production et de son occultation. Il
ne s’agit non plus ici de mettre à plat ce que j’appellerais génériquement un « déficit
cognitif » mais de montrer en quoi ce déficit cognitif est socialement constitutif, en quoi la
tromperie, l’occultation, la déformation et la manipulation de la « réalité », le refoulement de
certaines voix, de certaines expériences existentielles… sont des processus inhérents à la
logique sociale étudiée.
Autrement dit, parce que se situe au centre de ses ambitions celle d’objectiver ou de
comprendre ce qui se passe, la question de l’écart -mais aussi de sa compréhension- entre ce
que le social sait et dit de lui-même et ce qu’il en est réellement est une dimension
constitutive de la sociologie. Peu importe somme toute ici le statut qui sera donné à cet écart
entre les sociologies du dévoilement qui prêtent au seul sociologue des pouvoirs de
compréhension qu’ils dénient aux acteurs, et les sociologies qui, comme aujourd’hui les
sociologies pragmatiques, entendent plutôt, lorsqu’elles endossent un positionnement critique,
se faire le « relais » de voix minorisées, éteintes, bafouées, refoulées de l’espace public.
Ce dont il me paraît toutefois essentiel de se convaincre c’est, en raison de l’indépendance des
trois postures – même si elles se trouvent toujours enchevêtrées- que, dès lors que la critique
va au-delà de la mise à jour d’inexactitudes (sur le terrain objectivant du Il) ou de
mécompréhensions (sur le terrain intercompréhensif du Tu) et qu’elle endosse une position
normativement critique, par exemple en dénonçant des injustices, des oppressions… cette
position ne saurait à mon sens être de quelque façon déduite des deux autres postures, bien
que, comme je viens d’y insister, les apports de celles-ci puissent bien sûr parfaitement
l’étayer. Par exemple, la sociologie peut mettre en évidence que les ambitions démocratiques
par lesquelles l’école se présente comme un facteur d’émancipation sociale pour les enfants
des classes défavorisées ne sont en rien atteintes et que les inégalités sociales en réalité s’y
reproduisent, ce ne sont pas ces analyses qui nous permettent de déduire que l’école doive être
un instrument d’émancipation sociale.
Cette assertion quelque peu lapidaire et peut-être provocante mérite d’être éclaircie. Elle nous
permet d’avancer vers la mise en évidence de trois types de positions critiques que peut
adopter la sociologie. Pour en revenir aux ressources des conversations ordinaires et à la

tripartition du langage évoquée précédemment, on pourrait dire que la sociologie peut
montrer, du point de vue de l’objectivation (Il), que la société se trompe. S’il fallait
rassembler sous une même sémantique cette version de la critique, nous pourrions dire qu’elle
s’opère sous l’horizon de l’erreur ou de la fausseté. Limitée à cela l’ambition critique, sans
être négligeable, demeure faible. Sans multiplier les exemples on se convaincra que la
gouvernance par indicateurs, ou le gouvernement par pilotage qui se développe aujourd’hui
s’appuie précisément sur ce type d’internalisation d’une critique objectivante sans que l’on
puisse y voir un gain démocratique, que du contraire. Du point de vue cette fois des exigences
de l’intercompréhension et de la participation (Tu), la sociologie peut montrer que la société
non seulement se trompe mais qu’elle nous trompe. L’horizon critique n’est donc plus celui
de l’erreur mais celui du mensonge, de la manipulation, de la dissimulation… que ceux-ci
soient d’ailleurs intentionnels ou « systémiques ». Le prototype de cette critique se situe
évidemment dans le dévoilement idéologique qu’a popularisé la tradition marxiste. On sait
toutefois qu’il est possible de pratiquer le mensonge ou la dissimulation pour de bonnes
raisons et que dès lors leur mise en évidence ne constitue pas le dernier mot de la critique. La
dénonciation du mensonge dans ses différentes versions s’appuie sur des exigences
normatives liée à l’idéalisation de la relation intersubjective que, en reprenant la terminologie
souvent utilisée par Habermas, résume le mieux le terme « authenticité », une valeur qu’il
distingue systématiquement de la « justesse normative ». En effet, et du point de vue cette fois
de l’engagement normatif (Je), le sociologue peut s’engager en montrant que la société est
injuste, inacceptable normativement.
Peut-être la différence entre les sociologies qui se disent ou se revendiquent critiques réside-t-
elle dans le rapport qu’elles établissent entre les trois postures énoncées précédemment. Les
sociologies « critiques » seraient fondamentalement celles qui se construisent sous l’horizon
premier du Je, et donc d’un horizon de justice, à charge pour elles de ne pas pour autant
perturber les exigences spécifiques aux deux autres postures.
A cet égard, comme on l’aura compris, je demeurerais personnellement humien. Je ne pense
pas, je le répète, que ce troisième moment puisse être déduit des précédents, même si ceux-ci
peuvent bien entendu contribuer à étayer ce troisième type de positionnement critique.
Autrement dit, en ce troisième sens, la sociologie critique a à s’appuyer sur et à expliciter une
philosophie sociale dessinant les traits de ce que serait une société juste, fut-ce en s’appuyant
sur la dénonciation d’injustices. Il n’y a donc pas, à mon sens, d’obligation logique à ce que
les sociologues endossent ce type de postures. Mais, à mon sens également, il y aurait là
plutôt un impératif politico-éthique, dont on pourrait trouver une double justification. D’une
part dans la grande tradition sociologique, en se souvenant à quel point de telles exigences
politico-éthiques ont pu faire à la fois la richesse et l’intérêt des grands auteurs qui ont marqué
son histoire. Et d’autre part, dans des intuitions de justice que réactualisent sans cesse nos
fréquentations du social en nous convaincant que de fait, parce qu’elles nous révèlent des
situations insupportables, nous ne pouvons l’accepter tel qu’il est. De ce point de vue, il va
sans dire que les sociologues s’honorent en prenant publiquement la parole, et en la prenant
au double titre de citoyens sans doute, mais aussi de sociologues.
Bibliographie.
Genard, J.L. (1994), « Pour une approche pragmatique des discussions éthiques » dans les Actes
du colloque Variations sur l'éthique organisé en l'honneur de J. Dabin les 20, 21 et 22 avril 1994
par les Facultés Universitaires Saint-Louis, Presses universitaires des Facultés Saint-Louis,
Bruxelles, pp. 621-643
 6
6
1
/
6
100%