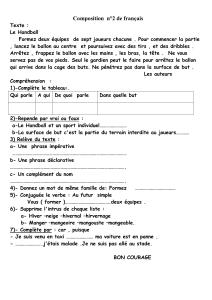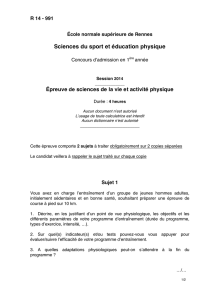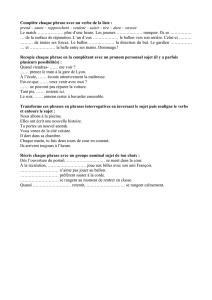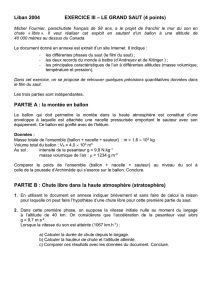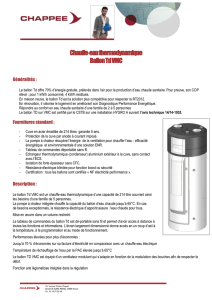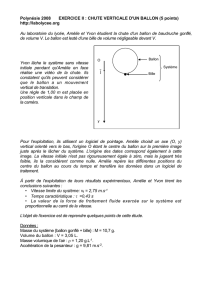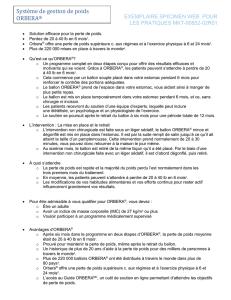Les ballons stratosphériques ouverts.


Résumé
Après avoir défini ce qu’est un ballon stratosphérique ouvert et décrit les différentes couches de
l’atmosphère dans lesquelles il est amené à évoluer, nous nous penchons sur la mécanique du vol de ce
ballon.
Nous détaillons principalement le rôle de la poussée d’Archimède, moteur du ballon, et l’évolution de
celle-ci au cours des différentes étapes du vol du ballon.
Nous en déduisons alors l’évolution de la vitesse ascensionnelle du ballon.
Chaque étape du vol est modélisée soit par une expérience, soit par un modèle numérique.
Enfin, un véritable ballon stratosphérique ouvert a été « lâché » (mais tenu par une ficelle, à cause de
problèmes d’autorisation de vol).
Problématiques du sujet
- Qu’est ce qu’un ballon stratosphérique ouvert ?
- Pourquoi et comment vole t-il ?
- Comment son utilisation peut-elle permettre à des lycéens de mieux comprendre quelques
caractéristiques de l’atmosphère terrestre ?

Sommaire
Introduction.............................................................................................................................................1
I. Conception d’un ballon stratosphérique ouvert ..........................................................................3
I.1. Choix du matériau ..................................................................................................................3
I.2. Réalisation de maquettes........................................................................................................3
I.3. Remarques...............................................................................................................................4
II. Le vol théorique d’un ballon stratosphérique ouvert..............................................................5
II.1. Présentation globale du vol ....................................................................................................5
II.2. La poussée d’Archimède : moteur du ballon........................................................................5
II.2.1. Définition..........................................................................................................................5
II.2.2. Conditions d’envol du ballon.........................................................................................5
II.2.3.1. Description de l’expérience....................................................................................6
II.2.3.2. Interprétation..........................................................................................................7
II.2.3.2.a. Mesure de la masse volumique de l’huile .........................................................7
II.2.3.2.b. Caractéristiques du flacon.................................................................................7
II.2.3.2.c. Masse volumique du flacon rempli....................................................................7
II.2.3.2.d. Mesure des volumes d’eau et d’huile nécessaires au décollage ......................7
II.2.3.2.e. Comparaison du poids du flacon et poussée d’Archimède..............................7
II.3. L’ascension du ballon.............................................................................................................7
II.3.1. Vitesse ascensionnelle dans la troposphère...................................................................9
II.3.2. Vitesse ascensionnelle dans la stratosphère..................................................................9
II.4. Le vol au plafond et la descente du ballon............................................................................9
III. Modélisations.............................................................................................................................10
III.1. Hypothèses.........................................................................................................................10
III.1.1. Influence de g.................................................................................................................10
III.1.2. Frottements de l’air ......................................................................................................10
III.2. Caractéristiques de notre ballon stratosphérique ouvert..............................................10
III.2.1. Caractéristiques géométriques.........................................................................................10
III.2.2. Mesure du coefficient de traînée Cx du ballon...............................................................11
III.3. Modélisation numérique de l’ascension de notre ballon ...............................................11
III.3.1. Modélisation de l’atmosphère concernée durant le vol.............................................11
III.3.1.1. Température de l’air dans la troposphère et dans la stratosphère ..................11
III.3.1.2. Pression de l’air.....................................................................................................12
III.3.1.3. Masse volumique de l’air......................................................................................14
III.3.2. Etude du mouvement vertical du ballon.....................................................................14
III.3.2.1. Masse volumique du ballon..................................................................................14
III.3.2.2. Calcul de la quantité de matière..........................................................................14
III.3.2.3. Vitesse ascensionnelle du ballon..........................................................................14
III.4. Modélisation du vol selon une maquette.........................................................................15
III.4.1. Cahier des charges et fabrication................................................................................15
III.4.2. Expérience......................................................................................................................15
III.4.3. Interprétation de l’expérience......................................................................................16
III.4.4. Améliorations de l’expérience précédente..................................................................16
III.5. Vol du ballon......................................................................................................................17
Conclusion générale et perspectives....................................................................................................18
Bibliographie et netographie................................................................................................................19
Annexe 1 : Feuille de calculs pour la modélisation............................................................................20
Annexe 2 : Photos de la fabrication de la première colonne.............................................................21
Annexe 3 : Photos de la fabrication de la deuxième colonne ............................................................22

1
Introduction
Un ballon stratosphérique ouvert est un ballon à gaz, c'est-à-dire que sa sustentation est due aux
caractéristiques des gaz dont il est rempli. Le ballon à gaz est un aérostat créé par le physicien Jacques Charles
avec l’aide des frères Robert et dont le premier vol avec passagers a été effectué le 27août 1783, 6 mois après
qu’une montgolfière ait emmené des personnes pour la première fois dans les airs. Plus tard, les ballons à gaz
eurent surtout la fonction d’élévation d’hommes dans les airs comme pendant la première guerre mondiale pour
surveiller les tranchées adverses. Aujourd’hui ils servent comme aérostat pour l’aviation de loisirs mais
d’autres sortes de ballons servent à des missions scientifiques. En effet, ces ballons sont des moyens peu
coûteux de mener des expérimentations spatiales et atmosphériques et ainsi valider les mesures des satellites.
Trois types de ballons aux caractéristiques et objectifs différents sont lâchés pour ces missions.
Type de ballon Volume Altitude Masse
embarquée Durée de vol Utilisation
Ballon dilatable Inférieur à 10
m
3
Environ
40 km Inférieure à 3
kg 2 à 3 heures Sondages météorologiques
Ballon pressurisé Inférieur à
500 m
3
Inférieur à
20 km Environ 5 kg Quelques
jours à trois
mois
Etude de l’atmosphère et
du mouvement des masses
d’air
Ballon
stratosphérique
ouvert
De 3000 m
3
à
1 200 000 m
3
15 à 40
km 50 à 2500 kg De 7 à 24
heures
- Etude de la chimie et la
physique de la stratosphère
- Astronomie
Intéressons nous particulièrement aux ballons
stratosphériques ouverts.
Les ballons stratosphériques ouverts ont commencé
à être utilisés aux Etats-Unis en 1947 et en France, les
premiers lâchés ont été effectués en 1962.
Le ballon stratosphérique est une enveloppe de
polyéthylène contenant de l’hélium ou du dihydrogène.
Le ballon est dit ouvert quand sa partie inférieure
communique avec l’extérieur, nous verrons pourquoi
dans la partie suivante. Ces ballons sont de grandes
tailles puisqu’ils ont un volume qui varie de 3000 à
350 000 m
3
(soit un diamètre de 20 m et une surface de
toile utilisée d’environ 2,5 hectares.
Leur altitude de vol varie de 11 à 50 km et leur
grand avantage est qu’ils permettent d’embarquer des
charges de matériel scientifique très importantes
pouvant aller jusqu’à 2500 kg. Cependant, leur durée de
vol est limitée puisqu’ils ne peuvent voler plus de 24
heures (sauf de nouveaux ballons qui peuvent atteindre
quelques jours de vol mais guère plus).
Intéressons nous désormais à la couche d’atmosphère concernée par le vol de tels ballons

2
La couche d’atmosphère concernée par le vol
Durant son vol, le ballon stratosphérique ouvert traverse deux couches principales de l’atmosphère. Il décolle
dans la troposphère, et, à 11 km d’altitude, il entre dans la stratosphère. Il convient donc d’expliquer les
caractéristiques de ces couches, dont les caractéristiques sont des facteurs qui influent sur le vol des ballons.
Tout d’abord intéressons nous à la troposphère. C’est une couche variant de 8 km (aux pôles) à 15 km (à
l’équateur) d’altitude. Dans cette couche, la température varie proportionnellement avec l’altitude. En effet, elle
perd environ 6,4 °C tous les 1000 m jusqu’à atteindre des températures inférieures à -50 °C. Cette température
varie aussi avec la pression. La pression diminue fortement avec l’altitude, passant d’environ 1013 à 200 hPa :
on note que 75% de la masse de l’air de toute l’atmosphère se trouve dans la troposphère. Enfin, c’est dans cette
couche que se situent les nuages ainsi que tous les grands mouvements atmosphériques et les turbulences liées
au relief et au climat.
Quand il arrive à environ 11 km d’altitude, le ballon franchit la tropopause, limite de la troposphère et
de la stratosphère. La caractéristique principale de la stratosphère est qu’elle est dynamiquement stable. Au
niveau de la tropopause, il se produit un changement : la température remonte. En effet la stratosphère est
réchauffée par le rayonnement ultraviolet du soleil. La couche d’ozone, couche stoppant une grande partie des
rayons ultraviolets provenant du soleil (préservant ainsi la troposphère de ces rayons) est située dans la
stratosphère, de 12 à 30 km d’altitude environ, et n’empêche pas ou peu le réchauffement dans cette couche.
Ceci explique en partie, avec des échanges complexes de chaleur avec les autres couches, la température
presque constante dans les basses altitudes de la stratosphère (de 11 à 35 km) ainsi que le réchauffement régulier
et croissant avec l’altitude au dessus de 35 km (plus l’altitude est élevée, moins les rayons ont traversé d’ozone).
Concernant la pression dans la stratosphère, elle diminue aussi avec l’altitude jusqu’à atteindre des chiffres de
1hPa dans ses plus hautes couches vers 50 km.
Ces baisses de pression et de température entraînent que la masse volumique de l’air diminue avec
l’altitude. En effet elle passe d’environ 1 kg/m
3
au sol à presque 0,001 kg/m
3
aux plus hautes altitudes de la
stratosphère.
Maintenant que nous savons ce qu’est un ballon stratosphérique ouvert et que nous connaissons les
caractéristiques de son milieu d’évolution, tentons de comprendre pourquoi et comment le ballon vole.
Tout commence par la conception d’un ballon stratosphérique ouvert. Nous nous intéressons ensuite à la
poussée d’Archimède et à son rôle dans les différentes phases du vol du ballon. Enfin, n’ayant pas pu réaliser un
véritable vol, nous avons modélisé numériquement le vol du ballon que nous avons construit et nous avons
confronté nos résultats à ceux obtenu lors des expériences réalisées avec une maquette.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%