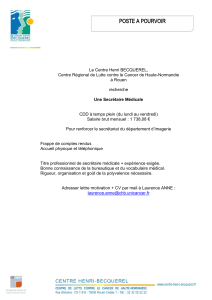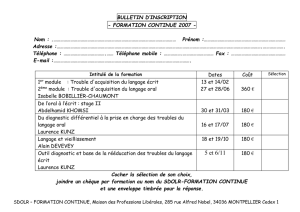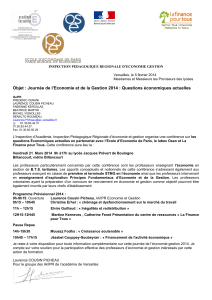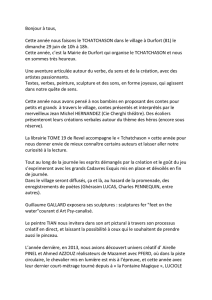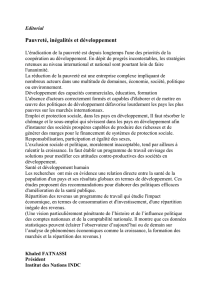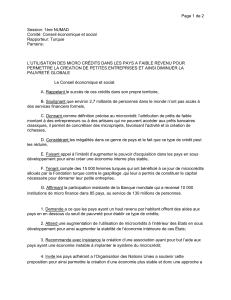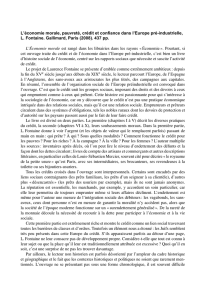L`économie morale : pauvreté, crédit et confiance dans l`Europe

1
L’économie morale : Pauvreté, crédit
et confiance dans l’Europe préindustrielle
BIM n° - 06 janvier 2009
Marc ROESCH
«La dette est un lien social ». Si « l’inclusion financière » des populations européennes est
acquise, si cette inclusion est quelque peu « désincarnée » (qui connaît encore son ban-
quier ?), le « lien social » a quasiment disparu. En matière de microfinance la question du
lien social et de la « morale » dans l’inclusion financière » fait débat. Il a semblé intéres-
sant, pour ceux qui n’ont pas forcément le temps d’écumer les librairies ou de surfer sur les
sites des libraires, de présenter aujourd’hui un livre qui vient de sortir sur cette question de
dette et de morale et qui jette un œil historique sur ce qui s’est passé en Europe.
Le BIM d’aujourd’hui vous donc présente un résumé commenté du livre «L’économie mo-
rale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle » par Laurence Fontaine du
CNRS et édité chez Gallimard (437 pages 19 € environ). Ce résumé a été publié par « non-
fiction.fr le quotidien des livres et des idées» par Sarah Abdelnour que l’on peu trouver sur
http://www.nonfiction.fr/article-1918-la_dette_a_travers les_ages.htm
Nous y joignons un commentaire d’un lecteur qui complète cette analyse.
L’économie morale : Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe
préindustrielle
Une vaste étude historique sur les mécanismes du crédit et de la confiance dans l'Europe
moderne.
Tout échange est aussi un échange de valeurs. C’est ce que Laurence Fontaine entend
essentiellement par la notion d’« économie morale », titre du nouvel ouvrage de cette his-
torienne, directrice de recherche au CNRS, et spécialiste de l’histoire socio-économique
de l’Europe moderne. L’ouvrage résulte d’une vaste étude portant sur l’Europe moderne,
et centrée sur les mécanismes du crédit et de la confiance. Le crédit et l’endettement, ins-
crits au cœur des relations sociales, sont envisagés comme une des principales stratégies
de survie, pourtant peu étudiée à ce jour. Laurence Fontaine se propose ainsi d’examiner
les logiques à l’œuvre dans les relations de crédit, du côté des emprunteurs (nobles comme
pauvres) et des créanciers, mais aussi de l’État et de l’Église. La dette est ainsi envisagée
comme un « lien de vie et nœud de mort », mécanisme très diffusé car indispensable, qui
suppose une certaine intégration dans des réseaux sociaux, mais néanmoins porteur de
domination économique et de stratégies politiques. Le crédit serait alors pris entre des
économies politiques divergentes et coexistantes : une économie politique aristocratique

2
fondée sur la personnalisation du don et une économie politique capitaliste fondée sur
l’impersonnalité et le calcul.
L’étude sur l’Europe préindustrielle est très riche et abondamment documentée, avec des
sources couvrant une zone géographique assez vaste sur une période relativement longue,
du XVIe au XVIIIe siècle. Mais la particularité de l’analyse de Laurence Fontaine réside
dans un effort constant de faire dialoguer disciplines et époques. Elle emprunte ainsi aux
sciences sociales contemporaines certains concepts et théories, liés notamment au don et
aux réseaux. Et elle lance des ponts entre les époques, en s’interrogeant sur les stratégies
de survie et sur le rôle du marché face à la pauvreté. Ce dialogue prend notamment la
forme d’une discussion, qui relève davantage de la confrontation, avec Polanyi et ses héri-
tiers, défenseurs d’une « Autre Économie ». Dès l’introduction, Laurence Fontaine fait en
effet part de ses doutes quant aux vertus morales et protectrices d’une économie « encas-
trée » au sens de Polanyi, c’est-à-dire enchâssée dans les relations sociales, et non auto-
nomisée. Voyons plus en détail l’analyse qu’elle propose des relations de crédit et de con-
fiance dans l’Europe moderne. L’auteur présente d’abord les logiques de la dette en fonc-
tion des milieux sociaux, avant de s’intéresser aux débats autour de l’usure, puis de pré-
senter les deux économies politiques qui coexistent dans l’Europe moderne.
Un endettement généralisé et stratégique
L’Europe préindustrielle se caractérise sur le plan économique par l’absence de prévision
et une forte instabilité. L’endettement est donc généralisé dans cette économie de
l’aléatoire. Mais ce qui est plus surprenant, c’est que ce ne sont pas les plus démunis qui
sont endettés. En effet, l’accès au crédit suppose de détenir des relations sociales stables,
et surtout, de détenir du crédit (au sens symbolique, qui est devenu le sens secondaire au-
jourd’hui mais qui était le sens principal dans l’Europe moderne) auprès de ces relations.
Le deuxième étonnement provient de la longue durée de l’endettement, et de la tolérance
vis-à-vis des délais de remboursement.
Cette tolérance, notamment de la part des créanciers nobles, s’explique par la fonction
sociale de la dette pour le créancier : il s’assure ainsi de la main-d’œuvre à son service, et
se prémunit alors contre l’incertitude. Laurence Fontaine démontre de la sorte la préémi-
nence du rôle social de la dette sur son rôle économique. Elle examine ensuite les logiques
de la dette au sein de plusieurs milieux : les paysans, les élites, les populations urbaines, et
notamment les femmes des villes. À la campagne, les paysans s’endettent auprès de la
famille et des élites directes. Cet endettement est stratégique pour les créanciers qui, même
s’ils ne récupèrent pas toujours leurs créances, parviennent ainsi à gagner des points dans
les luttes féroces entre élites locales. Mais la dette peut aussi être une stratégie pour les
paysans, puisqu’elle constitue l’assurance d’une protection du seigneur. Les élites ne
jouent toutefois pas uniquement le rôle de créanciers dans l’Europe moderne, loin s’en
faut. L’auteur nous rappelle en effet l’endettement croissant des aristocraties européennes
aux XVI et XVIIe siècles, situation qui bouscule les hiérarchies sociales, en renforçant
notamment une partie de la bourgeoisie.

3
L’épineuse question de l’usure
Le crédit est également partie prenante de la vie urbaine, comme l’illustre la diffusion des
crédits dans le commerce alimentaire, entre grossistes et détaillants, comme entre détail-
lants et clients. Le prêt sur gage est une pratique très diffusée dans toute l’Europe, opérée
par des intermédiaires que sont les courtiers et les revendeuses à la toilette. Les premiers
échangent des billets et lettres de change contre des marchandises, tandis que les secondes
opèrent dans l’espace privé, en assurant achat et revente de vêtements et bijoux
d’occasion. Le point commun de ces pratiques réside dans leur informalité et absence de
régulation, synonyme de taux usuraires. Laurence Fontaine estime que ces usuriers ne dé-
rangent pas tant les emprunteurs, ni certains conseillers du roi (comme Turgot qui estime
que le taux d’intérêt est une simple compensation du risque, ou encore Necker), mais ils
sont en revanche la bête noire des philanthropes et des religieux. Ces derniers vont alors se
mobiliser pour la création de monts-de-piété, censés assurer aux pauvres l’accès au crédit
dans de meilleures conditions. Les premiers monts-de-piété apparaissent en Italie et en
Espagne au XVe siècle dans une logique de charité. Mais ils déclenchent par endroits de
vives polémiques quant à l’acceptabilité d’un taux d’intérêt. Il faut donc attendre 1 777
pour qu’un mont-de-piété soit créé à Paris. L’acceptation d’un taux d’intérêt se fait pro-
gressivement alors que le crédit quitte le giron de l’Église, et entre dans celui de l’État.
Le combat entre don et marché, ou quand le capitaliste prend le dessus
sur l’aristocrate
Dans les huitième et neuvième chapitres, Laurence Fontaine étudie en détail les deux éco-
nomies politiques déjà évoquées : l’aristocratique et la capitaliste, au niveau des représen-
tations et des pratiques. Elle mobilise dans un premier temps des sources littéraires pour
décrire ces deux économies, et illustrer leur coexistence conflictuelle. Timon d’Athènes,
pièce de Shakespeare datant de 1623, illustre alors l’impossibilité de vivre la culture aris-
tocratique dans un monde de plus en plus soumis au fonctionnement capitaliste. La pre-
mière reposant sur l’amitié et le risque, l’imprévisibilité et le temps long ; tandis que la
seconde repose sur l’impersonnalité et le calcul. Mais si les valeurs de la première peuvent
sembler supérieures, Laurence Fontaine nous rappelle les enjeux politiques de ces sys-
tèmes d’échanges, et estime que l’impersonnalité du marché est un vecteur puissant de
démocratie, tandis que le don personnel entretient l’aristocratie.
Si la culture capitaliste gagne du terrain au cours de l’époque moderne, les pratiques de
crédit restent fortement ancrées dans les relations sociales. Ainsi, l’attribution de crédits
ne se décide pas en fonction d’un calcul rationnel, mais en fonction d’intérêts sociaux,
politiques ou moraux. La réputation reste le critère de décision principal, or celle-ci repose
essentiellement sur l’interconnaissance et sur des comportements jugés moraux : être
fidèle, pieux… Les faillites touchent ainsi d’abord les outsiders, et non pas les plus endet-
tés. Les pratiques capitalistes (comptabilité, prévision…) sont davantage des marqueurs
sociaux, qui permettent paradoxalement aux personnes qui les affichent de ne pas être trai-
tées rationnellement, puisqu’on leur fait alors confiance.
La conclusion se veut un aller-retour entre l’Ancien Régime et le XXIe siècle. Elle est
essentiellement une critique des héritiers de Polanyi, tenants d’une « Autre Économie ».

4
Laurence Fontaine se montre assez sévère envers ce qu’elle considère être un regard nos-
talgique vis-à-vis d’une économie du don et des réseaux qu’elle juge pour sa part porteuse
de domination et d’exploitation. Elle se livre alors à une réhabilitation du marché, qui
pourrait selon elle fonctionner au bénéfice de tous. D’une part, elle réitère sa croyance
dans le fait que le marché serait porteur de démocratie (le cas de la Chine aujourd’hui peut
nous laisser sceptique…). Elle juge d’autre part que l’accès au marché fait partie des stra-
tégies de survie, et qu’il faut lutter contre une évolution historique qui tend à exclure les
pauvres du marché. Il faut ainsi selon elle « démocratiser l’accès au marché des moins
bien armés, alors que ressurgit la précarisation des parcours de vie. » Elle se félicite alors
du succès actuel du microcrédit, ou encore de l’essor des marchés (non-professionnels) de
l’occasion.
Un dialogue entre époques et disciplines stimulant mais parfois frustrant
Nous nous permettrons, pour finir, deux critiques à l’égard de ce riche essai. La première
revient à dire que cet ouvrage a les inconvénients de ses avantages. Laurence Fontaine a
tenté l’ambitieux pari de faire dialoguer époques et disciplines, ce que nous ne pouvons
que saluer. Il s’agit toutefois d’une entreprise périlleuse, qui montre parfois ses limites. Je
précise ici que j’écris en tant que sociologue, ce qui ne peut manquer d’influencer mon
point de vue. Si l’étude historique semble très documentée et solide, les ponts avec la
sociologie et l’anthropologie sont un peu rapides pour être pleinement efficaces. Elle se
réfère ainsi beaucoup à la notion de « don », et mobilise les réflexions des anthropologues
sur cette question (Geertz, Mauss) mais de manière partielle et très allusive. De la sorte,
elle ne conserve de Mauss que la forme agonistique du don, le potlatch, et non sa forme
pacifique, la kula. En outre, elle tend à confondre don et charité, alors même que cette
distinction est centrale chez Mauss. C’est justement ce qui permet à ce dernier de proposer
un système de protection sociale à partir de ses travaux sur le don. Laurence Fontaine, en
ne conservant que la dimension guerrière du don, le discrédite évidemment plus facile-
ment.
Son pari de faire dialoguer les époques repose sur un intérêt pour les stratégies de survie.
Elle se montre alors volontiers critique envers une historiographie qui se serait trop con-
centrée sur les politiques publiques et l’État-providence, laissant ainsi de côté le champ de
la « débrouille ». Si le constat est vrai, nous ne sommes toutefois pas convaincus de la
possibilité de comparer les stratégies de survie, en n’accordant presque aucun intérêt aux
changements de cadres politiques, si profonds soient-ils.
La seconde critique s’applique à la conception que l’auteur propose du monde actuel. Elle
se réjouit en effet de la « réappropriation du marché par les individus » aujourd’hui, en
prenant comme exemple l’essor des vide-greniers, du commerce d’occasion sur internet
ou encore du microcrédit. Il s’agit selon elle de stratégies de reconquête du marché, dans
un contexte de précarisation de la société. Son optimisme ne me semble pas réellement
justifié, dans la mesure où les pauvres n’ont accès qu’aux rebuts du marché, à ses franges
non rentables, dangereuses et pénibles. Et encore, ils n’y accèdent souvent que de manière
illégale, avec les dangers et limites de ces pratiques. L’auteur résiste ainsi indéniablement
au misérabilisme, mais au risque d’une vision biaisée de la réalité sociale.

5
Rédacteur : Sarah ABDELNOUR, Critique à nonfiction.fr L’économie morale. Pauvreté,
crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle Auteur : Laurence Fontaine. Éditeur :
Gallimard. Collection : NRF Essais. Date de publication : 18/09/08. N° ISBN : 2070785777
Réaction d’un lecteur : 15/12/08 13:00
Chaque lecteur s’approprie le livre en fonction de ses intérêts et cette diversité des lectures,
que les comptes-rendus restituent, est un vrai plus pour les lecteurs. Mais le plaisir s’arrête
quand on fait dire au livre ce qu’il ne dit pas et c’est ce qui se passe dans le résumé de la con-
clusion qui devient, sous la plume de Sarah Abdelnour, une machine de guerre contre les Al-
termondialistes et une apologie du marché et du microcrédit. Or, les critiques qu’elle formule
ensuite s’appuient pour l’essentiel sur cette conclusion.
Le lecteur attentif que je suis se doit donc de résumer la première partie qu’elle a ignorée. Elle
s’ouvre par une réflexion sur la pauvreté et ses définitions et dit : « La question essentielle à
l’intelligence de notre sujet est donc celle du risque et de l’incertitude, de l’efficacité des
réseaux sociaux, et des manières dont le statut et les rôles sociaux des individus influaient sur
leur capacité d’agir. Des réponses à ces questions dépend la plus ou moins grande capacité des
pauvres à sortir de la misère et à organiser un futur qui puisse prévenir qu’ils n’y retombent
(p. 309-310) ». Elle entame ensuite un dialogue avec les Altermondialistes pour rappeler que
les réseaux qui sont si importants dans leur vision d’une économie autre peuvent être porteurs
de solidarité mais également de dépendance. Elle constate qu’hier comme aujourd’hui, les
«pauvres » développent des stratégies de survie qui reposent sur la multiplication des sources
de revenus et remarque que l’accès au marché en est un élément essentiel. Mais elle souligne
que tous n’y ont pas accès et qu’en outre, autour de ce désir de marché une finance informelle,
foisonnante et usuraire se développe. Elle parle ensuite des expériences du microcrédit (Gra-
meen Bank et monts-de-piété), des débats que l’activité suscite (est-ce une activité charitable
ou une activité bancaire ?) et montre qu’aux difficultés de fonctionnement s’ajoutent des ques-
tions d’efficacité : « il ne suffit pas de se procurer du capital pour réussir une entreprise, même
si l’idée de départ est bonne. Il faut aussi du savoir-faire, du pouvoir-faire et, éventuellement,
des réseaux d’appuis. Ces trois éléments dépassent le seul cadre de l’action économique puis-
qu’ils touchent à l’éducation, aux droits des individus, aux rôles sociaux et au capital social
(p. 317) ». Elle insiste alors sur la nécessité d’une approche en termes de « capabilités » pour
comprendre le prix que les individus payent du fait de leur marginalisation politique, juridique
et économique comme de leurs handicaps physiques. Elle rappelle le chapitre V qui montre
que du fait de leur manque de « capabilités », les femmes n’entrent dans le marché que dans
des positions toujours marginales et elle ajoute que « ce sont les transformations de la société,
avec la reconnaissance d’un statut, l’égalité juridique proclamée des femmes et des hommes et
l’accès à l’éducation, qui ont changé leurs capacités à sortir de la pauvreté plus que toutes les
expériences économiques réussies qu’elles ont pu conduire ici ou là. Ce constat dit clairement
que le microcrédit n’est pas un remède miracle (p. 319) ». Pour conclure cette première moitié
de l’introduction, elle revient sur les enjeux des définitions de la pauvreté : « cessons de
regarder la pauvreté comme un état auquel il faut remédier et le pauvre comme un patient qu’il
faut soigner ; tenons la pauvreté pour ce qu’elle est : un phénomène dynamique, à la fois un
risque dont il faut comprendre les modalités de l’incertitude et l’ensemble des stratégies que le
pauvre pourra lui opposer dans l’espace que lui délimiteront les blocages physiques et cultu-
rels, institutionnels et économiques, qui tous à leur tour inhibent sa capacité d’action (p.
321) ». Ensuite seulement, la conclusion discute la position des Altermondialistes qui refusent
 6
6
1
/
6
100%