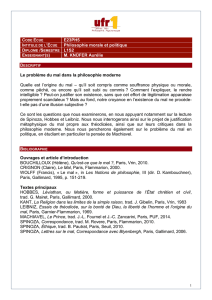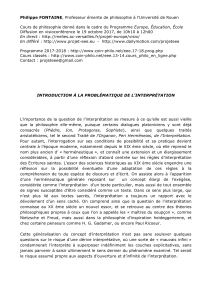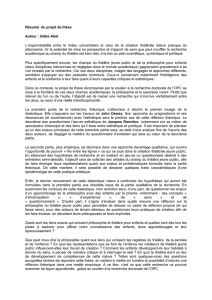Plan de cours - UQAM | Département de philosophie

1
UQAM Plan de cours
PHI-4333
PHILOSOPHIE ET LITTERATURE
Session : Hiver 2009
Code du cours : PHI 4333 (Groupe 50)
Horaire : Vendredi 14.00-1700
Local : DSN-440
Responsable : Mario Dufour
Téléphone : 987-3324 (boîte vocale : 9360)
Courriel : dufour.m@uqam.ca
DESCRIPTION (du cours selon l'annuaire)
« Présentation des différentes façons dont la philosophie peut se situer par
rapport à la littérature, compte tenu de la double direction de cette relation :
constitution d’une philosophie ayant la littérature pour objet ; position de la
philosophie parmi les genres littéraires. Exploration des contributions de la
philosophie à la théorie littéraire (esthétique, herméneutique, logique de la
fiction). Thématisation des aspects littéraires de l’exercice de la philosophie :
sémiotique et rhétorique de la philosophie. »
PROBLEMATIQUE ET CONTENU
Même si la littérature demeure un objet apparemment marginal de la philosophie, la
réflexion philosophique sur la littérature est aussi ancienne que la philosophie elle-même. Faut-il
rappeler la position de Platon sur la place de la poésie et de l’art dans la définition inaugurale de la
philosophie pour s’en convaincre ? La philosophie n’a eu de cesse, dans son articulation parfois la

2
plus décisive et la plus fondamentale, de se définir par rapport à la littérature. Se définissant en
définissant la littérature pour s’en démarquer et imposer sa délimitation. En effet, la réflexion
philosophique sur la littérature est aussi ancienne que le souci pour la vérité arrachée aux ombres de
l’illusion et à la volonté de dépassement du mythe par la raison. Et si l’infériorisation classique de
l’art en général qui en découle, lequel fut à l’origine associé au domaine de l’illusion, de
l’apparence, du mensonge et de la sophistique par Platon, précéda son autonomisation critique ainsi
que sa survalorisation romantique, rien ne permet de conclure dans ce coup de force fondateur de la
philosophie à un simple rapport d’extériorité, de disjonction ou d’opposition pure et simple. Trop
souvent le rapport entre littérature et philosophie est interprété comme un rapport entre philosophie
ou littérature, entre sérieux ou frivolité, vérité ou imaginaire, réel ou apparence, science ou art, et
ainsi de suite.
Aussi la littérature elle-même est-elle une expérience de pensée et certaines oeuvres
littéraires, le plus souvent les meilleures et les plus universelles, possèdent une valeur philosophique
manifeste et par conséquent on ne saurait tout à fait exclure du mode de présentation théorique
dominant de la philosophie tout rapport à la « littérarité ». La littérature n’est pas la philosophie,
mais aucune philosophie n’est tout à fait différente de la littérature ou indifférente à la littérature, ne
fut-ce que parce qu’elle partage la même condition de possibilité et d’historicité : être archive, texte,
inscription. Inversement, aucune littérature n’est indifférente à la prétention de vérité de la
philosophie. La littérature ne saurait par conséquent être simplement un « objet » extérieur à la
philosophie ou à l’esthétique, ou encore à une philosophie de la littérature. D’autre part, et la
conséquence s’impose, la littérature et la philosophie n’existent pas au sens d’objet naturel aux
propriétés stables, ce sont des archives, des institutions, les résultats de certaines conventions et de
certaines interprétations, lesquelles varient au cours de l’histoire.
C’est dans cette optique que nous aborderons le thème d’une relation de corrélation réciproque
entre philosophie et littérature. À l’évidence, ces rapports entraînent un champ d’investigation
possible immense, sans doute incontrôlable puisqu’ils touchent aux fondements mêmes de la pensée.
Où commencent et où finissent l’expérience littéraire et l’expérience philosophique ? On peut partir
de la littérature pour mettre en lumière sa valeur philosophique (dans sa forme et/ou son contenu), ou
son rapport à la philosophie, ou, à la l’inverse, partir de la philosophie pour mettre en valeur sa
dimension littéraire ou son rapport à la littérature. Sans perdre de vue la dimension historique et la
complexité du problème nous favoriserons surtout dans le cadre de ce cours et tout en l’adoptant
comme fil directeur de ce rapport, les développements de la pensée française contemporaine, laquelle
ne cessera d’interroger, à partir du Qu’est-ce que la littérature? (1948) de Sartre, l’expérience de la
littérature d’un point de vue philosophique.
Nous aborderons dans le cours quelques-uns des moments les plus marquants de ce
développement : la phénoménologie du « néant » de Sartre (1905-1980) et l’existentialisme de Camus
(1913-1960) ; la phénoménologie de l’expression de Merleau-Ponty (1908-1961) ; la pensée de l’autre

3
de Lévinas (1905-1995) ; la pensée de l’espace littéraire et de l’expérience de la mort de Maurice
Blanchot (1907-) ; la déconstruction et la pensée de l’écriture de Jacques Derrida (1930-2004),
l’archéologie de Michel Foucault (1926-1984) et l’herméneutique de Paul Ricoeur (1913-2005). Enfin
nous insisterons sur le débat entre le développement de la pensée française et l’éthique de la
discussion (Habermas) dans le cadre du problème qui oppose esthétisme (critique de la rationalité) et
modernisme (défense de l’idéal de la modernité).
OBJECTIFS
Ce cours vise à introduire et à initier ses participants aux enjeux, aux questions et aux problèmes que
posent certains des philosophes dont les réflexions sur la littérature sont marquantes. Il vise à fournir
aux participants les outils nécessaires à la compréhension de certains des grands moments du
développement des rapports entre la littérature et la philosophie et, sur cette base, à les conduire non
seulement à une saisie plus juste et plus satisfaisante des contributions de ces penseurs, mais
également à une réflexion sur leurs limites et les objections qu’ils suscitent.
Types d'activités d'enseignement
À chaque cours, il y aura un exposé magistral de la part du professeur. Les étudiants sont invités à
intervenir pendant les cours en vue de poser des questions, d’éclaircir les problèmes traités ou pour
communiquer leurs réflexions sur la matière du cours. La deuxième partie de la session sera consacrée
à des ateliers de discussion pilotés par le professeur autour de présentations orales des étudiants
portant sur les textes à l’étude. La possibilité reste ouverte d’inviter des conférenciers.
EVALUATION
1. Participation active aux ateliers de discussion et une présentation orale (de type compte
rendu critique ou de type « réflexion libre ») de l’un des textes au programme des ateliers de
discussion notée Succès ou Échec. Ces présentations (10 à 20 minutes environ) serviront de base
aux ateliers de discussion. Elles peuvent servir d’assise pour la rédaction d’un compte rendu
critique écrit et/ou d’élément générateur pour la dissertation finale. Les participants de chaque
atelier devront se rencontrer préalablement pour préparer minimalement l’ordre de leurs
interventions lors de la séance de discussion : 20%

4
2. Un compte rendu critique (5 pages) d’un des textes au programme (ou de tout autre matériel
pertinent mais accepté par le professeur) à remettre à la mi-session ou après les ateliers de
discussion : 30%
3. Évaluation finale (50%) à remettre au dernier cours de la session
1. Soit deux comptes rendus critiques (5 pages chacun pour 25% de la note globale) portant
sur des textes au programme du cours ou de tout autre matériel pertinent accepté par le
professeur
2. Soit une dissertation personnelle (10 pages et plus) pertinente — à partir d’un ou de
plusieurs des textes au programme, ou de tout autre matériel pertinent dûment accepté par le
professeur et valant pour : 50% de la note globale
Exigences du cours.
Présence et participation aux ateliers. La réflexion libre est une présentation pertinente d’un
aspect, de questions, d’impressions générées par le texte à l’étude servant à stimuler la discussion.
Le compte rendu critique vise à souligner l’essentiel d’un texte et à en apprécier la valeur (aspect
critique). La dissertation finale est un travail écrit qui consiste à présenter de manière organisée et
réfléchie le fruit de vos recherches et de vos lectures personnelles. Elle approfondit un thème ou un
aspect pertinent selon une problématique définie chez un auteur ou à confronter des auteurs entre
eux à partir d'une problématique commune, et doit conduire à une appréciation critique du
contenu discuté.
Les travaux seront évalués à partir des critères classiques : la pertinence et la rigueur de la
pensée, la clarté de la formulation et la consistance de l'argumentation, l’esprit critique et créatif
dont ils feront montre. En outre, la qualité de l’expression (orthographe, syntaxe, style) sera prise en
considération. Les travaux devront tous être remis à la date exigée, à moins d'exception justifiée
(papier du médecin, etc.).
CALENDRIER
1. Présentation du cours. Bibliographie commentée
2. Philosophie et littérature : une perspective historique
3. Existentialisme et phénoménologie de la liberté : Camus et Sartre

5
4. Merleau-Ponty : phénoménologie de la perception et de l’expression
5. Lévinas : phénoménologie de l’autre et la question de l’oeuvre
6. Blanchot : la pensée de l’espace littéraire
7. Derrida et la déconstruction de la métaphysique. L’archéologie de Michel Foucault
8. Semaine de lecture
9. Ricoeur : l’herméneutique du soi et le rôle de la fiction
10. Atelier I : Sartre et Camus : Qu’est-ce que la littérature? et le Mythe de Sisyphe
11. Atelier II : Merleau-Ponty : « Le langage indirect et les voix du silence »
12. Atelier III : Lévinas : « Sens et signification », « La réalité et son ombre »
13. Atelier IV : Blanchot : « La littérature et le droit à la mort »
14. Atelier V : Derrida et Foucault : « Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation » ;
« La pensée du dehors », « La folie, l’absence d’œuvre »
15. Atelier IV : Ricoeur : « La fonction herméneutique de la distanciation », « Narrativité
phénoménologie et herméneutique »
Textes à l’étude
Un recueil de textes qui suit le développement du cours sera disponible à la COOP UQAM.
Parmi ceux-ci certains serviront de base aux ateliers de discussion de la session.
1. SARTRE, J.-P., « Qu’est-ce qu’écrire ?», dans Qu’est-ce que littérature? (1948), Gallimard, Idées,
1975, p. 11-48. CAMUS, A., « La création absurde », Le mythe de Sisyphe (1942), Paris, Gallimard,
Folio, 1994, p. 127-159.
2. MERLEAU-PONTY, M., « Le langage indirect et les voies du silence » (1951), Signes, Paris,
Gallimard, 1960, 49-104.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%