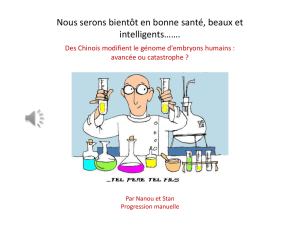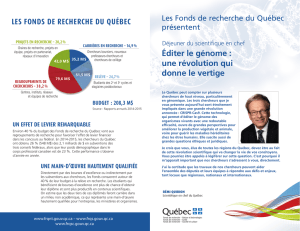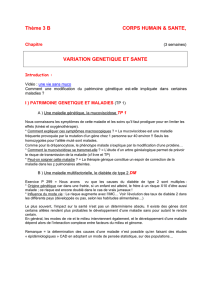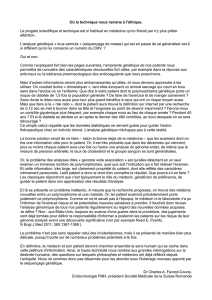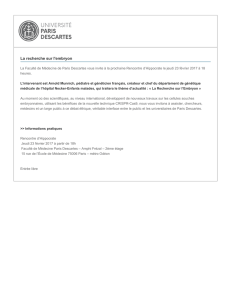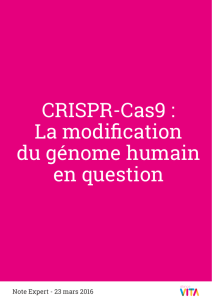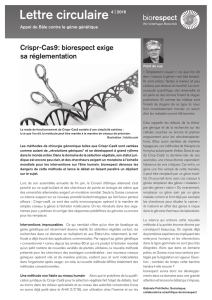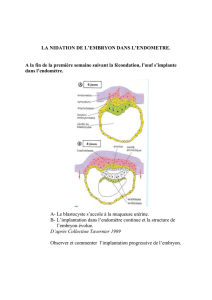Lire l`article

8 | 0123
Mercredi 13 avril 2016 | SCIENCE & MÉDECINE |
Dimensions
Hauteur
12 m 48 m
Diamètre
3 m 3,7 m
Masse de la charge lancée, en tonnes
(au moment de la séparation)
5 130
Moteur
1 9
Poussée, en tonnes-force
50 450
Altitude maximale, en km
104 200
Vitesse maximale
Mach 3 Mach 5,5 à Mach 7,5
SOURCES : SPACE X ; BLUE ORIGIN
INFOGRAPHIE : HENRI-OLIVIER
Texas Floride
Deux ambitions rivales
Blue Origin comme Space X ont réussi à faire atterrir leurs
fusées verticalement, mais les deux exploits n’ont pas tout à fait
la même valeur : le New Shepard (Blue Origin) ne fait qu’atteindre
la frontière de l’espace (100 km) avant de retomber vers son point
de départ, quand le premier étage du Falcon 9 (Space X) propulse
une lourde charge utile en orbite, avant de se retourner
pour atterrir sur une barge dans l’océan Atlantique.
New Shepard
New Shepard
(Blue Origin)
Freinage
à 1 km
d’altitude
Ascension
Ascension
Séparation
de la capsule
Vol suborbital
Séparation
deuxième étage
à environ 70 km
Deuxième
étage
Atterrissage
de la capsule
Rotation
Cargo Station
spatiale
internationale
Succession
de freinages
moteurs
Freinage
final
Déploiement
d’aérofreins
100 km100 km
Atterrissage
8 min 37 sec
après décollage
Atterrissage
11 min
après décollage
Océan Atlantique
Environ 300 km
Barge
Falcon 9
Falcon 9,
premier étage
(Space X)
Si les progrès de la génétique ont coutume
d’agiter les communautés scientifiques et
de sciences humaines et sociales, la nou-
velle technique du genome editing, ou
d’« ingénierie ciblée du génome », soulève
d’intenses polémiques. Cas9 est une
nucléase capable de couper les deux brins de la molé-
cule d’ADN. L’intérêt du système Crispr-Cas9 est d’être
guidé par une courte séquence d’ARN qui positionne
très précisément Cas9 là où l’expérimentateur sou-
haite introduire la coupure. Ces guides ARN sont peu
onéreux et aisés à produire. Une fois l’ADN coupé, il
est réparé voire remplacé par une séquence d’ADN
choisie. Par son efficacité et sa simplicité de réalisa-
tion, cette technique offre une perspective d’applica-
tions médicales inaccessibles jusqu’à présent.
Notre groupe de travail conjoint, associant la
Société française de génétique humaine (SFGH) et la
Société française de thérapie cellulaire et génique
(SFTCG) mis en place mi-2015, souhaite contribuer au
débat qui est ouvert à ce sujet, en France, par l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques et l’Académie nationale de méde-
cine. Ce groupe de chercheurs et de professionnels
de la génétique, de la reproduction et des sciences
humaines et sociales a généré une position com-
mune dont les fondements ont été discutés lors de
deux réunions scientifiques et qui sera proposée
pour adoption aux deux sociétés savantes. Ce travail
s’ancre dans une analyse rigoureuse de l’état de l’art
scientifique, seule à même de permettre une identi-
fication précise des enjeux d’encadrement des déve-
loppements de cette technologie.
La controverse majeure concerne la possible appli-
cation de Crispr-Cas9 à l’embryon humain et aux cel-
lules germinales rendant possible la transmission à
la descendance d’une modification génétique. Un
consensus sur l’interdiction de telles manipulations
s’est maintenu jusqu’à présent, d’autant que ces mo-
difications n’étaient pas réalisables par manque d’ef-
ficacité et de précision des techniques. Mais la révo-
lution technologique que représentent le système
Crispr-Cas9 et ses dérivés remet en cause ce statu
quo. Si une nouvelle technologie très précise et sûre,
efficace et facile à mettre en œuvre existe, est-il légi-
time de maintenir cette interdiction ? La recherche
pour explorer les stratégies possibles est indispensa-
ble si l’on souhaite améliorer l’efficacité de la techni-
que tout en diminuant ses risques.
Pratiques médicales
Le potentiel thérapeutique de
la technologie Crispr-Cas9 n’est certes pas à envisa-
ger uniquement sous l’angle des modifications
transmissibles à la descendance, mais ces dernières
soulèvent les questions les plus aiguës en pratique.
Aujourd’hui, le diagnostic pré-implantatoire ou le
diagnostic prénatal permettent à des couples qui sont
à risque élevé de transmettre une maladie génétique
grave et incurable, d’avoir des enfants indemnes de la
pathologie. La technologie Crispr-Cas9 permettrait de
corriger le défaut génétique chez des embryons at-
teints, dans le cas où le diagnostic génétique pré-im-
plantatoire n’identifie pas d’embryon indemne.
Enjeux sociétaux
Cette technologie permet aussi
d’envisager le scénario de modification des caracté-
ristiques ou capacités des individus humains dans
des domaines variés, des frontières du médical aux
performances d’ordre physique ou intellectuel.
Mais dans ce domaine, le niveau des connaissances
scientifiques et la force du déterminisme génétique
sont souvent surévalués. Les caractères complexes
sont en règle générale multifactoriels. En outre, de
tels scénarios sont sans précédent et risquent de
créer ou d’aggraver des inégalités sociales. Appli-
quée à l’ingénierie du génome humain, la technolo-
gie Crispr-Cas9 donnerait accès à un éventail d’ap-
plications potentielles, allant de la naissance d’un
enfant en bonne santé pour un couple qui n’aurait
pas pu en avoir sans cela, à l’« homme augmenté ».
Faut-il interdire la première application pour éviter
toute dérive vers la seconde ?
Enjeux juridiques
Le droit a posé des régimes d’inter-
diction forts dans le domaine des modifications géné-
tiques de l’embryon humain. Ces interdits ont été
pour partie levés concernant la recherche sur l’em-
bryon humain et la procréation, mais différemment
selon les pays européens. En France, les textes qui
s’appliquent, dans le domaine de la recherche et dans
celui des applications médicales (aide médicale à la
procréation, AMP), laissent persister des ambiguïtés.
L’analyse des dispositions du code civil, du code de la
santé publique ou encore de la Convention d’Oviedo
(articles 8 et 13) tendrait à interdire une partie des acti-
vités de recherche utilisant l’ingénierie ciblée du gé-
nome dans le contexte de l’embryon humain. Est-il
donc nécessaire de réfléchir à une éventuelle modifi-
cation de la loi ou simplement de la clarifier, au regard
des activités scientifiques actuelles et de la nécessaire
protection de l’individu et de l’espèce humaine ?
Nos propositions
Reconnaissant la responsabilité
qui découle de la façon dont les experts parlent des
technologies, l’expression « ingénierie ciblée du
génome » a été choisie en raison du champ large re-
couvert. L’expression « chirurgie du génome » a
paru adaptée si l’on désigne les applications théra-
peutiques.
L’interprétation du cadre réglementaire actuel de
la recherche sur la modification du génome de l’em-
bryon humain ou des cellules germinales humaines
devrait être clarifiée, en levant les ambiguïtés et en
identifiant le périmètre des recherches possibles.
Sans présumer de la décision de la société concer-
nant l’utilisation de ces techniques en clinique hu-
maine, toute application de l’ingénierie ciblée du gé-
nome dans le contexte de l’AMP est actuellement
prématurée pour des raisons méthodologiques. Des
travaux de recherche pour en améliorer l’efficacité et
l’innocuité sont indispensables avant de pouvoir en-
visager leur utilisation, pour des indications limi-
tées, sur des bases solidement documentées.
La recherche utilisant l’ingénierie ciblée du gé-
nome de l’embryon humain, des cellules germinales
humaines ou de leurs précurseurs devrait donc, avec
un encadrement strict, être autorisée, ce qui pour-
rait nécessiter une modification législative.
La réflexion sur les indications médicales poten-
tielles doit être menée dès à présent, via des recher-
ches en sciences humaines et sociales et des débats
impliquant toutes les parties prenantes de la société.
Un moratoire à un usage clinique de cette techno-
logie ne nous semble pas pertinent, dans la mesure
où un tel usage est de facto interdit en France en
l’état actuel de la loi et de la convention d’Oviedo.
Nos propositions visent ainsi à promouvoir une
recherche responsable, capable d’anticiper les con-
séquences sociétales de ses développements, ayant,
comme objectif, une protection tant individuelle
que collective. p
« Ce travail s’ancre dans
une analyse rigoureuse de l’état de l’art
scientifique, seule à même
de permettre une identification
précise des enjeux
d’encadrement des développements
de cette technologie »
¶
Groupe de travail
conjoint sur
« l’ingénierie ciblée du
génome de l’embryon et
des cellules germinales :
actualités sur
les recherches et
applications envisagées
chez l’homme » des
Société française
de génétique humaine
(présidente : Anne
Cambon-Thomsen) et
Société française de
thérapie cellulaire
et génique (président :
Pierre Cordelier),
Emmanuelle
Rial-Sebbag
(correspondante).
> Sur Lemonde.fr
L’intégralité des signataires.
Le système Crispr-Cas9 révolutionne les capacités d’intervention sur notre patrimoine génétique.
Deux sociétés savantes proposent des pistes pour mieux cerner les promesses et les risques de cette chirurgie du gène
Ingénierie du génome : il faut clarifier le cadre réglementaire
|t r i b u n e |
Le supplément « Science
& médecine » publie
chaque semaine une
tribune libre ouverte au
monde de la recherche.
Si vous souhaitez
soumettre un texte,
prière de l’adresser à
Les fusées réutilisables, chasse gardée américaine
Vendredi 8 avril, Elon Musk a tenu
son pari : reposer verticalement le
premier étage de sa fusée Falcon 9
sur une barge, au large de la
Floride, tandis que le reste du
lanceur mettait correctement en
orbite une capsule destinée à
ravitailler la Station spatiale
internationale. Cette réussite fait
suite à quatre tentatives
infructueuses, le long cigare ayant
alors explosé à l’impact. Elle
suggère que les fusées réutilisables
ne sont peut-être pas une utopie.
Moins d’une semaine auparavant,
le patron d’Amazon, Jeff Bezos,
avait eu la satisfaction de voir se
reposer pour la troisième fois en
moins de cinq mois la même fusée
New Shepard, après un vol d’une
dizaine de minutes qui l’avait
conduite au-delà des 100 km
d’altitude, frontière officielle de
l’espace. Ce triple retour à bon port,
même s’il ne s’agit que de vols
suborbitaux, crédibilise les projets
de tourisme spatial de sa société
Blue Origin, qui espère lancer des
vols commerciaux en 2018.
L’ambition d’Elon Musk est tout
autre : abaisser encore les coûts
des lancements commerciaux
en réutilisant un élément-clé
des lanceurs qui, jusqu’alors, était
perdu lors de la rentrée dans
l’atmosphère. Reste à prouver
qu’un premier étage ainsi récupéré
sera aussi fiable qu’un neuf.
Arianespace en doute et ne prévoit
pas cette option pour sa future
Ariane 6, attendue sur le marché
en 2020. p hervé morin
1
/
1
100%