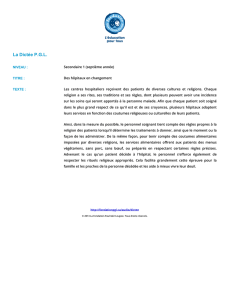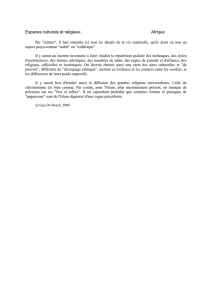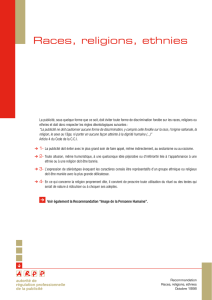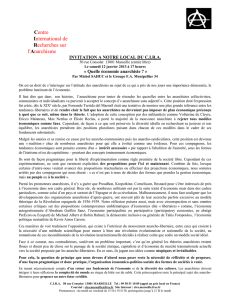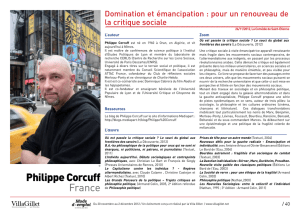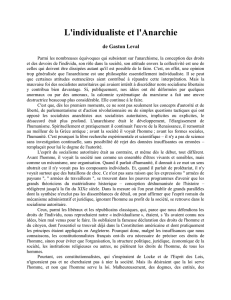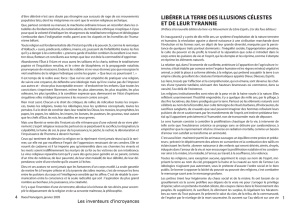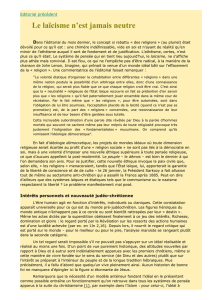Réponse à Philippe Corcuff - Monde

Réponse à Philippe Corcuff
Le Monde libertaire a publié dans son numéro du 16-22 octobre 2014 un article de
Philippe Corcuff intitulé « Les religions sont-elles solubles dans la réaction ? » et
curieusement sous-titré « Les agnostiques sont-ils de misérables traîtres à la cause
anarchiste ? » Cet article fait suite à des échanges qui ont eu lieu sur le site interne de
la Fédération anarchiste. Je propose ici une réponse à cet article, en tenant pour acquis
que le lecteur aura pris connaissance du texte de Philippe Corcuff qui en est le
déclencheur.
« Dieu existe, parce qu’il est parfait ;
car s’il n’était pas parfait, il n’existerait pas. »
Dans les périodes de crise, de régression de la pensée critique et d’expansion de la
réaction, les militants révolutionnaires peuvent en arriver à douter de leurs convictions
athées et matérialistes et, par souci de conformisme, ils finissent par se demander s’il
n’y a pas un peu de vrai dans le discours de la réaction triomphante dont ils finissent par
être imprégnés.
J’ai fortement l’impression qu’on est dans cette situation aujourd’hui.
L’imprégnation du religieux est tellement forte que certains camarades en arrivent à
relativiser l’importance de l’athéisme dans le fondement doctrinal de l’anarchisme par
crainte de se trouver marginalisés alors même que dans ces périodes de recul il faut
affirmer clairement nos principes. Mais en réalité le religieux ne semble fort
aujourd’hui que parce qu’il est extrêmement bruyant.
Je ne saisis pas très bien ni les intentions, ni la démarche de Philippe Corcuff.
Et je saisis encore moins la chaîne argumentative de son raisonnement.
En dehors du fait qu’il se proclame agnostique, je crois comprendre qu’il voudrait
que le mouvement anarchiste, et la FA en général, s’ouvre aux croyants, et qu’il ne
verrait pas d’un mauvais œil que des chrétiens et des musulmans adhèrent à la FA. Cette
attitude se rattache au courant de relativisme général qui domine aujourd’hui, qui me
semble à l’opposé de l’attitude libertaire telle que je la conçois.
Si on s’en tient au plan philosophique, je pense qu’on ne peut pas être anarchiste et
agnostique, parce que l’agnostique est celui qui considère que Dieu est un être
inconnaissable et qu’on ne peut pas dire s’il existe ou non. Or j’ai un peu tendance à
penser que si Dieu est inconnaissable, c’est là malgré tout une manière de dire qu’il
existe. Jusqu’à présent, je pensais que l’anarchiste n’était pas seulement athée, mais
qu’il était
contre
la croyance en un être suprême auquel l’homme doit, par définition,
soumission. C’est en tout cas ainsi que les anciens m’ont présenté les choses lorsque j’ai
adhéré au mouvement libertaire dans les années 60.
Quoi qu’on en dise, si Dieu existe, l’homme lui est soumis. Cela implique donc de la
part des anarchistes une prise de position claire. L’anarchisme ne peut pas se contenter
d’avoir une « incertitude structurelle quant à l’existence des dieux », comme le dit
Corcuff, parce que l’anarchisme est une doctrine matérialiste qui récuse l’idée de cause
première, c’est-à-dire l’idée d’un créateur, autrement dit Dieu :
« Les matérialistes sont révolutionnaires. Ils nient Dieu, ils nient la Cause
première. Ils ne se contentent pas de la nier, ils en prouvent l’absurdité et
l’impossibilité
1
. »
1
Bakounine,
L’Empire knouto-germanique
, Appendice 5. Philosophie, science.

2
Il n’y a donc pas de place pour le doute sur l’existence ou l’inexistence de Dieu. En
déclarant « invérifiable », dit encore Bakounine, l’existence de la cause première, les
positivistes de son temps (et les agnostiques d’aujourd’hui), ne nient pas l’existence de
la cause première, ils l’excluent seulement du domaine scientifique : « ce qui veut dire,
en simple langage humain, que cette Cause première existe
peut-être
, mais que l’esprit
humain est incapable de la concevoir. » Les théologiens sont très satisfaits de ce constat,
dit encore Bakounine,
« car ils ont toujours proclamé que la pensée pure ne peut rien sans l’aide de
Dieu, et que pour reconnaître la Cause première, l’acte de la divine création, il faut
avoir reçu la grâce divine. C’est ainsi que les positivistes ouvrent la porte aux
théologiens et peuvent rester leurs amis dans la vie publique, tout en continuant de
faire de l’athéisme
scientifique
dans leurs livres. Ils agissent en conservateurs
politiques et prudents
2
. »
Voilà qui expose clairement, je pense, la position anarchiste sur Dieu, la cause
première, etc. Et sur ceux qui ne prennent pas clairement position dans le débat.
Maintenant, Corcuff est-il un « social-traître », comme il le dit dans son article ? C’est
lui qui pose le problème dans ces termes, pas moi. Pour moi, c’est quelqu’un qui n’a pas
compris l’enjeu d’un des fondements les plus essentiels de l’anarchisme,
dont
l’athéisme n’est qu’un « produit dérivé »
: le matérialisme ; ou ce que Bakounine
appelait le « matérialisme scientifique », qui ne reconnaît tout simplement pas la
pertinence du concept « Dieu ».
Si Bakounine se prononce clairement contre l’existence de Dieu, il s’intéresse en fait
beaucoup plus aux raisons qui poussent les gens à croire en cette entité transcendante.
Mieux vaut essayer de comprendre pourquoi les gens croient en Dieu (ou pourquoi des
camarades comme Corcuff ne veulent pas prendre position). Bakounine tente de resituer
la religion dans sa perspective historique et anthropologique : elle est une étape dans le
lent développement de l’humanité sortant des ténèbres de l’ignorance. La religion n’est
en fait pas tant « une aberration de l'esprit qu'un profond mécontentement du cœur »
(
Dieu et l’Etat
). Elle est une protestation instinctive de l’homme contre son existence
misérable. Dieu est une création humaine, il est l’image renversée et agrandie de
l’homme.
Maintenant, nous avons un Philippe Corcuff, frais émoulu dans le mouvement
anarchiste, qui semble vouloir remettre en cause un certain nombre de fondements
essentiels de l’anarchisme. C’est un peu comme si j’adhérais à une religion avec
l’intention de lui faire accepter l’idée que Dieu est inconnaissable. Je pense que la
réaction des fidèles ne se ferait pas attendre. Eh bien, Corcuff n’a pas été exclu de la
Fédération anarchiste, et je pense que personne n’y songe.
Ce qui me rend perplexe, c’est la manière dont Corcuff argumente. Il semble vouloir
nous mettre en garde contre « le double risque essentialiste et substituiste ».
Tout est parti d’un livre de Stéphane Lavignotte, pasteur, théologien et militant de la
« gauche radicale et écologiste », nous dit Corcuff. Lavignotte pense, en gros, que les
religions peuvent être réactionnaires, mais qu’elles peuvent également être subversives.
Corcuff pense que « cette seconde possibilité semble s’opposer à un des “principes de
base
3
” de la FA, “la lutte contre les religions et les mysticismes” ».
Voilà un curieux raisonnement. En somme, le constat que les religions peuvent être
(
à l’occasion
, je précise) « subversives » (sans qu’on nous donne aucune illustration de
ce propos), infirme les principes de base de la FA : il faut donc les changer.
2
Ibid.
3
Les « Principes de base » de la Fédération anarchiste sont un document assez court dans lequel
sont consignés sommairement les principes essentiels auxquels se réfèrent les militants de
l’organisation, et quelques règles basiques de fonctionnement. Il ne s’agit pas à proprement
parler de statuts. Juste des… principes de base.

3
D’abord, si on pense aux religions dans le sens général, c’est-à-dire ayant des
effectifs importants (par opposition à certaines sectes), elles ne sont jamais globalement
progressistes. Les religions ne sont pas des entités homogènes, elles sont parcourues de
courants souvent vigoureusement opposés les uns aux autres. Certains courants à
l’intérieur des religions peuvent être plutôt libéraux, d’autres carrément réactionnaires.
Il est donc totalement incongru de dire que « certaines religions peuvent être
progressistes ». Tout au plus peut-on dire que dans l’immense éventail des Églises qui
encombrent le marché de la foi, c’est bien le diable si on ne trouvera pas quelques
individus ou quelques groupes défendant des positions progressistes. Pas de quoi
changer les principes de base de la FA.
Cela ne signifie pas pour autant que les anarchistes doivent rejeter ces croyants
« subversifs » lorsqu’ils les côtoient dans leur activité quotidienne. Le fait que
Lavignotte consacre six pages de son livre aux « anarchistes croyants » ne change pas
grand-chose à l’affaire.
Toutes les grandes doctrines politiques et sociales trouvent des interprètes qui, dans
leurs marges, en acceptent les grandes lignes mais qui divergent sur certains points. On
aura donc des marxistes chrétiens, des anarchistes chrétiens, et des marxistes libertaires,
etc. Le fait que Tolstoï et quelques autres comme Dorothy Day fassent une
interprétation chrétienne de l’anarchisme, ou introduisent quelques petits morceaux de
Bon Dieu dans l’anarchisme, est un phénomène intéressant, mais marginal. Cela
parlerait plutôt en faveur de l’anarchisme, d’ailleurs, car cela montre qu’il y a dans cette
doctrine quelque chose d’à peu près universel. Mais évoquer Tolstoï ne suffit pas pour
diluer l’anarchisme dans la religion et ne justifie pas qu’on modifie les «Principes de
base »…
En fait il y a deux questions, et malheureusement elles ne sont pas toujours
différenciées :
a)
Peut-on être anarchiste et croire en Dieu ?
b)
Peut on être anarchiste et faire un bout de chemin avec les croyants ?
Je répondrai non à la première question et oui à la seconde.
L’athéisme selon moi est consubstantiel à l’anarchisme, comme les frites le sont au
steak. Pour expliquer ça il faudrait se lancer dans des digressions philosophiques : je
me contenterai de dire qu’athéisme et matérialisme vont de pair ; que la croyance en
un dieu est une question de
foi
, qui sort de toute approche rationnelle ; qu’il ne sert à
rien d’essayer de prouver que Dieu n’existe pas puisqu’il est impossible de
prouver
l’inexistence d’une chose qui n’existe pas.
Lavignotte, nous dit Corcuff, appelle à « une approche laïque du fait religieux ». Je
ne sais pas trop ce que ça veut dire. Que signifierait, par exemple, une « approche laïque
de l’Opus Dei » ? Lavignotte veut qu’on analyse de manière laïque les faits religieux.
Mais c’est ce que font les anarchistes tous les jours : leur regard sur les religions est le
regard de personnes qui ne croient pas en Dieu.
Lavignotte, dit encore Corcuff, veut « désessentialiser » les religions
4
. Là, ça se
complique. En philosophie et en théologie, l’essence est ce qui constitue la nature d’une
chose, ce qui est immuable, par rapport à ce qui est transitoire et périssable ; ce que
Bakounine appelle « l’être intime des choses ». Pour les croyants, Dieu est l’essence
première de toute chose. Dieu seul est existant par essence, dit Descartes. Comme dit
4
L’essentialisme est un terme ambigu, un peu fourre-tout, qui relève soit de la philosophie,
soit de la biologie. Le terme a été utilisé en 1945 par Karl Popper dans
La Société ouverte et ses
ennemis
, un ouvrage en deux volumes qui est une critique virulente de Platon, de Hegel et de
Marx. Selon Popper, l’essentialisme a été un facteur majeur de stérilité dans les sciences et dans
la philosophie. Le sens dans lequel Corcuff emploie ce terme ne me semble pas le même que
celui de Popper.

4
Corcuff, une essence est « une entité homogène et durable ». Le problème, c’est que la
notion de Dieu est inséparable de celle d’essence. Si on veut « désessentialiser » les
religions, on veut donc des religions… sans Dieu !
Mais pourquoi « désessentialiser » les religions ? Parce que celles-ci se manifestent
de manières diverses, historiquement et socialement : parfois elles sont réactionnaires,
parfois progressistes, parfois elles sont entre les deux, nous dit Corcuff.
Considérons les religions comme des institutions regroupant des partisans qui
partagent un certain nombre de présupposés idéologiques, parmi lesquels la croyance en
un être suprême, un Dieu, lequel Dieu est l’« essence de toute chose » et le créateur de
toutes choses. Considérons que ces institutions aient dans la pratique des
comportements très variés, parfois « progressistes », parfois « réactionnaires ». Est-ce
que cette variété de comportements change quelque chose au fait que ces religions sont
fondées sur la croyance en un Dieu, « essence de toute chose » ? Bien sûr que non.
Les différentes manières par lesquelles les religions se manifestent relèvent de la
contingence : cela ne permet en rien de comprendre la nature réelle des religions, ce
qu’elles sont réellement, bref leur essence. On ne peut pas « désessentialiser » quelque
chose qui par définition relève de l’essence. Mais il est vrai que si on ne s’intéresse pas
à l’essence de la religion – à l’essence de Dieu, pour être plus exact – il n’est plus
nécessaire de vouloir comprendre de quoi il s’agit : si Corcuff et Lavignotte veulent
pouvoir analyser les religions dans leur activité réelle et leur apposer un label
progressiste ou réactionnaire, il est nul besoin de s’occuper de leur « essence », il suffit
tout simplement de les observer et de leur appliquer la bonne vieille méthode
expérimentale. C’est au fond ce qui ressemblerait le plus à une « approche laïque du fait
religieux ».
Je n’ai aucune intention de m’engager dans un débat sur l’anti-essentialisme de
Wittgenstein dont je ne vois pas ce qu’il vient faire ici, car ce penseur s’attache
essentiellement aux questions de langage. Ce qui chagrine Corcuff, me semble-t-il, c’est
qu’on puisse parler de « religion » et d’« anarchisme » en considérant ces
« substantifs » comme des appellations générales, et non comme des concepts dans
lesquels on peut insérer tous les contenus qu’on veut. Il est évident que ce genre de
démarche convient très bien à quelqu’un qui veut introduire la religion dans le concept
d’anarchisme, par essence athée.
La référence à Wittgenstein ne me paraît pas pertinente pour ce que je crois
comprendre être le propos de Corcuff. Disons pour aller vite qu’il y a eu un mouvement
intellectuel tendant aux grandes synthèses, à la généralisation, à la construction de
grandes machineries théoriques dans lesquelles il semblait que la réalité quotidienne et
triviale était avalée. Hegel entre parfaitement dans cette catégorie. L’un des plus féroces
adversaires de ce mouvement est sans doute Karl Popper qui, dans
La société ouverte et
ses ennemis
, s’en prend à Platon et Hegel et Marx.
En réaction, s’est créé un mouvement inverse prônant la fin des idéologies, tendant à
la « déconstruction. On ne cherche plus l’« essence » des phénomènes sociaux, on prône
l’étude des micro-événements. Avec la fin des idéologies est venue la fin des certitudes
et on prône un relativisme général très à la mode chez nos postmodernes.
Quelle pourrait être la position anarchiste, là-dedans ? Tous les grands penseurs
anarchistes, malgré leurs différences, en tenaient pour la méthode expérimentale :
autrement dit, on observe un phénomène et on l’analyse, on note les constantes de ce
phénomène, on fait une synthèse et on détermine la « loi » de ce phénomène, jusqu’à ce
qu’elle soit contestée par une autre série d’observations et d’hypothèses qui rende
mieux compte du phénomène observé. Il ne s’agit donc pas, pour les anarchistes, de se
soumettre au « constant désir de généralisation », ni au « mépris pour les cas
particuliers », pour reprendre les termes de Wittgenstein repris par Corcuff, comme si
c’étaient là les deux seules options possibles. Il me paraît difficile de comprendre un
phénomène social si on ne se livre pas à la fois à l’analyse des « cas particuliers » et à la
« généralisation », c’est-à-dire à la synthèse. Corcuff veut nous entraîner dans une voie
totalement stérile où il n’y aura plus que les « cas particuliers » et où il ne sera plus

5
possible de raisonner en terme de « générique ». Ce qui est assez cohérent avec l’air du
temps, où la notion de générique, c’est-à-dire la capacité à théoriser, semble échapper à
beaucoup de monde. Les « dépôts de pains » ont remplacé les « dépôts de pain ».
Il y a un paragraphe de l’article de Corcuff que je ne comprends pas. Je vais le citer
en entier :
« Mais une telle approche essentialiste des religions, tendant à les diaboliser, ne
doit-elle pas rendre le militant de la FA plus autocritique quand il veut suivre le
principe de base associé à “la lutte contre les religions” : la lutte contre “les
mysticismes” ? N’y aurait-il pas un peu de “mysticisme” dans l’essentialisation des
religions ? C’est-à-dire qu’un certain athéisme militant peut (pas nécessairement)
être emprunt de dogmatisme. “Dogmatisme” renvoie à “dogmes”, souvent entendus
comme des principes intangibles non discutables ; principes beaucoup usités dans les
églises, mais aussi dans les organisations politiques jusqu’aux organisations
anarchistes, voire aux anarchistes indépendants. Et ces dogmes peuvent aussi
susciter dans des cadres laïcs des sortes d’“excommunications”. »
Je ne vois pas en quoi le fait d’avoir une « approche essentialiste » des religions
conduit
nécessairement
à les diaboliser. Je pense au contraire que chercher à saisir
l’essence d’une religion, c’est contribuer à la comprendre – quitte à la critiquer
ensuite.
Ensuite Corcuff nous dit que la « lutte contre les religions » proclamée dans les
principes de base de la FA doit être dissociée de la « lutte contre les mysticismes »,
suggérant qu’il n’approuve pas la première mais qu’il approuve la seconde. Car
analyser les religions dans leur essence est du mysticisme, nous dit Corcuff, en
résumé. Malheureusement, je ne vois pas comment on pourrait échapper à l’analyse
de l’essence des religions qui se fondent sur l’existence d’un dieu qui est par
définition une essence – mais il est évident que si on ne peut plus définir les choses,
cela clôt le débat, puisqu’alors il ne reste plus des religions que leurs « petits cas
particuliers », leurs actes particuliers qui peuvent être qualifiés, selon les cas, de
« subversifs » ou « réactionnaires ».
Mais ce n’est pas fini. L’essentialisation des religions, qui conduit les militants de
la FA au mysticisme, conduit également au dogmatisme.
En religion, les dogmes sont des affirmations qui fondent lesdites religions. Cela
dit, en opposition au catholicisme, qui est une « religion d’autorité », chez les
protestants un dogme est un énoncé provisoire. En philosophie, c’est autre chose, le
dogmatisme est une philosophie de la connaissance selon laquelle l’homme peut
parvenir à la vérité au moyen de la raison. Ce n’est évidemment pas dans ce sens-là
que Corcuff emploie le mot.
Selon Corcuff, les anarchistes sont soumis à la tentation d’une progression
insidieuse : essentialisme → mysticisme → dogmatisme → excommunications.
En somme, l’approche dogmatique de la FA sur l’essence des religions conduit
(conduira ?) celle-ci à des « excommunications » (exclusions ?). De qui ? De
Corcuff ? A la FA, on n’exclut pas aussi facilement.
Il faut tout de même garder à l’esprit que l’accusation de dogmatisme est souvent
la tarte à la crème de tous ceux qui veulent modifier les principes sur lesquels se
fondent une organisation et qui se heurtent à un refus. C’est un peu ce qui se passe
avec l’agnosticisme de Corcuff. Sont ainsi qualifiés de dogmatiques ceux qui ne
veulent pas remettre en cause le fondement athée de la FA (et de l’anarchisme en
général), afin d’introduire une pincée de christianisme et d’islam etc.
Le fait qu’une organisation ait des statuts, ou quelque chose d’équivalent,
définissant un certain nombre de principes généraux, est assez banal, et je ne pense
pas qu’on puisse accuser de « dogmatiques » ceux qui tiennent à ces principes et sont
réticents à les modifier, sauf raison impérieuse. Je suppose que personne n’aurait
l’idée de noyauter l’Église catholique avec l’intention de lui faire abandonner le
 6
6
 7
7
1
/
7
100%