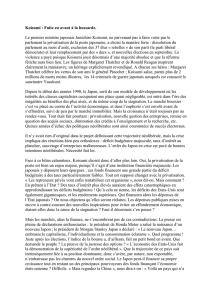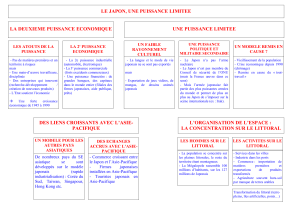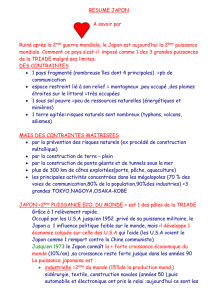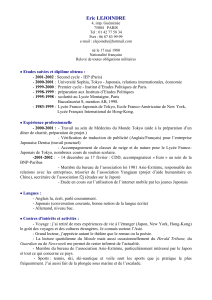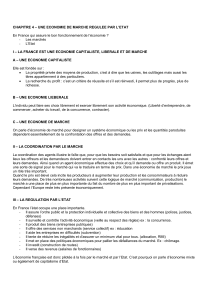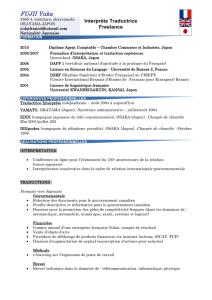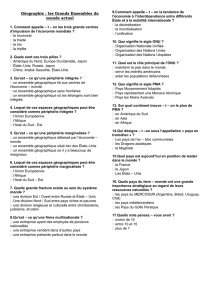Modernisation et valeurs culturelles de diverses sociétés d`Asie et

9ñ \hU
IQQi
STY
89
90
1
s
n
s
¿
0 JAN.
i«?***
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
MODERNISATION ET VALEURS CULTURELLES DE DIVERSES
SOCIETES
D'ASIE
ET DU PACIFIQUE
•
rni - ^
%
,2022 "9
•
^
rs.
/
',
«"L
Processeur SteDhen H.K. YEH
Université d'Hawaii
Manoa (Hawaii, Etats-Unis)
Unesco 1989
Les idées et opinions exprimées dans le présent document sont celles
de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de 1'Unesco.

Nombreux.sont les chemins qui" mènent au sommet de la montagne, et nombreuses
.les-montagnes
qui;
mènent au
ciel.
Herman Kahn .
I.
:••
INTRODUCTION - .
..,','
Aux term'es du mandat qui nous a été assigné, notre tâche, dans le cadre du
présent document,' consiste à entreprendre une étude comparative sur les modalités
d'interaction entre modernisation et valeurs culturelles au sein de différentes
sociétés,
à analyser, dans ce contexte, l'interaction entre les modes de vie, les
formes d'organisation sociale et les différents stylés dé développement, puis à
étudier- les: interrelations entre les aspects économiques, sociaux, politiques et
spirituels d'une-approche intégrée et mültidimensionhelle du développement, et
enfin,,
.à
voir quels» enseignements peuvent étire tirés de cette comparaison, compte
tenu de la pertinence des théories et des exigences de la réalité.
Etant donné -l'ampleur de la tâcher nous avons pris la liberté d'organiser
notre réflexion autour des grands axes suivants : (1) mesure' dans laquelle la
vision systémique du
monde-•
capitaliste permet de mieux
'
comprendre le changement
social à l'échelon d'un pays ; (2) analyse, à partir de cette vision, des voies du
développement au Japon et en" Chine ; (3) évaluation de l'expérience de développe-
ment,
de
l'Asie
de l'Est, à la lumière des relations entre les institutions écono-
miques,
politiques et culturelles (confucianistes) ; (4) évolution récente de. la
Thaïlande en matière d'économie politique, résultant de l'interaction de la démo-
cratie et du capitalisme ; enfin, (5) brève discussion de la conception intégrée
ou unifiée de l'analyse du développement, à partir des modalités
'
réelles et
souhaitées,
du développement aux Philippines.
II..
L'EVOLUTION DES APPROCHES THEORIQUES
Au cours des 30 dernières années, les approches théoriques du développement
ont changé à mesure que changeaient la réalité historique* des processus de déve-
loppement, les relations entre pays développés et
'
pays en développement et
qu'évoluait le débat qui divise les spécialistes des sciences sociales. Dans ce
chapitre,
nous tenterons, sans toutefois prétendre à 1'exhaustiyité, de" synthé-
tiser brièvement l'évolution des théories qui sous-tendent une analyse,plus appro-
fondie de la nature du développement.
Notre tour d'horizon commence par la théorie de la modernisation, apparue à
la fin des années 50 et au début des années 60, qui procédait de la position hégé-
monique acquise depuis peu par l'Amérique sur la scène internationale, et du souci
de résoudre les problèmes des pays pauvres. Vers "la fin des années 60, toutefois,
en raison notamment de l'engagement américain au Viet Nàm et de
1 '
échec des
pro-
grammes de modernisation, naît
l'école
marxiste de la dépendance, opposée à
l'école
de la modernisation, à laquelle certains intellectuels extrémistes
reprochent même
:
de faire l'apologie de l'impérialisme. Peu à peu cependant,
l'affrontement entre tenants de la modernisation et théoriciens de la dépendance
devient moins- virulent, et le débat sur le développement du tiers monde moins
idéologique et passionnel. Les théoriciens du changement1 social s'emploient à
dégager une perspective nouvelle qui transcenderait à la fois la théorie de la
modernisation et celle de la dépendance.
C'est
dans ce contexte historique que
Wallerstein élabore
l'idée
de système-monde, qui doit beaucoup aux écrits
marxistes sur le développement mais aussi aux historiens de
l'école
des Annales
qui critiquaient la spécialisation trop poussée des chercheurs et universitaires
contemporains. Dans sa première formulation, cette notion était visiblement
influencée par la théorie de la dépendance et
c'est
pourquoi elle a souvent été

- 2 -
citée en liaison avec cette dernière. Mais au fur et à mesure que la théorie du
système-monde se précisait, les chercheurs intéressés par le changement social ont
commencé à souligner les différences décisives existant entre les deux théories,
et entre celles-ci et la théorie de la modernisation, quant aux structures
théoriques,
aux axes de la recherche et à leurs conséquences en termes d'action.
Les tenants de la théorie de la modernisation s'intéressent surtout au tiers
monde et à la manière d'en favoriser le développement, tout en gardant implicite-
ment le monde développé comme modèle. Selon cette théorie, les nations du tiers
monde souffrent d'un vice -fondamental qui explique leur retard économique. Ainsi
les sociologues soulignent-ils la persistance des institutions et des valeurs
traditionnelles, cependant, que les psychologues mettent en avant le faible niveau
d'aspiration, que les démographes s'alarment de l'explosion démographique, que les
spécialistes des sciences politiques dénoncent l'inefficacité et la corruption de
la bureaucratie et que les économistes, enfin, incriminent le manque d'investisse-
ments jproductifs. A cet égard, on peut dire que la théorie de la modernisation
fournit une explication "interne" des problèmes de développement du tiers monde.
La théorie de la modernisation comporte une dimension structurelle et une
dimension psychologique, qui ne forment pas un ensemble nécessairement cohérent.
Sur le plan structurel, elle postule une conception evolutionniste et uniforme du
développement économique, social et politique, selon la voie suivie par le monde
industriel,
lequel
s'est
édifié sur le capitalisme et la démocratie.
C'est
sans
doute Rostow qui a donné à cette théorie sa formulation la plus concrète et la
plus connue, avec ses cinq fameuses étapes : économie traditionnelle ; adoption de
la technologie moderne ; accumulation rapide du capital et débuts de l'industria-
lisation ; industrialisation très poussée s'accompagnant d'un niveau de vie bas ;
enfin,
avènement de la société de consommation. Sur le plan sociopsychologique,
elle explique
l'essor
de l'Occident par la très grande exigence des Occidentaux,
en particulier des protestants, en matière de rationalité et de réussite. Ainsi,
les possibilités de développement
d'une
société dépendraient, au moins partielle-
ment,
du profil psychologique de ses membres.
L'ain
des points faibles de cette
hypothèse est qu'elle ne tient pas compte des variables structurelles, impor-
tantes,
qui orientent la motivation des individus. Une autre thèse sociopsycho-
logique affirme que le contact avec les institutions modernes engendrent
l'homme
"moderne",
mais cela n'explique pas pourquoi il y a davantage d'institutions
modernes au Japon qu'en Indonésie, par exemple.
Les théoriciens de la dépendance ont, fondamentalement, les mêmes préoccupa-
tions que les tenants de la modernisation, et souhaitent, comme eux, promouvoir le
développement du tiers monde ; mais ils proposent un modèle théorique différent et
expliquent le stade de développement du tiers monde par des facteurs non pas
"internes"
mais "externes". En résumé, ils affirment que le retard économique des
pays du tiers monde est dû non pas au caractère traditionnel de leurs institutions
et de leurs valeurs, mais au fait qu'ils sont exploités par les pays capitalistes
avancés.
Leur situation à la "périphérie" n'est pas le résultat
d'une
évolution
naturelle ; bien au contraire,
c'est
le produit historique de plusieurs siècles de
domination coloniale. Par conséquent, dans les pays qui composent aujourd'hui le
tiers monde, il n'y a pas non-développement, mais bien sous-développement dû aux
nations du "centre".
C'est
le "centre" qui maintient le tiers monde dans son
sous-
développement, grâce à un système qui restructure l'économie de la périphérie en
privilégiant la monoculture d'exportation, l'extraction des minéraux et matières
premières,
et en éliminant les industries autochtones - de sorte que l'excédent
dégagé par l'économie puisse être systématiquement transféré de la périphérie vers
le centre.

- 3 -
A la différence aussi bien de la théorie de la modernisation que de celle de
la dépendance, l'approche systémiquë mondiale ne se préoccupe guère de savoir si
les causes du sous-développement sont internes où externes. En revanche, elle
insiste sur la nécessité pour les sciences sociales de prendre l'ensemble du monde
comme unité d'analyse et s'assigne un champ d'étude beaucoup plus large, compre-
nant non seulement la "périphérie" sous-développée mais aussi les "centres" du
capitalisme avancé, les nouveaux Etats socialistes, ainsi que l'essor, le dévelop-
pement et l'avenir de toute l'économie mondiale capitaliste.
Cette insistance sur
l'étude
du système mondial dans son ensemble a ses
racines dans la formation théorique et la méthode historique de Wallerstein (1).
Pour lui, la réalité sociale est en état de flux dynamique : "Nous essayons de
capturer, dans notre terminologie, une réalité mouvante. Ce faisant, nous avons
tendance à oublier que la réalité change à mesure, et du fait même, que nous la
résumons dans une formule", souligne-t-il. Pour saisir cette réalité en perpétuel
changement, Wallerstein propose d'étudier une série d'ensembles provisoirement
stables et de grande ampleur, à l'intérieur desquels les concepts ont un
sens.
"Ces ensembles doivent pouvoir prétendre à une intégrité et une autonomie spatio-
temporelle relatives ... je qualifierais ces. ensembles de "système histo-
rique"
... c'est-à-dire un système qui a une genèse, un développement historique
et un terme (destruction, désintégration ou transformation)".
Pour illustrer l'approche systémiquë mondiale, nous prendrons l'exemple
d'Hawaii. L'Etat d'Hawaii est constitué d'un archipel de petites îles au milieu du
Pacifique. Ses habitants ont la réputation d'avoir un esprit de clocher et de se
désintéresser de ce qui se passe dans le reste du monde. Toutefois, ce repli sur
soi est totalement illusoire dans la perspective mondialiste. Dans la mesure où il
appartient au système mondial capitaliste,
l'Etat
d'Hawaii subit nécessairement
l'impact des événements mondiaux. Ainsi, le conflit du Moyen-Orient dans les
années 80
s'est
répercuté au moins de deux façons sur l'économie locale.
D'une
part,
il a effrayé les touristes qui, plutôt que de se rendre en Europe, se sont
parfois rabattus sur Hawaii, d'autre part, dans la mesure où l'archipel abrite une
importante base militaire américaine, les Marines qui se rendaient au Moyen-Orient
y ont dépensé beaucoup d'argent. Ainsi, lé conflit du Moyen-Orient a contribué à
la croissance du tourisme et des services à Hawaii.
L'approche systémiquë mondiale ne permet pas seulement de mieux comprendre le
développement national, elle éclaire aussi d'un jour nouveau de nombreux phéno-
mènes que là sociologie étudie de longue date, par exemple les relations de
classe.
Dans cette perspective, la lutte de classes n'est pas circonscrite dans
les limites d'un Etat-nation, elle peut être source de conflits à l'échelle inter-
nationale. Dès lors s'explique la bataille perdue d'avance que livrent certains
secteurs de la classe ouvrière américaine contre les sociétés transnationales, qui
non seulement déplacent leurs industries manufacturières vers le tiers monde mais
emploient aussi une main-d'oeuvre bon marché et clandestine, venue d'Amérique
centrale.
Une fois posé que
l'unité
d'analyse n'est plus un Etat ou un peuple mais
le système mondial, on aboutit à des conclusions fort différentes. Ce ne sont plus
les attributs spécifiques des Etats qui sont au centre de nos préoccupations mais
les relations qui existent entre eux, et les classes ou groupes sociaux ne sont
plus envisagés comme fonctionnant à l'intérieur d'un Etat, mais dans le cadre
d'une
économie à l'échelle mondiale.
Comparaison des structures théoriques. Après ces remarques introductives,
nous allons procéder à une analyse comparative des grandes, orientations des
théories de la modernisation, de la dépendance et: du système-monde, en mettant
l'accent sur cette dernière, qui peut être utile pour nous permettre d'approfondir
notre compréhension dès phénomènes et d'élaborer une théorie du changement social.
Il ne
s'agit
pas de remplacer totalement la théorie de la modernisation, mais
plutôt de repenser certaines pratiques et opinions bien établies, à la lumière des
dimensions nouvelles du changement social au niveau mondial, national et infrana-
tional que les recherches récentes ont fait apparaître.

- 4 -
Dans sa version classique, la théorie de la modernisation a une structure
essentiellement bipolaire : elle oppose la société moderne à la société tradition-
nelle.
Les nations occidentales sont modernes, tandis que les pays du tiers monde
sont traditionnels. Les différentes versions de cette théorie sont toutes mélio-
ristes,
en ce sens qu'elles admettent la possibilité d'accélérer les changements
souhaitables grâce notamment à
l'aide
étrangère, au transfert de technologie, à la
réforme des institutions juridiques et économiques, à une action psychologique
tendant à renforcer le sens de l'universalisme ou les mobiles de réussite ou à une
combinaison de ces différents facteurs.
Le mérite d'avoir développé cette théorie revient en partie à Parsons qui, à
partir de l'oeuvre de Weber et de Durkheim, a procédé à une reconstruction
complexe de la tradition classique du XIXe siècle, définissant un surcroît de
"rationalité" comme un mouvement vers la modernité ou le progrès, et s'inspirant
de l'analyse culturelle weberienne des motivations sous-tendent l'entreprise
capi-
taliste,
formulée dans son fameux discours sur l'éthique protestante et le capita-
lisme.
Pour Parsons, certaines structures normatives et axiologiques sont indis-
pensables à tout progrès économique, social et politique sur la voie du modèle
occidental;
Ainsi, pour qu'il puisse y avoir changement dans le sens du progrès,
les particularismes doivent être remplacés par l'universalisme, et les "rentes de
situation" par la réussite. En outre, Parsons emprunte à Durkheim un élément
central de sa thèse, à savoir que le développement des sociétés industrielles
passe fondamentalement par une différenciation croissante des fonctions.
Les tenants de la modernisation partagent aussi l'inquiétude de Durkheim en
ce qui concerne les ruptures ou les déséquilibres provoqués par l'industrialisa-
tion.
Préserver
l'unité
organique de la société en pleine mutation structurelle a
été l'un des grands problèmes des pays européens en voie d'industrialisation. Pour
les théoriciens de la modernisation, le tiers monde est aujourd'hui confronté à la
même difficulté. A mesure que les normes et valeurs "modernes" se diffusent dans
la société, les orientations traditionnelles sont à certains égards menacées. Plus
grave,
les normes consensuelles de la société sont minées.
C'est
pourquoi le
courant idéaliste au sein de
l'école
de la modernisation offre une sorte de
"guide"
des conditions socioculturelles préalables au développement. Durkheim
avait posé un diagnostic des problèmes que les sociétés traditionnelles risquent
de rencontrer sur la route de la modernité. Pour les théoriciens de la modernisa-
tion,
en conséquence, la stratégie de développement à adopter pour les pays du
tiers mondé, et ceux qui souhaitent les aider, consiste à faire en sorte que les
premiers assimilent les valeurs et les normes de l'Occident capitaliste en évitant
de se laisser submerger par les conflits qu'un changement aussi radical de leur
système de valeurs pourrait entraîner.
La théorie de la modernisation a exercé une forte influence sur les plans
nationaux de développement de nombreux pays du tiers monde, ainsi que sur
l'aide
au développement fournie par des organismes internationaux, notamment diverses
institutions du système des Nations Unies. Elis se heurte toutefois aujourd'hui à
un certain nombre de critiques, du fait de l'évolution de la réalité historique au
cours des 30 dernières années et de l'intérêt croissant que suscite l'analyse
comparative. On a notamment fait valoir que le développement au XXe siècle
pourrait revêtir des foritfes radicalement différentes des modèles antérieurs,
auquel cas une réflexion nouvelle s'imposerait à la fois sur la signification du
développement et sur la possibilité d'un développement qui emprunterait des voies
multiples.
Ceux qui avancent cet argument critiquent la tendance à proposer comme
objectif du développement une image idéalisée de la société occidentale contempo-
raine,
d'autant que les sociétés occidentales elles-mêmes sont en pleine évolu-
tion.
De façon analogue, vouloir imposer le modèle "capitalisme-démocratie" en en
donnant comme exemple l'expérience occidentale ou américaine crée une impression
d'ethnocentrisme excessif dans la mesure où toute variation par rapport au modèle
occidental est considérée comme une déviation qui doit être corrigée. Quel sort
réserver, dans ces conditions, aux cultures spécifiques du tiers monde qui
semblent faire obstacle à la modernisation ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
1
/
59
100%