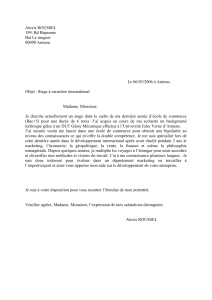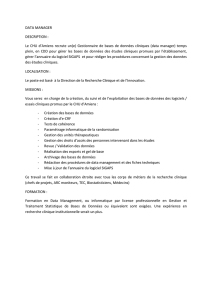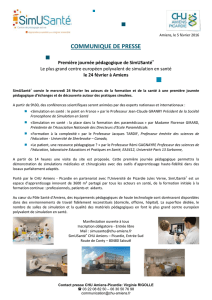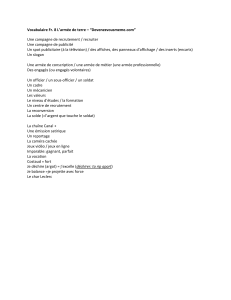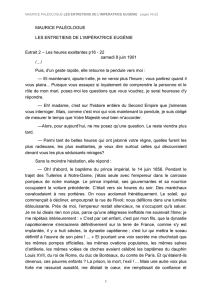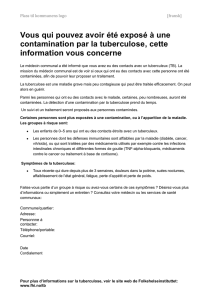Les principales causes de mortalité au XIXe siècle

K-2011- HYGIENE ET SANTE
Sources diverses, dont UN dossier proposé par L’Histoire par l’image (copyright)
Les principales causes de mortalité au XIXe siècle
1. LA MISERE
La grande vague d'urbanisation et d'industrialisation du XIX correspond à un
durcissement de la pauvreté. La misère urbaine, synonyme de de malnutrition,
d'insalubrité et de conditions d'hygiènes déplorables, est la première cause de
mortalité.
Aspects de la misère urbaine au XIXème siècle
Norbert GOENEUTTE - La soupe du matin.
Sénat
Alexandre ANTIGNA - L'éclair. (1848)
Musée d'Orsay
Contexte
Plusieurs événements, sous la monarchie de Juillet, ont éveillé la réflexion de la
bourgeoisie au sujet de la misère populaire : la révolution de 1830 à Paris, les
insurrections des canuts de Lyon en 1831 et en 1834, la crise de subsistance de 1846.
C’est donc entre 1830 et 1840 que l’opinion prend conscience de la misère urbaine et
ouvrière. Diverses réalités sont alors décrites : la pauvreté, la misère (manque de biens
extrême), le paupérisme (pauvreté comme phénomène économique en rapport avec
l’industrialisation) . Cette révélation est l’œuvre d’opposants au régime comme le
docteur Guépin. Mais la très officielle Académie des Sciences morales et politiques a
également incité à l’étude du paupérisme. C’est elle qui a poussé Villermé à enquêter,
dans les années 1830, sur les conditions de vie et de travail des ouvriers du textile à
Lille et à Rouen. Son ouvrage, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers, publié
en 1840, n’a pas peu contribué à la prise de conscience.
Analyse
Selon Buret, un tiers de la population en 1840 est assistée par la charité publique. Celle-
ci est à la fois un moyen de soulager les pauvres et de les enserrer dans un système de
sujétion paternaliste. Le baron de Gérando, grand philanthrope et spécialiste de la
charité, écrit en 1820 : pauvre ou enfant, " le faible appartient au fort à titre d’adoption

"C’est une scène de bienfaisance que Goeneutte, actif dans le dernier quart du XIXe
siècle, représente La Soupe du matin. A l’arrière-plan, des pauvres – hommes, femmes
en haillons, enfants et vieillards – se pressent dans le froid du matin à une distribution
de soupe populaire. Au premier plan de cette cour d’immeuble, occupés à boire le
breuvage bien chaud, ils ressemblent à des particules éparses. Les pauvres que L’Eclair
terrorise sont au contraire serrés les uns contre les autres. Dans un grenier, une mère
indigente et seule (où est le père ?) tente de rassurer ses enfants réveillés en pleine nuit.
La scène est traitée avec force : les puissants contrastes de lumière et l’expressivité des
personnages, issus du peuple et représentés grandeur nature, constituent les traits d’un
caravagisme à portée sociale. L’éclair et l’effroi qu’il suscite, en revanche, sont un
thème romantique (ou biblique, comme dans les scènes du Déluge). Tout semble
opposer les deux tableaux, repas matinal plutôt serein et scène dramatique de nuit. Le
premier offre une description fidèle de la réalité, le deuxième est une métaphore de la
pauvreté ; l’un éparpille les éléments, l’autre résume de manière saisissante. Mais les
indigents qui se bousculent pour la soupe et la " Mère courage " protégeant ses enfants
sont tous des pauvres, des malheureux qui, avec les prolétaires de l’industrie, sont les "
misérables " du XIXe siècle.
Interprétation
Les deux peintres entendent montrer le vrai visage de la pauvreté, mais avec des styles
différents. Si La Soupe du matin cherche plutôt à sensibiliser le spectateur avec sa
précision naturaliste, L’Eclair sonne comme un avertissement. Le premier est un
documentaire sans prétention, le second un symbole, une œuvre à plusieurs degrés de
lecture. Présenté en 1848 au premier Salon de la IIe République, ce tableau exhibe la
misère du peuple avec le même souffle visionnaire que Millet et Courbet dans Les
Glaneuses et Les Casseurs de pierre. Les personnages sont convulsionnés par la peur –
peur de la foudre, du ciel noir, c’est-à-dire peur de la misère et de la guerre civile qui
appauvrit les humbles. Mais cet effroi en évoque un autre : la grande peur de la
bourgeoisie après les journées de Juin, peur du peuple et de sa violence supposée, peur
du sang qu’il pourrait verser. Menace des révolutions à venir, l’éclair pourrait bien finir
par épouvanter aussi la bourgeoisie. Trois ou quatre décennies plus tard les pauvres de
La Soupe du matin semblent bien paisibles : sous la IIIe République, la misère est un
peu dédramatisée et atténuée.
La Part des pauvres
Marius ROY - La Part des pauvres. (1886)
Musée des Beaux-Arts de Rennes
Contexte
La pauvreté et la malnutrition dans la France de la IIIe République
Dans la société française du XIXe siècle, les inégalités sont encore criantes alors
que les classes supérieures représentent seulement 15 % environ de la population

urbaine. Souvent touchées par la précarité, les classes populaires sont attirées par
les villes, dont la physionomie témoigne des disparités sociales. Dans les quartiers
les plus pauvres, les revenus sont insuffisants et irréguliers, les logements
insalubres, l’alimentation carencée et le travail fatigant. La condition des
travailleurs manuels est celle du dénuement et des lendemains incertains.
L’existence y est pour bon nombre difficile, tributaire d’un rythme irrégulier de
travail, d’une embauche au coup par coup et d’un chômage récurrent.
Analyse
Une vision sociale de l’armée
La population urbaine touchée par la pauvreté se rassemblait fréquemment à la porte
des casernes militaires situées dans les villes. Le tableau représente une scène
authentique : le dimanche, des cuirassiers à la porte de leur quartier, situé
vraisemblablement dans la région de Rennes, donnent un reste de soupe à des
mendiants. Le peintre Marius Roy, nommé maître de dessin à l’Ecole polytechnique, se
spécialisa dans la représentation de la vie militaire dans ses aspects les plus simples.
Plusieurs cuirassiers à l’intérieur de leur quartier semblent être des appelés, dont
certains sont de corvée. Ce tableau, exposé au Salon de 1886 et à l’Exposition nationale
et régionale de Rennes en 1887, dans lequel se fait sentir l’influence du naturalisme,
illustre le lien de solidarité qui unissait l’armée et la population sous la IIIe République.
En assurant la défense de la nation, l’armée n’est plus coupée du peuple comme
auparavant, elle se veut aussi éducatrice, sociale, voire charitable comme ici.
Interprétation
Le renouvellement de l’iconographie militaire
Ce tableau de propagande cherche à renouveler l’iconographie militaire. Cette vision
sociale de l’armée, très rare en peinture, illustre l’idéologie égalitaire de la IIIe
République. Tenue pour responsable de la défaite de 1870-1871, l’institution incarne
par la suite le salut social et représente un rempart contre la guerre civile. Le
redressement moral de la nation lui incombe.
Au cours des années 1880, le service militaire, obligatoire pour tous les citoyens depuis
1872, bouleverse la société française par le mélange des classes sociales qui s’opère
dans les casernes. Pour pallier le manque de bâtiments nécessaires à l’accueil des
conscrits, l’armée réquisitionne parfois des monuments anciens comme c’est le cas
dans le tableau de Roy où apparaît un pont-levis. Une instruction ministérielle du 20
mars 1875 améliore le confort des bâtiments à usage militaire, introduisant l’hygiène
dans les quartiers.
Au cours des années 1880, les quartiers suscitent curiosité et sympathie. La peinture
militaire s’écarte des conventions précédemment en vigueur au profit d’un réalisme
documentaire, genre inauguré par Edouard Detaille. La représentation militaire évolue
de l’épique vers l’anecdotique et privilégie la vie quotidienne du soldat. Les rituels du
quartier ou de la caserne, lieu de passage obligé de la majorité des jeunes Français, sont
au cœur d’un nouveau folklore illustré par le comique troupier. La vie de garnison
rythme la vie des cités provinciales par les manœuvres des régiments et surtout la revue
du 14-Juillet.
Toutefois, dès les années 1890, l’opinion publique se lasse de ces représentations
banales de la vie quotidienne d’une armée de temps de paix et reste nostalgique d’une
peinture militaire évoquant les glorieuses victoires d’un passé prestigieux. La Part des
pauvres témoigne ainsi de l’épuisement du sujet militaire en peinture, qui n’a plus rien
à offrir à la curiosité du public. De manière générale, la peinture militaire continue
d’entretenir la nostalgie des provinces perdues, bientôt reconquises par les « poilus ». Il
faut attendre la Première Guerre mondiale et la vie dans les tranchées pour voir les

artistes renouveler entièrement le sujet et l’intérêt du public.
2. LES EPIDEMIES ET LES MALADIES
Avant la révolution pasteurienne, on ne dispose que de peu de moyens pour lutter
contre la propagation des épidémies. Ainsi, dans la première moitié du XIX, plusieurs
épidémies frappent encore durement la France, la fièvre jaune en 1821, le choléra en
1866. Par ailleurs, malgré l'existence d'un courant hygiéniste qui fait appel à la
responsabilité individuelle et collective pour améliorer les conditions d'hygiène, des
maladies dites populaires telle que la syphilis, ou sociales comme la tuberculose (ou
phtisie) se développent dans les milieux ouvriers mais aussi dans les milieux plus aisés.
Maladie emblématique du XIX mais véritable fléau social , la tuberculose est
responsable de pus de 10 % des décès à la fin du XIX .
Le choléra à Amiens (1866)
Auguste FERAGU - L'impératrice Eugénie
visitant les cholériques à Amiens. (1878)
Musée national du Château de Compiègne
Paul-Félix GUERIE - L'impératrice Eugénie
visitant les cholériques de l'Hôtel-Dieu à
Amiens, le 4 juillet 1866. (1866)
Musée national du Château de Compiègne
Antoine-Léon BRUNEL-ROCQUE - L'impératrice Eugénie protégeant du choléra les villes
d'Amiens et de Paris. (1866)
Musée national du Château de Compiègne
Contexte
Entre l’été 1865 et l’hiver 1866, le choléra fit son apparition dans de nombreuses
régions de France. Ce fut l’épidémie la plus grave depuis 1832. Le 30 juin 1866,

l’empereur envoya le ministre de l’Agriculture et du Commerce et l’inspecteur des
services sanitaires à Amiens où l’épidémie avait revêtu une exceptionnelle gravité. Il fit
don de 5 000 francs en son nom personnel et de 1 000 francs au nom du prince impérial
pour secourir les victimes (Le Moniteur, 4 juillet 1866). Quatre jours plus tard,
l’impératrice fit une visite de bienfaisance à Amiens, visitant les hôpitaux et autres
institutions. A propos de cette visite, Prosper Mérimée écrivait à Panizzi, le 5 juillet
1866 : “ Je ne suis pas sûr que ce soit très raisonnable, mais c’est très beau. ” En
décembre 1865, l’impératrice avait rendu visite aux cholériques de l’hôpital Beaujon, à
Paris. En 1866, le conseil municipal de la capitale fit frapper une médaille de bronze
commémorative.
Analyse
La toile d’Auguste Feragu représente l’impératrice Eugénie sortant de l’hôtel-Dieu
d’Amiens, le 4 juillet 1866. Derrière l’impératrice se tiennent les autorités civiles et
religieuses : le docteur Connau, conseiller d’Etat et préfet de la Somme, accompagné de
son épouse, monsieur Dhavernat, maire de la ville, l’évêque d’Amiens ; derrière ces
notabilités, le personnel de santé, médecins et religieuses. L’impératrice est sobrement
vêtue de noir ; elle est coiffée d’un petit bonnet noir fixé à l’aide d’un ruban noué sous
le menton. Elle est accompagnée de la comtesse de Lourmel, dame du palais.
Devant l’hôtel-Dieu, quelques Amiénois l’attendent. Un petit garçon s’avance vers elle
et lui tend une supplique.
L’hôtel-Dieu est situé dans le quartier Saint-Leu, quartier populaire dominé par la
masse imposante de la cathédrale qui se dresse à l’arrière-plan. On aperçoit la foule
grouillante et, à gauche, l’entrée de l’église Saint-Leu.
La toile de Paul-Félix Guérie représente l’impératrice Eugénie à l’intérieur même de
l’Hôtel-Dieu. La grande salle commune, dont le haut plafond est soutenu par des piliers
de bois, est divisée en deux par une cloison de planches. On aperçoit le tuyau du poêle
qui permet de chauffer la salle. Les lits sont répartis sur trois rangées. Au centre de la
toile, l’impératrice est penchée sur un lit où repose un malade. Comme dans le tableau
d’Auguste Feragu, elle est très simplement vêtue de noir. Une sœur de charité se tient
de l’autre côté du lit. Derrière l’impératrice se trouvent les autorités civiles, militaires et
religieuses, notamment le préfet de la Somme et l’évêque d’Amiens. La salle est
remplie d’une foule nombreuse. A droite, au pied d’un lit, un homme agenouillé nettoie
le parquet.
La peinture sur toile d’Antoine-Léon Brunel-Rocque a la forme d’un médaillon ovale.
Il s’agit de la composition originale, préparatoire à la décoration d’un vase commandé à
la manufacture de Sèvres pour commémorer la visite de l’impératrice à Amiens le 4
juillet 1866. Il fut livré “ au nom de S.M. l’Empereur, au Musée Napoléon de la ville
d’Amiens ” en mai 1870.
Le thème traité par Brunel-Rocque est une allégorie. Au centre de la composition,
l’impératrice Eugénie, debout, tend les bras vers deux femmes agenouillées, tourelées,
qui symbolisent les villes de Paris et d’Amiens éprouvées par l’épidémie. Aux pieds de
la souveraine, deux dragons agonisants, lançant flammes et fumées, incarnent le choléra
vaincu par l’intercession de l’impératrice.
Interprétation
Auguste Feragu et Paul-Félix Guérie ont représenté le même événement, mais ils l’ont
mis en scène de façon totalement différente.
Le choléra est pratiquement absent du tableau d’Auguste Feragu. L’impératrice est
représentée sortant de l’hôtel-Dieu et le peintre insiste davantage sur le caractère
officiel de sa visite à Amiens. L’œil est attiré par ce petit garçon présentant une
supplique à la souveraine, qui tend majestueusement la main pour la recevoir et montre
ainsi que le pouvoir impérial est à l’écoute des problèmes et des aspirations du peuple.
A l’inverse, le choléra est au centre du tableau de Paul-Félix Guérie. Méprisant la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%