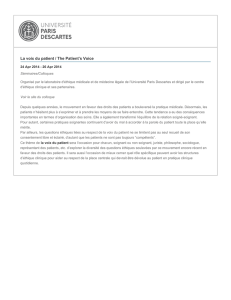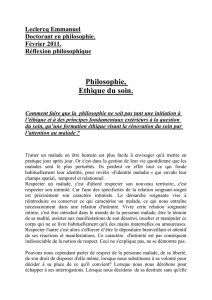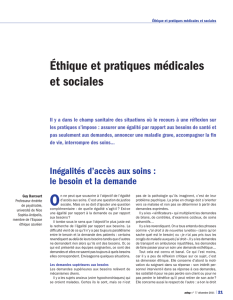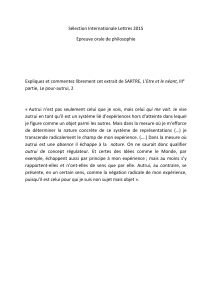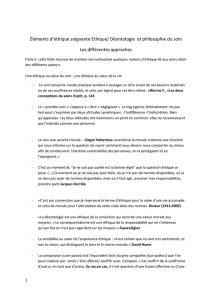Nature et formes du soin, pour une approche par l`agir

Ethique & Santé 2005; 2: 125-129 • © Masson, Paris, 2005 125
ARTICLE ORIGINAL
Nature et formes du soin, pour une approche
par l’agir compassionnel1
P. Svandra2
22, hameau des Échassons, 91310 Longpont-sur-Orge.
Correspondance
P. Svandra,
à l’adresse ci-contre.
e-mail : [email protected]
1. Tiré d’un Mémoire de DEA de philosophie pratique, Nature et forme du soin, Université de Marne-la-
Vallée, septembre 2004.
2. Cadre supérieur Infirmier/Formateur, Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS), Centre Hospi-
talier Sainte-Anne.
Résumé
Chercher à définir la nature du soin lorsqu’on est soignant, c’est inévitablement revenir
aux sources même de son engagement professionnel. Le soin constitue alors une forme
d’impératif moral, une exigence vis-à-vis de soi-même qui nous pousse à répondre
activement et sans condition à l’appel de celui qui souffre et demande de l’aide. En ce sens
le soin s’apparente à une morale et un agir. Une morale, car par sa nature désintéressée le
soin se définit comme l’expression de notre humanité. Il constitue ainsi une forme
essentielle de don. Un agir car ce don pour autrui n’a de sens que s’il se traduit en actes.
Pour cette raison le soin est clairement une praxis. En permettant au sentiment de
s’ajouter à la raison, le soin peut donc se définir comme un agir compassionnel. En tendant
à faire du malade un simple objet de soin, l’évolution des techniques médicales qui
s’accompagne d’une rationalisation des pratiques va totalement à l’encontre de la nature
profonde du soin.
Mots-clés : soin - don - compassion - altérité - sollicitude
Summary
Nature and forms of health care, a plead for compassionate action
Svandra P. Ethique & Sante 2005; 2: 125-129
Health care professionals who strive to (re)define the nature of their care practices
necessarily re-examine the reasons for their engagement in the health care profession. In
this light, health care is seen as a self-imposed moral obligation to respond actively to calls
for help from the suffering. The moral obligation arises from the altruistic nature of
health care, defined as an expression of our humanity. But by its very essence, health care,
this unselfish gift, implies active engagement. Health care is thus clearly a praxis, which,
by combining reason with sentiment, enables the health care professional to act with
compassion. The evolution of medical techniques tending towards a rationalized
response to the objective needs of the patient-object is in total contradiction with the
profound nature of health care.
Key words: care - gift - compassion - altruism - solicitude
Qu’est-ce que le soin ?
L’expression active
d’une forme de souci pour autrui
Cette représentation du soin peut
sembler quelque peu sommaire, elle
présente toutefois le mérite de consi-
dérer l’activité soignante comme une
forme de morale en action. Le terme
de morale reste alors à préciser. Nous
proposons ici de nous référer à Jürgen
Habermas [1] qui, dans son ouvrage
majeur De l’éthique de la discussion, qua-
lifie de morales « toutes celles des intuitions
qui nous informent sur la question de savoir
comment nous devons nous comporter au
mieux afin de contrecarrer l’extrême vul-
nérabilité des personnes, en la protégeant et
en l’épargnant ». Nous percevons alors
que c’est exclusivement le souci de
l’autre comme expression de notre hu-
manité qui fonde l’éthique du soin. À
cet égard, s’il semble relativement aisé
de caractériser les soins, il est en revan-
che paradoxalement beaucoup plus
difficile de définir le soin. Selon qu’il
est employé au singulier ou au pluriel,
ce mot a en effet un sens et une portée
bien différents. Au pluriel il se rappor-
te à des actes plus ou moins techniques
qui se réfèrent en général au corps et
demandent un certain apprentissage
(soins thérapeutiques, de nursing, pal-
liatifs, relationnels,…). Au singulier, il
renvoie à une notion plus générale,
procéder avec soin, c’est agir avec ap-
plication, minutie, sérieux. Ne prend-
t-on pas soin de ce qui nous est cher ?
Représentant à la fois une relation
interindividuelle de nature éthique et
une forme essentielle de lien social, on
ne peut donc limiter le soin, comme
souci pour l’autre, au seul acte
thérapeutique3. La langue anglaise fait
3. La question de savoir si tout acte médical consti-
tue un soin mériterait une réflexion approfondie.

126
Nature et formes du soin, pour une approche par l’agir compassionnel P. Svandra
d’ailleurs une différence nette entre le
cure (guérir, soigner), et le care (compa-
tir, prendre soin). Pascale Molinier [2],
évoquant les métiers du soin sous le ter-
me générique de care work, explique que
« le care dénote la dimension affective
mobilisée par ce type d’activité dont la
plupart nécessitent d’être réalisées avec
“tendresse” ».
Le soin est relation
Nous nous proposons donc dans les li-
gnes qui suivent de tenter de mieux ca-
ractériser la nature profonde du soin
comme forme de souci pour autrui.
Nous commencerons cette recherche
par une référence à Spinoza qui, ju-
geant « inhumain » celui qui ne porte-
rait pas secours à un autre, différenciait
deux types de secours, celui qui naît de
la compassion et celui qui s’appuie sur
la raison. Cette distinction s’avère
essentielle car elle révèle deux concep-
tions divergentes de l’altérité qui par-
tage encore aujourd’hui la philosophie
morale. La première est de nature af-
fective, elle se retrouve dans la sympa-
thie (comme chez Hume) ou dans la
pitié (comme chez Rousseau). La se-
conde, à laquelle Kant va donner ses
lettres de noblesses, fait appel pour sa
part au respect. De nature universelle,
elle relève d’un devoir moral impératif
fondé sur la raison. Dans quelle caté-
gorie faut-il alors placer le soin ?
Constitue-t-il une forme particulière
d’empathie ou relève-t-il uniquement
du devoir ?
Pour reprendre une formule d’Eric
Fiat4, il serait peut être urgent pour le
soignant de ne pas choisir entre ces
deux conceptions. Car en réalité, c’est
tout autant la souffrance de l’autre que
l’injonction morale qui entraînent ce
sentiment spontané vers autrui. On
comprend dès lors que la nature de la
relation soignante ne peut se réduire ni
à une forme de pitié ou de sympathie
fondée sur le sentiment, ni à un devoir
Seule la sollicitude peut
permettre de dépasser
le simple respect sans
verser dans une sensibilité
contingente par nature.
ou impératif moral qui se référerait à la
seule raison. Nous devons donc recher-
cher les voies qui puissent réunir la
raison au sentiment, l’intelligible au
sensible. Didier Sicard [3] résume la
question en ces termes : « Comment
faire percevoir à celui qui souffre, qu’il est
quelqu’un pour celui qui soigne ». Selon
Paul Ricœur [4], seule la sollicitude peut
permettre de dépasser le simple respect
sans verser dans une sensibilité contin-
gente par nature. À la recherche d’une
hypothétique bonne distance, la sollici-
tude doit permettre au soignant d’être
bienveillant tout en permettant à autrui
de demeurer lui-même. Ne se limitant
pas à la simple obéissance d’un devoir
moral, « la voix de la sollicitude demande
que la pluralité des personnes et leur altérité
ne soit pas oblitérée par l’idée englobante
d’humanité ».
Emmanuel Lévinas nous propose
une conception encore plus radicale de
l’altérité puisque nous sommes, selon
lui, comme obligé face à celui qui souf-
fre. Notre rencontre avec autrui repose
sur une asymétrie fondamentale, mais
c’est paradoxalement le faible qui do-
mine et m’oblige. Emanant du visage, il
existerait donc une obligation qui nous
demanderait de ne jamais laisser autrui
à sa souffrance et à sa solitude. Pour se
faire bien comprendre, Lévinas em-
ploie une formule hyperbolique, celle
de « prise en otage ». Sans attendre de
réciprocité, c’est donc moi qui supporte
autrui, qui en suis totalement responsa-
ble. Cette responsabilité est infinie et
incessible, elle représente l’expression
de mon humanité, du respect que je
porte à autrui comme être singulier.
Ainsi pour l’auteur de Totalité et infini
tout rapport éthique n’est rien d’autre
qu’un rapport de soin.
Cet engagement soignant envers
celui qui souffre ne serait dans ce cas
ni le fruit d’une réflexion rationnelle,
ni d’un sentiment affectif particulier
mais d’une forme de nécessité. Camus
[5] faisait ainsi écrire au Docteur
Rieux dans La Peste : « Ceux qui se dé-
vouèrent aux formations sanitaires
n’eurent pas si grand mérite à le faire, car
ils savaient que c’était la seule chose à fai-
re et c’est ne pas s’y décider qui alors eût
été incroyable ». Au travers de cette
phrase, Camus nous montre que c’est
la situation tragique – la souffrance
d’autrui, le sentiment d’injustice – qui
nous impose d’agir. Cet engagement
qui s’apparente à une forme de révolte
face à la réalité de la condition humai-
ne nous semble être, au moins au dé-
part, celui de tous les soignants.
Le soin est agir
L’attitude soignante se caractériserait
donc d’abord par un mouvement
spontané vers l’autre. Pour autant, il ne
s’agit pas simplement pour le soignant
de « souffrir avec », comme l’indique
l’étymologie des mots « sympathie » ou
« compassion », car le soin risquerait
d’en devenir inefficace. Le soin pourrait
être défini comme un agir au service
d’une éthique qui elle-même s’édifie au
quotidien, notamment au travers de la
délibération collective. En se révélant
dans le processus même de la décision,
l’éthique du soin en deviendrait-elle
procédurale, donc exclusivement déon-
tologique ? Assurément non, car il ne
s’agit pas pour le soignant d’en rester au
stade des seules intentions, la question
de la responsabilité ne saurait être en
effet évacuée. N’oublions pas que le
terme de responsabilité réunit en fait
deux significations : être comptable de… et
compter sur… Paul Ricœur définit ainsi
la responsabilité comme l’effort de ren-
dre compte parce qu’un autre compte
sur nous. L’idée de responsabilité sous
entend donc deux processus : l’attribu-
tion d’une action à son auteur et sa qua-
lification morale.
En ce sens, plus que la responsabili-
té a posteriori, c’est l’engagement qui
concerne les actes à venir qui caractéri-
serait le mieux l’éthique soignante.
S’engager, c’est décider a priori d’être
responsable de ce que l’on va faire.
C’est ainsi que l’éthique peut être défi-
nie comme une réflexion, en amont de
l’action, qui vise à distinguer la meilleu-
re (ou la moins mauvaise) façon d’agir.
Pour caractériser ce bien agir nous pou-
vons faire appel à la notion aristotéli-
cienne de phronésis qui, loin d’être une
4. Eric Fiat expliquait dans un séminaire consacrée à l’ouvrage de Kant, « Fondements de la métaphysique
des mœurs », qu’entre Aristote et Kant, il était peut être « urgent de ne pas choisir » car l’éthique est, selon
lui, comme « un fil tendu entre la conviction et la responsabilité, entre le respect absolu et inconditionné
de l’absolu, et l’attention aux conditions. » (Cours du DESS de philosophie, Espace Ethique AP-HP, Uni-
versité de Marne-la-Vallée, année 2001-2002).

Ethique & Santé 2005; 2: 125-129 • © Masson, Paris, 2005 127
ARTICLE ORIGINAL
prudence frileuse et figée, correspond
à une sagesse pratique, une forme
aboutie d’agir réfléchi. La phronésis dé-
passe la simple règle de conduite puis-
qu’elle est vertu. Nous sommes au
cœur de ce que certains appellent une
éthique arétaïque. En s’inspirant d’Aris-
tote, on pourrait alors soutenir que
l’éthique en matière de soin consisterait
à rechercher en permanence et au quo-
tidien le bien agir. Quoiqu’il en soit
nous nous situons bien ici dans le do-
maine de l’action, de la praxis.
Il ne faudrait pas pour autant
oublier que le soin est un engagement
pour autrui, c’est donc ce dernier qui
demeure in fine le maître de la relation.
C’est pourquoi la formule (trop) sou-
vent employée de « prise en charge »,
par son ambiguïté même, n’est pas
satisfaisante. A contrario, le concept
d’agir compassionnel, à l’image de l’agir
communicationnel cher à Habermas,
peut apparaître comme la manifestation
d’un mouvement vers l’autre respec-
tueux de la singularité et de la liberté du
sujet souffrant.
Le soin est don
Comme le souligne le philosophe
contemporain Gildas Richard [6], « le
soin médical, ou indirectement toute
activité visant à assurer la survie
d’autrui, prolongent en quelque sorte le
don de la vie, et relèvent du même genre
que celui ci ». Robert Misrahi [7] parta-
ge également cette conviction lorsqu’il
déclare : « Le rapport au malade est tout
à fait spécifique. Il s’agit d’un rapport de
donation de sens et de donation de vie ».
Ainsi deux philosophes de tradition
philosophique très différente arrivent à
cette même conclusion : le soin est une
forme de don.
Reste que le don n’est pas objecti-
vable en lui même puisqu’il réside uni-
quement dans l’intention du donateur.
C’est donc le caractère moral et désin-
téressé d’une action qui fait d’elle un
Le soin trouve son unité
non pas dans le domaine
qu’il investigue (le corps),
mais dans le but qu’il se
propose (l’Être singulier).
don. Selon Kant [8], il existe une diffé-
rence essentielle entre la notion de
désintéressement et de désintérêt. En
effet, « la volonté humaine peut prendre
intérêt à une chose sans pour cela agir par
intérêt. La première expression désigne
l’intérêt pratique que l’on prend à l’ac-
tion ; la seconde, l’intérêt pathologique que
l’on prend à l’objet de l’action ». Gildas
Richard [6] s’inscrit dans cette concep-
tion d’un intérêt désintéressé lorsqu’il
écrit : « Viser autre chose que soi-même
comme une fin en soi, c’est adopter une at-
titude qui a un sens, […] tout en étant
exempte d’intéressement. » Il s’agit alors
« d’échapper à la désespérante alterna-
tive entre un comportement gratuit,
mais insensé, et un comportement
sensé, mais cupide. » (Richard, 2000,
p. 48). On conçoit aisément qu’en ma-
tière de soin cette question du sens soit
capitale, car si le soin s’adresse au
corps, il vise bien l’autre comme fin en
soi et en premier lieu dans sa possibili-
té d’être. On peut évoquer concernant
le soin l’incapacité à satisfaire par soi-
même ses besoins et ses désirs contin-
gents. Le soin comme don a alors pour
raison d’être la plénitude qui vise l’uni-
té de l’autre avec lui-même, notam-
ment par l’intermédiaire de son inté-
grité physique. Dans ce cas ce qui est
reçu n’est pas à proprement parler dis-
tinct de ce qui reçoit. Il n’en demeure
pas moins que le soin trouve son unité
non pas dans le domaine qu’il investigue
(le corps), mais dans le but qu’il se pro-
pose (l’Être singulier). S’agissant de
l’homme, ce recul et cette distance appa-
raissent comme essentiels5. Si le soin
est à la fois relation, agir et don c’est
bien parce qu’il est, comme nous le dit
Walter Hesbeen [9], « rencontre et ac-
compagnement ».
Soin et justice
Gildas Richard caractérise l’homme
comme une plénitude toujours en pé-
nurie. Dans ces conditions, ne peut-on
pas voir dans le soin une (vaine) tentati-
ve qui viserait à combler cette pénurie
ontologique ? Dans la relation de soin
le soignant se retrouve en effet, suivant
la conception d’Emmanuel Levinas,
comme obligé par le malade, quasiment
pris en otage par la souffrance du faible.
Il va alors être tenté de mettre en œuvre
tout son agir compassionnel pour extirper
la personne malade de la souffrance, de
la maladie, du handicap et surtout de la
mort. Sans parler des problèmes éthi-
ques considérables que peut poser la
réalisation concrète de cette exigence,
on comprend vite que cette ambition
est par nature utopique. Il n’existe en
effet aucun système collectif qui puisse
être capable de répondre pleinement à
cette aspiration soignante. Nous nous
retrouvons alors dans la situation classi-
que, celle où le désir est infini et l’offre
finie. Pour dépasser cette contradiction
qui pose un problème éthique et politi-
que majeur nous devons revenir encore
une fois à la pensée d’Emmanuel Levi-
nas. Certes, comme nous l’avons souli-
gné, si je suis seul avec l’autre, je lui dois
tout et j’en suis totalement responsable.
Toutefois autrui n’est pas seul, un autre
autrui existe (au moins potentielle-
ment), c’est le tiers. Je me dois donc
d’établir cette relation de responsabilité
avec les autres hommes. Cette présence
du tiers a une conséquence essentielle,
elle m’oblige à modérer le privilège que
je dois à autrui. Levinas s’interroge ain-
si sur le sens que peut avoir, vis-à-vis de
l’autre, la notion de justice. Il rappelle
alors que cette justice, comme institu-
tion indispensable, doit toujours être
contrôlée par la relation interperson-
nelle initiale.
En ce sens dans le soin l’individuel
et le collectif sont totalement solidaires,
l’un ne peut se penser sans l’autre. En
affirmant que le soin comme lien social
relève de la solidarité et que le soin
comme relation inter-individuelle se
rapporte à la sollicitude, nous distin-
guons clairement deux modes de
« prendre soin ». Le premier touche au
corps individuel et vise l’être, le second
concerne le corps social et recherche la
cohésion de la communauté. Cepen-
dant, loin de s’exclure ces deux dimen-
sions du soin – l’une éthique, l’autre
politique – sont intimement liées. Il
s’agit alors de (re)lier la question du
bien avec celle du juste. Pour que le soin
ne perde pas son caractère universel, il
doit pouvoir s’exprimer dans le cadre
d’organisations sociales justes. Inverse-
ment, pour qu’un système de santé
puisse être considéré comme véritable-
ment éthique, la pratique soignante
5. D’ailleurs, c’est bien cette distance qui distingue d’une façon radicale le soin médical de l’art du vétérinaire.

128
Nature et formes du soin, pour une approche par l’agir compassionnel P. Svandra
doit pouvoir rester désintéressée. Ce
n’est que si ces deux conditions sont
remplies que le soin peut demeurer vé-
ritablement un agir compassionnel.
Quand le soin oublie le malade
En pratique la question reste pourtant
en suspens : Pourquoi comme soignants
sommes-nous amenés à oublier parfois
notre responsabilité pour autrui ? Car si
dans une vision pure du soin toute l’in-
tention du soignant doit être dirigée ex-
clusivement vers le malade, nous savons
bien que dans la réalité d’autres élé-
ments peuvent intervenir et s’y mêler.
Ces éléments sont certes divers (l’ar-
gent, la technique, le pouvoir, la fati-
gue…), mais ils ont tous en commun de
détourner le soignant de son objectif,
de pervertir en quelque sorte la pureté
du soin. À l’extrême, l’acharnement
thérapeutique en service de réanima-
tion ou la maltraitance de personnes
âgées en institution constituent autant
de formes d’occultation de l’autre.
La médecine scientifique, particu-
lièrement lorsqu’elle s’intéresse plus à
la maladie qu’au malade, peut être la
cause de cet oubli de l’autre. Il s’agit ici
de repérer deux dérives possibles et
bien souvent liées. D’abord celle d’une
médecine si spécialisée qu’elle ferait
perdre au soignant la conscience de la
réalité du malade et le sens du soin. En-
suite, celle d’une modernité marquée
par l’apparition de possibilités techni-
ques si puissantes qu’elles finiraient par
déshumaniser le rapport de soin. En
tendant à faire du malade un simple ob-
jet de soin, l’évolution des techniques
médicales va ainsi à l’encontre de la na-
ture profonde du soin.
Face à cette médecine de la maladie,
centrée sur l’organe ou la fonction à ré-
parer ou à traiter, nous serions tentés
d’opposer une pratique soignante diffé-
rente, étrangère à ce mouvement tech-
niciste. Les soins infirmiers lorsqu’ils
s’attachent à rétablir (ou suppléer) les
besoins fondamentaux de l’homme en
constitueraient un paradigme. Mais
là encore des dérives existent. Il suffit
pour s’en convaincre de se rendre dans
des services hospitaliers ou institutions
médicales pour constater que le malade
n’est malheureusement pas toujours au
centre des préoccupations des diffé-
rents acteurs de soin. Sans parler d’actes
de maltraitances volontaires qui restent
heureusement rares, il faut bien évo-
quer toutes les organisations de travail
oublieuses du malade. Car, pour des
raisons de gestion et de rationalisation
des organisations, les soins peuvent se
résumer à des actes isolés et devenir dès
lors de simples gestes dépourvus de
sens. Les soignants se retrouvent dans
des situations à devoir davantage « faire
des soins » que « prendre soin ». Le
soin en devenant instrumental se for-
malise.
Cette situation d’occultation de
l’autre est préjudiciable bien évidem-
ment aux soignés, mais aussi aux
soignants, car elle induit peu à peu la
routine et le désintérêt pour le métier.
Elle est à la source du malaise et du
stress de nombreux professionnels.
Cette perte de sens entraîne ce qu’on
appelle communément l’épuisement
professionnel qui n’est au fond rien
d’autre qu’une profonde fatigue mora-
le. Avec elle les plus beaux sentiments
et/ou les plus grands devoirs moraux
s’enlisent. Cette lassitude représente un
démon mesquin qui atteint toutes les
facultés et nous empêche de nous met-
tre à la place de l’autre en rendant diffi-
cile ce que Kant appelait « l’exercice de
notre mentalité élargie ».
La relation au corps souffrant
La question est alors de savoir pourquoi
le soin peut ainsi perdre sa raison d’être.
Faut-il y voir seulement le triomphe de
la technique et de la rationalisation face
à la logique du don ? Cette interpréta-
tion reste pourtant insuffisante. Une
autre raison plus spécifique se surajou-
te, elle touche à l’embarras que nos so-
ciétés modernes éprouvent vis-à-vis du
corps. Non pas d’un corps idéalisé, ce-
lui qui est mis en avant dans la publicité,
mais du corps « imparfait » tel qu’il est.
Un corps qui en subissant toutes les in-
famies du temps nous rappelle à notre
fragilité ontologique, un corps qui ne
cesse de contrecarrer notre volonté de
puissance. Pour parodier Nietzsche, un
corps humain, trop humain en somme.
Ainsi, sans recours à un médiateur
technique, la relation à l’autre souf-
frant et singulièrement à son corps se
vit difficilement. C’est dans cet esprit
que les soins palliatifs ont été long-
temps considérés comme une forme de
sous-médecine à laquelle on consenti-
rait de plus ou moins bonne grâce
quand « tout est perdu ». Cette dévalo-
risation serait en partie liée à l’aspect
peu spectaculaire des actes qu’on y pra-
tique, l’agir n’y étant pas techniquement
compliqué, mais « simplement » humai-
nement complexe. Dans ce cas, les soi-
gnants ne peuvent plus s’abriter derriè-
re la science ou la technique (ou comme
dans le passé dans la foi religieuse), ils
doivent faire face à autrui, affronter sa
souffrance, agir sans médiateur sur ce
corps malade, meurtri. En ce sens il
semble impossible de trouver la force
de vivre au contact de la souffrance des
corps lorsqu’on a perdu le sens du soin,
c’est-à-dire quand les soins s’adressent
exclusivement au corps-objet en occul-
tant le corps-sujet.
Retrouver l’intuition soignante
Nous avons tenté de définir le soin
comme un agir compassionnel, comme
une rencontre dont l’unique visée est
autrui. Relevant d’une forme de don, la
nature première du soin nous est appa-
rue profondément désintéressée. Ce
souci pour l’autre est à l’origine de la
démarche soignante, il fonde l’utilité
sociale du soignant. Ainsi, dans l’absolu,
l’acte de soin, s’il est agir compassionnel,
ne peut pas ne pas être éthique. Pour-
tant avec le développement de la méde-
cine moderne et la rationalisation des
soins, la question ne cesse de se poser.
Malgré toute leur bonne volonté, les
soignants sont amenés à pratiquer, sans
toujours s’en rendre compte, des actes
qui dans les faits oublient le malade et
dont les conséquences délétères peu-
vent aller jusqu’à nier sa dignité. Anne-
Laure Boch [10] évoque ici « l’aporie des
situations tragiques, car il est tragique que
je fasse le mal précisément en voulant faire
L’acharnement
thérapeutique en service
de réanimation
ou la maltraitance
de personnes âgées
en institution constituent
autant de formes
d’occultation de l’autre.

Ethique & Santé 2005; 2: 125-129 • © Masson, Paris, 2005 129
ARTICLE ORIGINAL
le bien ». C’est à partir de cette aporie
que se pose toute question éthique. La
seule issue est alors, semble-t-il, de re-
venir à l’essence première du soin. Ce
retour est toutefois loin d’être aisé car,
suivant la formule de Christian Gilioli
[11], « il est difficile de penser des pratiques
qui se pratiquent sans se penser ». Il n’est
en effet pas si aisé de devenir critique
vis-à-vis d’une rationalité qui nous a été
transmise par notre formation et nos
pairs. Retrouver l’intuition soignante,
cette forme de convocation à l’action
pour l’autre, demande un travail sur soi
considérable puisqu’il s’agit de s’arra-
cher à des automatismes qui nous im-
prègnent si fortement. Chaque soi-
gnant doit opérer une forme de retour
sur lui-même en recherchant les rai-
sons qui font que son agir n’est pas tou-
jours fidèle à son engagement premier.
Autrement dit quand cet agir ne
s’adresse plus à autrui comme fin en soi,
lorsqu’il perd son caractère compas-
sionnel.
En ce sens vouloir définir la nature
du soin lorsque l’on est soignant, c’est
bien rechercher les raisons profondes
de son engagement personnel en réacti-
vant des questions fondamentales, cel-
les que l’on ne se pose plus, peut-être
parce que l’on croit que les réponses
vont de soi : Qu’est-ce que soigner ?
Peut-on nuire en soignant ? Pourquoi
suis-je soignant ? Répondre à ces ques-
tions, c’est redonner du sens aux soins,
c’est comprendre que la question éthi-
que qui englobe toutes les autres est
celle de mon rapport à autrui. Le risque
majeur, ici comme ailleurs, est décidé-
ment bien celui de son oubli. D’autant
plus que cette question se pose au soi-
gnant, mais aussi à la collectivité dans
son ensemble. Il faut rappeler que la
manière dont une société prend soin
des plus faibles de ses membres témoi-
gne de son degré d’humanité.
Car indépendamment du marché
existera toujours (il faut du moins l’es-
pérer) une autre forme d’échange, une
relation qui permet de nourrir le lien
social.
Marcel Mauss [12] a ainsi montré
combien l’agir humain ne peut être sé-
paré de l’ensemble des normes, valeurs
et croyances collectives. Certes, il ne
s’agit pas de faire preuve de trop de naï-
veté. Le recours aux normes peut cacher
parfois des intentions intéressées. Néan-
moins, l’emploi de ces règles déontolo-
giques ne peut pas être qu’opportuniste,
une fois établies et pratiquées les normes
perdurent et nous engagent. Ainsi, en
revendiquant une déontologie profes-
sionnelle, le soignant établit ses propres
garde-fous et se place de lui-même sur
un terrain éthique. En cela il s’autocon-
trôle et limite son pouvoir en s’obligeant
moralement à une certaine forme de dé-
sintéressement. Autrement dit, une dé-
marche véritablement soignante tout en
étant prudente au sens aristotélicien se
doit d’être à la fois téléologique (se pro-
poser une fin morale) et déontologique
(la réalisation de cette fin bonne doit res-
pecter des normes morales).
La raison d’être du soin, sa force et
sa grandeur, se retrouve donc dans l’in-
tention du soignant-donataire, dans
son exigence d’humanité. Ainsi, lorsque
Paul Ricœur [13] cherchant dans la lut-
te pour la reconnaissance un horizon
d’espérer pose cette question : « N’y a-
t-il pas une ou des expériences dans lesquel-
les le mépris est surmonté ? » Nous se-
rions modestement tenté de lui répon-
dre qu’il en existe peut être une : le
soin6.
L’enjeu pour les soignants est au
fond de revenir à l’essence de la relation
soignante pour comprendre combien le
soin, comme don absolu, s’adresse à
autrui tel qu’il est, dans la singularité de
son histoire. La meilleure définition du
soin nous semble être alors incontesta-
blement celle de Claude Bruaire [14]
pour qui il est « l’expression active du res-
pect que l’on porte à une personne irrempla-
çable, nécessaire ».
Références
1. Habermas J. De l’éthique de la discussion,
Editions du Cerf, Paris, 1992 : 19.
2. Molinier. P. « Les métiers ont-ils un
sexe ? », Sciences Humaines n° 146, fé-
vrier 2004 : 36.
3. Sicard D. La lettre de l’espace éthique AP-
HP, hiver-été 2002.
4. Ricœur. P. Soi-même comme un autre, Pa-
ris, Seuil essais, 1990 : 163.
5. Camus A. La Peste, Paris, Gallimard, coll.
« Folio », 1947 : 125.
6. Richard G. Nature et formes du don, Paris,
L’Harmattan, 2000 : 112.
7. Misrahi R. Espace éthique, éléments pour
un débat. Travaux 1995/1996, sous la direc-
tion d’Emmanuel Hirsch, Paris, coédition
Doin/AP-HP, 1997 : 63.
8. Kant E. Fondements de la métaphysique
des mœurs, Paris, le Livre de poche, 1993 :
84.
9. Hesbeen W. « la pratique soignante : une
rencontre et un accompagnement ». Pers-
pective soignante, avril 1998 ; 1 : 25.
10. Boch A.-L. Médecine technique, médecine
tragique, DESS d’éthique médical et hospi-
talière, Université de Marne-La-Vallée
2001 : 11.
11. Gilioli C. Ethique médicale et modernité, la
question de la technique, Thèse de philoso-
phie, Université de Marne-la-Vallée, 2001 :
11.
12. Mauss M. Essai sur le don, forme et raison
de l’échange dans les sociétés archaïques, in
Sociologie et anthropologie, Paris, PUF,
« Quadrige », 1995.
13. Intervention de Paul Ricœur lors d’un débat
avec Jacques Dérida à la Maison de l’Améri-
que Latine organisée par France Culture
(diffusée le 4/01/2003).
14. Bruaire C., Une éthique pour la médecine, Pa-
ris, Fayard, 1978 : 109.
Retrouver l’intuition
soignante, cette forme
de convocation à l’action
pour l’autre, demande
un travail sur soi
considérable.
6. Du moins dans sa forme la plus pure. Un soin qui ne serait que soin, une Idée platonicienne du soin en quel-
que sorte. La réalité est évidemment beaucoup plus complexe.
1
/
5
100%