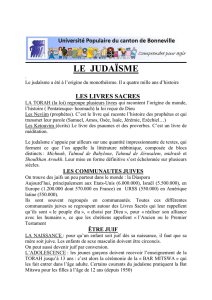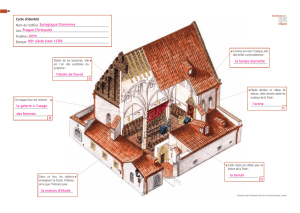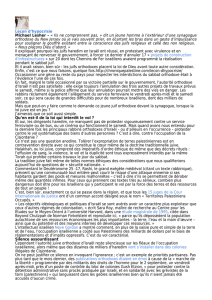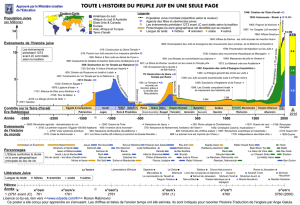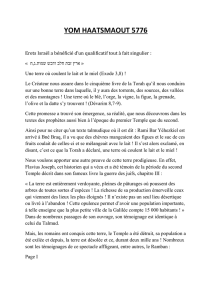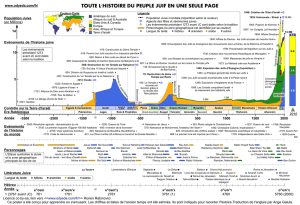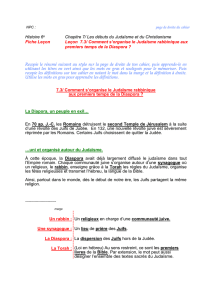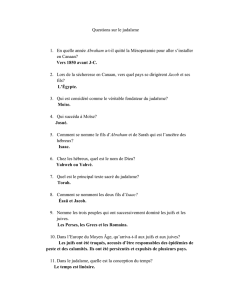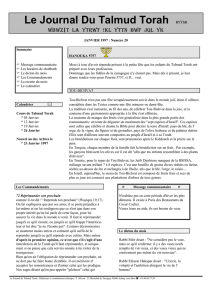À l`origine des rites juifs

Sommaire
Présentation
À l’origine des signes identitaires du judaïsme
par Christophe Lemardelé
• Calendrier lunaire et fêtes
• Rites de masculinité
• Les tabous alimentaires
• Le sang attire les démons
Entre héritage culturel et quête identitaire par Philippe Abadie
• Le sabbat, une double interprétation
• Une éthique sociale
• La circoncision : du rite initiatique au signe dans la chair
La cuisine de Moïse entretien avec Philippe Mercier,
propos recueillis par Estelle Villeneuve
L’élaboration de l’identité juive par les Sages du Talmud
par Dan Jaffé
• Les règles du sabbat
• La circoncision
• Les injonctions alimentaires
• Après la chute du Temple, de nouvelles liturgies

Les débats entre pagano et judéo-chrétiens sur les prescriptions
de la Loi par Folker Siegert
• Chrétiens d’observance mosaïque : ébionites, nazoréens,
elkasaïtes
• Épilogue concernant le pagano-christianisme
Grecs et Romains par Nicole Belayche
• Les pratiques alimentaires
• Les pratiques cultuelles
• Des excentricités coupables ?

Présentation
À l’origine des rites juifs
Les questions d’identité ne cessent de travailler nos sociétés et les débats autour
des signes religieux de se radicaliser. Au nom de sa vocation à éclairer les racines
bibliques de notre culture à la lumière des études récentes, Le Monde de la Bible
ne pouvait rester à l’écart de ces débats. Nous nous sommes donc interrogés sur
l’origine des « marqueurs » de l’identité juive, nous limitant aux emblématiques : la
circoncision, le sabbat et les interdits alimentaires.
Nous commencerons par un tour d’horizon de ces pratiques chez les voisins
d’Israël (Christophe Lemardelé). Il permettra de saisir la singularité de la relecture
théologique du sabbat et de la circoncision par les rédacteurs de la Torah au moment
de la reconstruction nationale après la crise de l’exil (Philippe Abadie) et la théologie
« nourrissante » de la vie qui se profile derrière les interdits alimentaires (Philippe
Mercier).
Nous mesurerons aussi le rôle de la tradition rabbinique dans la survie d’une
identité juive condamnée à disparaître après la fin du Temple en 70 ap. J.-C. (Dan
Jaffé).
Puis nous examinerons l’attitude des premières communautés chrétiennes
concernant les observances mosaïques (Folker Siegert).
Enfin, nous verrons comment l’Antiquité gréco-romaine a perçu les signes
extérieurs du judaïsme (Nicole Belayche) jusqu’à fantasmer l’image du juif. •
Estelle Villeneuve

À l’origine des signes
identitaires du judaïsme
Christophe Lemardelé
Chercheur associé de l’UMR 8167 - Orient et Méditerranée - Mondes sémitiques

Scène de circoncision. Le Caire, Papyrus Institute. Relevé sur papyrus d’un
bas-relief provenant de la tombe d’Ankhmahor Sesi, 2345 av. J.-C., Saqqarah
(Égypte). Le prêtre incise le prépuce à l’aide d’un couteau de silex ovale. En
Égypte, la circoncision ne semblait pas systématique, les prêtres exceptés.
© Wikimedia Commons
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%