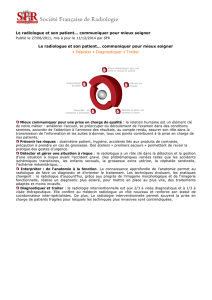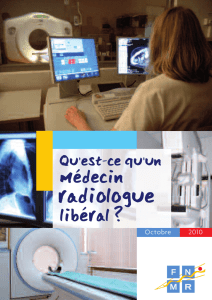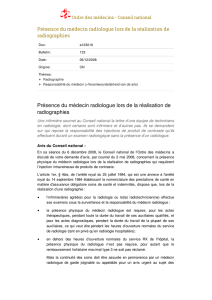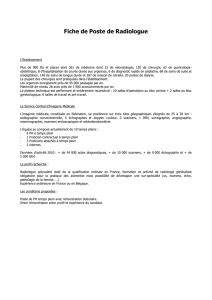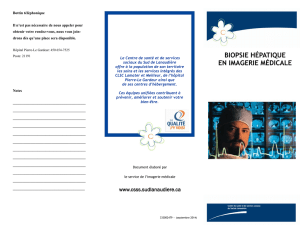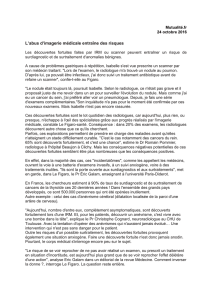La Tribune juridique du radiologue

Sommaire
En bref 1
Les complémentaires santé obligatoires
pour les employeurs au 1er janvier 2016
Comment affronter un problème de
trésorerie au moment de payer ses impôts ?
Qu’est-ce que le « 2 » barré sur les
dispositifs médicaux ?
Dans le cadre des études cliniques
proposées aux radiologues, qui peut
être rémunéré ? La société ? Le
radiologue lui-même ?
Les objectifs du Plan cancer 2014-2019
Jurisprudence 4
A propos de la faute du radiologue
libéral ayant entrainé le retard d’un
diagnostic de cancer du sein et de la
possibilité pour l’assureur de l’hôpital
de se retourner contre le praticien
libéral
Cas pratiques 6
1 Information et consentement du patient
à l’examen
2 Cinq conseils pour sélectionner votre
contrat de prévoyance
En bref
Lettre d’information juridique éditée par L’Entreprise Médicale
La Tribune juridique
du radiologue
Septembre 2014
Les complémentaires santé obligatoires
pour les employeurs au 1er janvier 2016
Bernard Corbin, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant FIDUCEE
GESTION PRIVEE
La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi (Loi n° 2013-504), conformément à
l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 (ANI), oblige les employeurs à
généraliser la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé avant le
1er janvier 2016.
Les radiologues qui emploient des salariés au sein de leur cabinet sont donc concernés
par cette obligation.
Actuellement, la mise en place d’une couverture collective santé obligatoire relève de la
décision des partenaires sociaux au niveau de la branche, au niveau de l’entreprise ou
de l’employeur de façon unilatérale.
Avec l’adoption de cette loi, des négociations à l’intérieur des branches pourront
intervenir afin de proposer aux salariés des cabinets de radiologie une couverture
santé collective obligatoire. A défaut d’accord, l’entreprise devra mettre en place, au
1er janvier 2016, une couverture minimum correspondant à un panier de soins de
125% du tarif de la Sécurité sociale pour les prothèses dentaires et 100 euros par an
pour l’optique. Le financement sera pris en charge à hauteur de 50% au moins, par
les radiologues employeurs.
Les partenaires sociaux pourront recommander un ou plusieurs organismes assureurs
dans un cadre défini par décret. Le cas échéant, les entreprises auront le choix entre
les contrats négociés et les contrats de leur choix à condition qu’ils soient au moins
aussi favorables que les contrats recommandés.

En bref
Le mois de septembre est toujours difficile : retours de
vacances, rentrée des classes, taxes locales (habitation
toujours et foncière si vous êtes propriétaire). Le manque
d’argent peut être douloureux, surtout si le paiement de
l’impôt sur le revenu (I.R.) s’effectue au tiers.
Or, il existe une possibilité de demander un délai
supplémentaire de paiement de l’I.R.
A condition de démontrer des difficultés financières
graves, ce délai supplémentaire pour payer ses impôts
est envisageable dans les cas où vous percevez
des revenus sous forme de traitements, salaires,
indemnités, pensions ou rentes viagères.
La demande doit être adressée au comptable du Trésor
du centre des finances publiques dont le contribuable
dépend, accompagnée de pièces justificatives.
Si le foyer fiscal dispose d’autres catégories de revenus
(BNC, BIC, revenus fonciers..), la baisse constatée de
ceux-ci est rapportée au montant de référence majoré
du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés
l’année précédente.
Acceptation d’office en cas de baisse de revenus de
plus de 30%
Le délai vous sera accordé d’office si, dans le mois où
la demande est formulée, les revenus de votre foyer
fiscal diminuent d’au moins 30% par rapport aux
3 mois précédents. Il existe pour cela un formulaire
spécifique ; les délais de paiement courent alors à
partir du mois de votre demande et jusqu’au 31 mars
de l’année qui suit la mise en recouvrement de l’impôt.
Un échéancier de l’impôt est envoyé.
Acceptation sur examen dans les autres situations
Concernant les autres situations (baisse de revenus
inférieure à 30%, lors d’un départ en retraite, d’un
divorce, d’un décès…), la demande fait l’objet d’un
examen approfondi.
Dans la majorité des cas, un délai de paiement de trois
mois est accordé s’il s’agit de la première demande
ou si l’échéancier demandé l’année précédente a
été respecté. Les chances de réussir sont augmentées
lorsque la requête est accompagnée de justificatifs
de ressources et d’un premier versement. En cas de
refus, il est possible de saisir le conciliateur fiscal
départemental.
Comment affronter un problème de trésorerie au moment
de payer ses impôts ?
Bernard Corbin, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant FIDUCEE GESTION PRIVEE
Le « 2 » barré dans un cercle apposé sur un dispositif
médical indique que ce dernier est à usage unique.
Par conséquent, ces dispositifs médicaux à usage
unique ne doivent pas être réutilisés ou ne doivent pas
bénéficier d’une procédure d’entretien en vue d’une
réutilisation quelle que soit leur utilisation initiale.
En effet, contrairement aux dispositifs médicaux
réutilisables où il est possible d’en faire un nouvel usage
en les nettoyant et stérilisant, les dispositifs médicaux à
usage unique ne connaissent pas le même sort, le risque
étant la modification des caractéristiques physiques et
organoleptiques.
L’objectif des dispositifs médicaux à usage unique est
de favoriser la sécurité des patients et des personnels,
vis-à-vis du risque infectieux. Dès lors qu’il existe
un dispositif médical à usage unique, son utilisation
demeure privilégiée.
Ainsi, lorsqu’il s’agira d’un matériel qui devra être
introduit dans le système vasculaire ou dans une cavité
ou un tissu stérile, le risque infectieux étant élevé, il sera
recommandé d’utiliser ce type de dispositif médical.
Sur le plan indemnitaire et en cas de préjudice créé
pour le patient, la réutilisation d’un dispositif médical à
usage unique, même nettoyé et stérilisé, engagerait une
responsabilité pour faute.
Sur le plan pénal, la responsabilité du professionnel
de santé pourrait également être retenue puisqu’il
contreviendrait aux règles d’utilisation de ces dispositifs
médicaux à usage unique donc aux règles élémentaires
de sécurité.
Dès lors qu’est utilisé un dispositif médical à usage
unique, ce dernier doit être obligatoirement éliminé
après son utilisation en fonction de la filière des déchets
à risque organisée dans l’établissement de soins.
Qu’est-ce que le « 2 » barré sur les dispositifs médicaux ?
Caroline Kamkar, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Lille
2

Le premier Plan cancer 2003-2007 a posé les bases
de l’organisation de l’offre de soins fondée sur la
transversalité des prises en charge, le développement
du dispositif d’annonce, de la prévention et du soutien
à la recherche. Tout en consolidant les acquis du Plan
précédent, le Plan cancer 2009-2013 a ouvert de
nouveaux chantiers : mise en œuvre des autorisations de
traitement du cancer, renforcement de la coordination
ville–hôpital, élaboration de programmes personnalisés
de l’après cancer.
Le 3ème Plan cancer s’inscrit dans la continuité d’une
véritable politique de lutte contre le cancer engagée
depuis 10 ans. L’objectif est d’impulser un nouvel élan
afin de mieux piloter les parcours de patients dans le
cadre d’une prise en charge globale et personnalisée,
en recherchant une adaptation rapide aux progrès
thérapeutiques. Pour cela, le 3ème Plan Cancer met
l’accent sur le continuum « recherche/prise en charge »
insuffisamment pris en compte dans les plans
précédents.
En effet, l’émergence d’une médecine personnalisée
invite à repenser les méthodes de diagnostic et de
traitement des cancers. Le 3ème Plan Cancer a pour
ambition de mobiliser tous les moyens d’intervention
disponibles, de la recherche jusqu’aux soins, pour faire
face aux inégalités de santé et réduire la mortalité liée
à des cancers évitables.
Le Plan 2014–2019 se construit sur 4 axes, répartis en
17 sous objectifs :
1. Guérir plus de personnes malades en favorisant
notamment les diagnostics précoces et en
réduisant les délais de prise en charge ;
2. Préserver la continuité et la qualité de vie en
assurant des prises en charges personnalisées ;
3. Investir dans la prévention et la recherche en
donnant à chacun les moyens de réduire son
risque de cancer ;
4. Optimiser le pilotage et les organisations
pour améliorer l’efficacité de notre système
de santé.
Le système de santé français en cancérologie est
performant, l’ambition de ce 3ème Plan est de l’améliorer
encore, mais aussi de le rendre plus équitable.
Les objectifs du Plan cancer 2014-2019
Malik ALBERT, Directeur Général Adjoint du Centre Antoine Lacassagne à Nice, Enseignant à l’Université de Nice
en droit de la santé
L’article L. 1121-1 al 4 du Code de la santé publique
(CSP) dispose : « La ou les personnes physiques qui
dirigent et surveillent la réalisation de la recherche
sur un lieu sont dénommées investigateurs ». L’article
L. 1121-3 du CSP précise notamment : « Les recherches
biomédicales (RBM) ne peuvent être effectuées que
si elles sont réalisées dans les conditions suivantes :
sous la direction et sous la surveillance d’un médecin
justifiant d’une expérience appropriée ». Il s’en déduit
donc que, dans le cadre d’une RBM, l’investigateur est
nécessairement un médecin personne physique.
Ainsi, une société de radiologues, y compris une
société d’exercice, ne saurait être investigateur d’une
RBM. Seul l’un des praticiens personne physique qui la
compose peut tenir ce rôle.
En outre, l’article L. 4113-6 du CSP qui prévoit
l’interdiction de tout avantage reçu notamment par
les médecins « procurés par des entreprises assurant
des prestations, produisant ou commercialisant des
produits pris en charge par les régimes obligatoires de
sécurité sociale » prévoit aussi que cette interdiction
ne s’applique pas « aux avantages prévus par
conventions passées entre les membres de ces
professions médicales et des entreprises, dès lors que
ces conventions ont pour objet explicite et but réel des
activités de recherche ou d’évaluation scientifique ».
Ainsi, s’il est possible de conclure une convention de
recherche avec une personne morale, notamment une
association, il est conseillé de la conclure « en présence »
de l’investigateur personne physique. En outre, il
conviendra de tenir compte des règles applicables en
matière de dessaisissement d’honoraires et surtout des
incidences et risques fiscaux dans de telles hypothèses.
Dans le cadre des études cliniques proposées aux radiologues,
qui peut être rémunéré ? La société ? Le radiologue lui-même ?
Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon
3

Jurisprudence
Faits
A propos de la faute du radiologue libéral ayant entrainé le retard
d’un diagnostic de cancer du sein et de la possibilité pour l’assureur
de l’hôpital de se retourner contre le praticien libéral
Commentaire de la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2013
Caroline Kamkar, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Lille
En 1993, une patiente suivie dans le service de
gynécologie du Centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges consulte un médecin libéral
radiologue pour une mammographie. Le radiologue
constate un nodule à droite.
En 1994, une seconde mammographie est réalisée. Le
radiologue, dans ses conclusions, élimine toute image
anormale, cantonnant son examen à l’exploration
volumétrique du kyste connu et d’autres petits kystes
bilatéraux.
En 1996, la patiente consulte de nouveau dans le service
de gynécologie du Centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges où sera diagnostiqué un cancer
du sein bilatéral.
La patiente soulève un retard de diagnostic de sa
maladie et souhaite engager la responsabilité du Centre
Hospitalier.
4
Rédaction achevée au mois de juillet 2014. Textes sujets à
d’éventuelles modifications, notamment d’ordre légal, réglementaire
ou jurisprudentiel.
La Tribune juridique du radioLogue
est une lettre d’information
professionnelle destinée aux radiologues hospitaliers et
libéraux. Les informations qui y sont contenues ont un caractère
général et ne sauraient répondre aux questions relevant de
situations particulières ni engager la responsabilité de Guerbet.
Ces dernières seront examinées au mieux dans le cadre de
la consultation d’un expert habilité, membre d’une profession
juridique réglementée. Les textes publiés dans la Tribune juridique
du radiologue sont l’expression de l’opinion personnelle de leurs
auteurs.
direcTeur de La pubLicaTion :
Jean-Luc Balança -
direcTeur de La rédacTion :
Dr François Prieur -
onT parTicipé à La rédacTion de ce numéro :
Malik
ALBERT, Directeur Général Adjoint du Centre Antoine Lacassagne à
Nice, Enseignant à l’Université de Nice en droit de la santé ; Audrey
Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon ; Bernard Corbin, Conseiller
en gestion de patrimoine indépendant FIDUCEE GESTION PRIVEE ;
Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris ; Caroline
Kamkar, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Lille.
médecin-conseiL
: Docteur Frédéric Plagnol, Radiologue -
sociéTé édiTrice :
L’Entreprise Médicale, SARL au capital de 104 940 F, RCS Nanterre,
SIRET 377 562 277 000 48, Siège social : 3 bis, rue du Dr Foucault
- 92 000 Nanterre -
concepTion eT réaLisaTion :
L’Entreprise Médicale -
dépôT LégaL :
à parution - issn : 1281-0266.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par
quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente
publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue
une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (loi du
1er juillet 1992).
Suite page 5
Procédure
La patiente saisit le Tribunal administratif en première
instance.
Le dossier fera l’objet d’un appel devant la Cour
administrative de Paris qui, dans un arrêt en date du
28 décembre 2005, condamne la société Mutuelle du
Mans IARD (MMA), assureur de l’hôpital, à indemniser
la patiente atteinte d’un cancer du sein, et l’Etat,
son employeur, des préjudices subis par celle-ci et
imputables au retard de diagnostic de sa maladie par
un médecin du service de gynécologie.
L’assureur de l’hôpital a engagé une action récursoire
à l’encontre du médecin libéral radiologue en raison
de la faute commise consistant au retard de diagnostic.
La patiente a subi un préjudice moral directement
imputable au retard de diagnostic estimé entre 18 mois
et deux ans.
Une seconde action judiciaire est exercée sur ce point.
Par un arrêt en date du 23 mars 2012, la Cour d’Appel
de Paris rejette l’action récursoire de la société Mutuelle
du Mans IARD (MMA) à l’encontre du médecin libéral
radiologue qui avait examiné la patiente antérieurement
et qui avait « sous-évalué » le diagnostic. La Cour
d’Appel estime que la faute du médecin radiologue,
pour n’avoir pas ordonné d’examens complémentaires,

Observations
Cet arrêt de la Cour de Cassation permet deux
observations essentielles.
D’une part, il rappelle que le retard de diagnostic
peut constituer une faute dans la prise en charge du
patient. Cette analyse n’est pas nouvelle ; en fonction
des circonstances de fait, le retard de diagnostic ou le
fait pour un praticien de ne pas prescrire d’examens
complémentaires ayant pour conséquences un retard de
diagnostic est une faute.
En effet, une erreur ou un retard de diagnostic ne
constituent pas en soi des fautes de nature à engager la
responsabilité du médecin si, toutefois, elles ne résultent
pas d’une méconnaissance des données acquises de
la science. Autrement dit, dès lors que n’importe quel
professionnel de santé, aussi diligent soit-il, pourrait
commettre, dans les mêmes conditions, cette même
erreur ou ce même retard de diagnostic, ce dernier ne
serait pas considéré comme fautif.
En l’espèce, selon les experts désignés, les examens
radiographiques étaient techniquement corrects et la
lecture par deux fois et auprès de deux praticiens a laissé
passer une image suspecte : l’erreur est fautive.
D’autre part, l’arrêt rappelle la possibilité offerte à un
assureur qui aurait indemnisé le préjudice total d’une
patiente victime d’un acte médical fautif de former un
recours à l’encontre du co-responsable.
En effet, la Cour de cassation vise l’article 1251 du
Code civil qui dispose notamment que « la subrogation
a lieu au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou
pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de
l’acquitter ».
L’action récursoire peut être définie comme un recours
en justice exercé par celui qui est tenu de l’exécuter en
tant que débiteur solidaire, garant ou responsable du
fait d’autrui contre le débiteur d’une obligation juridique.
Celui qui est tenu d’exécuter pourra demander le
remboursement de tout ou partie à celui qui est déclaré
co-responsable à proportion de sa reconnaissance de
responsabilité.
En l’espèce, l’assureur du Centre Hospitalier a indemnisé
la totalité des préjudices qu’a subi la patiente victime
du retard de diagnostic. Toutefois, la faute du médecin
radiologue exerçant à titre libéral est constatée. C’est
pourquoi, l’assureur du Centre Hospitalier a pu engager
une action récursoire à l’encontre du médecin radiologue
exerçant à titre libéral afin d’obtenir le remboursement
dans la limite des fautes commises.
Procédure
a contribué pour moitié au dommage. De plus, la Cour
Administrative d’Appel avait condamné l’hôpital à
supporter la moitié des sommes revenant à la patiente et
à l’Etat, son employeur.
La société Mutuelle du Mans IARD (MMA) forme un
pourvoi en cassation.
Elle reproche à la Cour d’Appel de Paris d’avoir rejeté
cette action récursoire alors qu’il a pu être admis, tant
par les rapports établis par les divers experts commis
par la juridiction judiciaire de 2006 mais aussi par
celles de l’ordre administratif de 1998, que le médecin
radiologue avait commis une faute consistant en un
retard anormal de diagnostic.
La Cour de cassation, dans sa décision en date du
3 juillet 2013, casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris
précisant qu’elle n’a pas tiré toutes les conséquences
des dispositions du Code civil en statuant ainsi alors
qu’elle avait constaté que le médecin radiologue avait
contribué, pour moitié, par sa faute, à ce retard et que
la Cour Administrative d’appel avait mis à la charge de
l’hôpital, en totalité, des sommes représentant la moitié
des inconvénients supportés par la patiente en raison de
sa maladie et de ses traitements, imputables au retard
de diagnostic. Par conséquent, l’assureur bénéficiait à
l’encontre du médecin radiologue d’un recours dans la
mesure des fautes commises.
5
• -1993 : consultation par la patiente du médecin radiologue qui réalise une première mammographie.
• 1994 : deuxième mammographie réalisée concluant à la présence d’un kyste connu et de nouveaux kystes.
• 1996 : diagnostic d’un cancer du sein bilatéral.
• 1998 : première expertise médicale concluant à un retard de prise en charge fautif
• 28 décembre 2005 : arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris condamnant la société Mutuelle du Mans IARD (MMA), assureur de l’hôpital intercommunal
de Villeneuve Saint Georges, à indemniser la patiente et son employeur des préjudices subis par celle-ci et imputables au retard de diagnostic de sa maladie par un
médecin du service de gynécologie.
• 2006 : seconde expertise médicale confirmant la première expertise : le radiologue libéral a commis une faute dans son retard de diagnostic.
• 23 mars 2012 : arrêt de la Cour d’Appel de Paris rejetant le recours subrogatoire de l’assureur du Centre Hospitalier contre le médecin radiologue.
• 3 juillet 2013 : arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris.
Points clé du dossier
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%