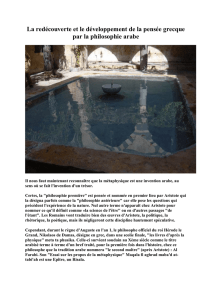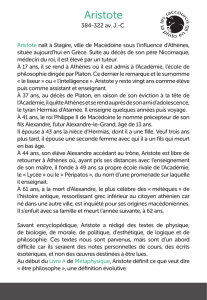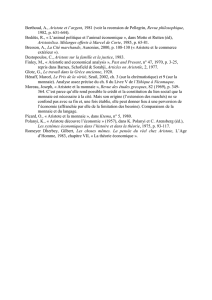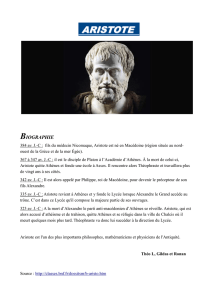de l`inauthenticité du livre e de la métaphysique d`aristote.

LES vicissitudes des textes n’ont pas fini de nous surprendre. Déjà,
à en croire Pétrarque, un témoin majeur des retrouvailles avec
l’Antiquité à la pré-Renaissance, Aristote avait à souffrir de
l’ignorance ou de l’envie de ses « traducteurs » : Interpretum ruditate
vel invidia ad nos durus scaberque pervenit. Le témoignage a d’au-
tant plus de valeur qu’il provient d’un homme qui goûte peu Aristote,
et moins encore cet Aristote défiguré. Sans doute le régal de pensée
qu’offre l’auteur de la Métaphysique reste-t-il toujours un peu rêche ;
encore faut-il ne pas se tromper d’aliment. Avec l’étude qui suit, il ne
s’agit de rien de moins que de la disqualification d’un livre entier de la
Métaphysique, pourtant incontesté depuis deux mille ans. Découverte
exceptionnelle, pour ne pas dire unique, en histoire de la philosophie : le
livre F de la Métaphysique, auquel des siècles d’interprétation ont
attribué une fonction architectonique, fondée sur l’identité de la philoso-
phie première et de la théologie, est inauthentique. Authentiques en
revanche sont L 7 et 8, magnifique premier et unique programme onto-
logique d’Aristote, dont la réhabilitation philologique attend désormais
sa réhabilitation philosophique. Qui est le faussaire ? Andronicos de
Rhodes, au 1er siècle avant J.-C. Quel est son but ? Souder les ensembles
A-E et G-M pour faire un livre artificiellement unifié, « la » Métaphy-
sique, et occulter ce qu’il ne parvenait pas à comprendre, la doctrine de
l’être-vrai du livre J.
DEL’INAUTHENTICITÉ DU LIVRE E
DE LA MÉTAPHYSIQUE D’ARISTOTE.
443-512 24/06/08 9:31 Page 443

Avec l’éviction du faux livre Fet, par conséquent, avec le congé
signifié aux questions incertaines qu’il a suscitées, doivent s’imposer
désormais les conditions d’un renouveau des études sur Aristote. Emma-
nuel Martineau les inaugure en établissant la chronologie — enfin ren-
due possible — des sept « cours et conférences » qui composent la Méta-
physique dans l’ordre de sa conception.
L’enjeu indiqué est trop considérable pour que la démonstration
qu’il requiert puisse être abrégée ; il fallait établir de façon philologi-
quement et philosophiquement certaine ce qui d’abord fut vu. D’où la
dimension de l’étude que nous publions ; elle est celle de l’attention.
Conférence.
CONFÉRENCE
444
443-512 24/06/08 9:31 Page 444

Ce qui est difficile, c’est de n’être
jamais dupe, et cependant de tout croire
de l’homme. Alain, Stendhal.
W.W. Jaeger, in memoriam.
Plan de l’étude.
A. Authenticité de K 7-8, inauthenticité d’E.
I. K 7, 1063b36-1064a10 (cf. E 1, 1025b3-18).
II. K 7, 1064a10-b14 (cf. E 1, 1025b18 - 1026a32).
1. Le jargon d’E 1.
2. Les erreurs d’E 1.
3. L’émergence de l’Ωμ † ºμ en K 7.
III. K 8 (cf. E 2-4).
B. La véritable chronologie de la Métaphysique.
Les chapitres 7 et 8 du livre K de la Métaphysique d’Aristote
forment un « parallèle » au livre le plus court (exception faite pour
l’apocryphe `) de la même collection, à savoir E. Or, tandis que
l’authenticité d’E n’a, à notre connaissance, jamais été révoquée
en doute, on sait que la plupart des spécialistes ont contesté celle
DEL’INAUTHENTICITÉ DU LIVRE E
DE LA MÉTAPHYSIQUE D’ARISTOTE.
EMMANUEL MARTINEAU.
443-512 24/06/08 9:31 Page 445

de K1. Sans prendre dès l’abord de position ferme sur l’ensemble
de ce dernier livre, nous nous proposons de démontrer au
contraire que ses chapitres 7 et 8, tout au moins, sont bien de la main
d’Aristote, et qu’il convient donc d’interpréter E comme un « arrange-
ment » postérieur de ces textes, dû à l’intervention aussi intempestive
que zélée d’un compilateur ancien. Nous procèderons comme
suit : nous relirons K 7-8 et nous l’accompagnerons de diverses
remarques destinées à établir l’infériorité littéraire et doctrinale
de la plupart des énoncés « correspondants » d’E (A) ; puis nous
montrerons qu’il résulte de l’élimination d’E des conséquences
décisives pour une future édition qui serait enfin sérieuse, c’est-à-
dire chronologique, de la Métaphysique (B).
Avant que d’écouter le Philosophe, un bref rappel s’impose
au sujet de l’histoire mouvementée de l’interprétation de K. Dans
ses célèbres Études de 1912, Werner Jaeger, le principal avocat de
ce livre, écrivait : « De notre analyse, il ressort que les pensées
exposées en K portent une empreinte rigoureusement aristotéli-
cienne (durchaus streng aristotelisches Gepräge tragen) »2. Même si
nous n’avons pas besoin de l’étendre à K 1-63, nous voudrions sou-
CONFÉRENCE
446
1On se rafraîchira la mémoire dans B. Dumoulin, Analyse génétique de la
Mét. d’Ar., thèse soutenue en 1979, publiée en 1986, p. 147s. Sur K 7-8,
v. aussitôt les p. 158-161. On remarquera que le chapitre 8 n’inspire à
l’auteur que trois lignes de commentaire — et cinq lignes à V. Decarie
dans son article complètement arbitraire, « L’authenticité du livre K de
la Mét. », dans le coll. Zweifelhaftes im Corpus aristotelicum, Berlin-New York,
1983, p. 314. Heureusement, la dernière de ces cinq lignes avoue que
« l’ordre des matières semble moins confus dans K 8 que dans E 2-4 ».
C’est le moins que l’on puisse dire.
2W. Jaeger, Studien zur Entstehungsgeschichte der Met. des Ar., Berlin,
1912, p. 86.
3L’authenticité de 7 et 8 nous important seule ici, rappelons simple-
ment que l’une des principales objections opposées à celle de K envi-
sagé (abusivement) comme « totalité » est la présence de la double
particule z| ¥çμ, sinon absente du corpus, en 1060a5, 17 et 20,b3 et
443-512 24/06/08 9:31 Page 446

ligner que c’est ce jugement qui nous a mis sur la voie de la décou-
verte. Aussi cette étude se conçoit-elle naturellement comme un
modeste hommage à la mémoire de l’helléniste allemand : Jaeger,
comme tous ses devanciers et successeurs — Martin Heidegger y
compris —, s’est laissé tromper par l’auteur d’E, mais comme il
avait pressenti quelque chose de l’énigme de K, il n’est que de
prolonger son intuition pour résoudre le faux mystère d’E.
A. AUTHENTICITÉ DE K 7-8, INAUTHENTICITÉ D’E
I. K 7, 1063b36-1064a10 (cf. E 1, 1025b3-18)4.
Toute science recherche certains principes et certaines causes
pour chacun des objets qu’elle connaît, ainsi par exemple, la
médecine, la gymnastique et chacune des autres sciences poié-
tiques et mathématiques. Chacune d’elles, en effet, circons-
crivant pour elle-même (`Ã…°) un certain genre, s’occupe de
celui-ci comme d’un subsistant (Ã√cƒ¤∑μ) et d’un étant, pris
non pas en tant qu’étant cependant, car de celui-ci s’occupe
une science autre que les sciences citées. De ces sciences, cha-
cune prend en quelque sorte le « ce que c’est » dans chaque
genre pour sujet, et s’efforce de démontrer le reste avec plus
447
EMMANUEL MARTINEAU
12,1061b8 et 1062b33 (L. Spengel, P. Natorp ; cf. Jaeger, p. 87). Or, comme
on voit, aucune de ces sept occurrences n’appartient à 7 et 8 ! Il est
donc au moins imprudent de parler sans plus de précisions de
« l’usage fréquent et insolite de la particule z| ¥çμ » en K (P.Aubenque,
« Sur l’inauthenticité du livre K de la Mét. », dans Zweifelhaftes…,op.
cit., p. 320, article qui, lui non plus, ne souffle mot de K 8). — Sur la
position de Natorp, v. encore W. Jaeger, op. cit.,p.84.
4Nous retouchons librement la traduction de J.Tricot, 1964.
443-512 24/06/08 9:31 Page 447
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
1
/
67
100%