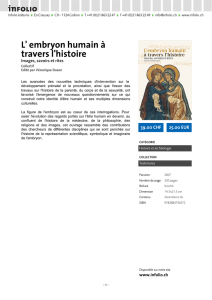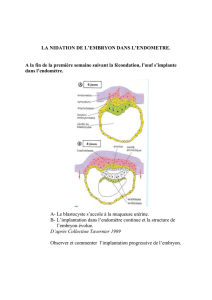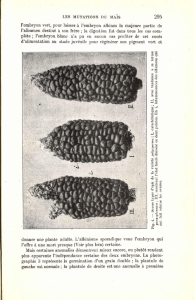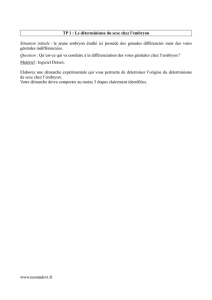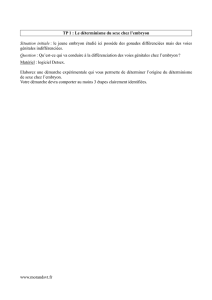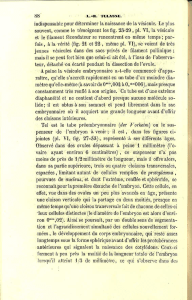Épreuve écrite de BIOLOGIE

Banque Agro Veto. Session 2009
Rapport sur le concours B ENV
Épreuve écrite de BIOLOGIE
Concours Nombre de
candidats Moyenne Ecart-type Note la plus
basse Note la plus
haute
B ENV 392 7,8 4,13 0 18
Le sujet proposé concernait l’étude des relations qui s’installent entre l’acquisition des
annexes embryonnaires et la conquête du milieu terrestre chez les Vertébrés. Dans un premier
temps, il fallait analyser le développement des Amphibiens qui, d’une part, sont très inféodés aux
eaux douces et, d’autre part, n’ont aucune annexe embryonnaire. On devait ensuite envisager la
mise en place de ces annexes chez les Oiseaux et les Mammifères, tandis qu’ils gagnent le milieu
terrestre. Entre les Oiseaux et les Mammifères, une distinction devait être opérée, puisque les
premiers sont ovipares et n’ont aucune relation organique avec la mère, tandis que les seconds
sont vivipares et se développent dans l’utérus maternel, avec lequel ils contractent des relations
très importantes. Un plan en trois points était donc opportun.
Dans une première partie, il fallait s’intéresser au développement embryonnaire des
Amphibiens en prenant l’exemple d’un Anoure (grenouille, xénope,..), où chacun des événements
se déroule en phase aquatique. Les œufs sont nombreux et libérés dans l’eau. La fécondation est
externe et ne nécessite pas de pénis. Chaque étape du développement devait être
analysée :morula, blastula, gastrula, neurula, bourgeon caudal, éclosion par rupture de la
membrane ovulaire et sortie d’une très petite larve (têtard). Il fallait insister sur les phénomènes
cellulaires qui sous-tendent les étapes précédentes :
- segmentation inégale de l’œuf fécondé hétérolécithe (moyenne richesse en réserves vitellines)
créant des macromères et des micromères.
- déplacements cellulaires et mouvements morphogénétiques (gastrulation par invagination,
convergence, divergence, épibolie) qui président à l’installation du plan d’organisation de
l’embryon. Les moteurs de ces mouvements pouvaient être mentionnés (protéines matricielles
dont la fibronectine).
- différenciation en feuillets (ectoderme, mésoderme, endoderme). Sans entrer dans les détails,
évidemment, on pouvait rappeler la mise en évidence expérimentale de ces feuillets
(immunofluorescence,..) et suggérer le rôle des inductions, ainsi que l’implication des divers
signaux (facteurs de croissance,..).
La satisfaction aux impératifs nutritionnels devait être soulignée : apport de nutriments
d’origine vitelline, diffusion d’oxygène depuis l’eau, rejet d’ions ammonium.

Dans une seconde partie, il fallait traiter le développement embryonnaire des Oiseaux,
espèces ovipares, dont les œufs sont libres et pondus en milieu terrestre. L’œuf de poule était un
bon exemple à étudier.
Très tôt se constitue un blastodisque à la surface de l’énorme masse vitelline de l’œuf
télolécithe (“ jaune ”). Un rappel des événements cellulaires affectant cet embryon était souhaité :
mouvements morphogénétiques, différenciation des feuillets, ligne primitive, nœud de Hensen).
Mais, très vite, il fallait en venir aux adaptations au milieu terrestre. La fécondation est interne et
suppose la présence d’un pénis mais, surtout, les annexes embryonnaires qui se développent
jouent un rôle primordial dans cette transition écologique.
Très vite, l’embryon est coiffé par une membrane (amnios) qui délimite une cavité
contenant un liquide (liquide amniotique). Cette première annexe maintient l’embryon en phase
aquatique. Un milieu “ sec ” interdirait toute survie.
Un peu plus tard, se forme la seconde annexe embryonnaire, le sac vitellin, dont la paroi
tend à entourer le vitellus. Celui-ci, qui comporte entre autre de la vitellogénine, sera digéré par la
composante endodermique de la paroi vitelline, grâce à ses enzymes, comme le ferait
l’épithélium intestinal. Les métabolites obtenus sont transportés vers l’embryon par les veines
vitellines, qui se sont différenciées aux dépens du mésoderme de la paroi vitelline.
La troisième annexe, la cavité allantoïdienne, se met en place la dernière. Elle favorise
l’apport d’oxygène à l’embryon, puisque les vaisseaux sanguins de sa paroi sont très proches des
membranes coquillières, au demeurant amincies. Elle participe à la résorption du “ blanc ”, dont
les métabolites sont récupérés par l’embryon. Elle contribue aussi à la mobilisation du calcium
de la coquille, en prélude à la construction du squelette de l’embryon. Enfin, des urates
s’accumulent dans cette cavité; leur présence ne nécessite aucun apport hydrique et évite toute
perte d’eau à l’intérieur de l’œuf. Le passage au milieu terrestre suppose un besoin en eau pour la
survie de l’embryon mais, aussi, une économie poussée à son maximum de ce liquide.
Dans une troisième partie, il fallait envisager le développement embryonnaire des
Mammifères, espèces vivipares, puisque les événements se poursuivent dans l’utérus maternel.
Le choix de l’espèce humaine était opportun.
On pouvait brièvement rappeler les premiers stades du développement du blastocyste,
d’ailleurs assez voisins de ce que l’on observe chez les Oiseaux. Mais il fallait insister sur le rôle
des annexes dans l’adaptation au milieu terrestre et tout particulièrement sur celui du placenta.
Les annexes présentes chez les Oiseaux sont retrouvées chez les Mammifères, mais leur
apparition est beaucoup plus précoce. La cavité amniotique maintient l’embryon en phase
aquatique. Le sac vitellin est très réduit (lécithocèle), puisque le vitellus a pratiquement disparu
(œuf alécithe). La cavité allantoïdienne est également rudimentaire.
Par contre, une annexe acquiert une place prépondérante, le placenta. Sa précocité est
compatible avec l’urgence des rapports materno-fœtaux, dictée entre autre par un besoin de
nutriments, d’oxygène… Il fallait décrire le placenta discoïdal de l’espèce humaine, envisager le
rôle de l’allantoïde dans l’apparition de la circulation placentaire fœtale. On se devait d’insister
sur l’importance des échanges permis au niveau du placenta par sa grande surface, la faible
distance des vaisseaux utérins et fœtaux. L’oxygène, le dioxyde de carbone, le glucose, les
protéines, les lipides, les sels minéraux, l’urée.…traversent l’organe. Des considérations touchant
la manière dont ces substances sont mobilisées étaient les bienvenues (concentrations différentes,
pH, transporteurs,..). Le rôle de barrière devait aussi être évoqué. Hors de l’espèce humaine, on
pouvait aussi dire quelques mots sur les types de placentas selon la vascularisation, le degré
d’intimité avec l’utérus. Il fallait bien faire ressortir que la survie de l’embryon dans la cavité

utérine, chez des espèces devenues terrestres, suppose d’intenses échanges avec l’organisme
maternel, protecteur à plus d’un titre.
La lecture des copies nous a conduit à un certain nombre de réflexions. Beaucoup de
candidats ne savent pas rédiger une introduction et indiquer la manière avec laquelle ils
envisagent le sujet.
Le développement embryonnaire des Amphibiens est généralement connu. Mais le rôle
des annexes dans le développement des Oiseaux et des Mammifères est souvent traité de manière
insuffisante, voire fausse. Bien des méconnaissances quant à leur structure, leur mise en place. La
biologie du placenta n’est pas connue ou trop superficiellement abordée. Presque toujours, les
relations entre l’acquisition des annexes embryonnaires et le passage au milieu terrestre ne sont
pas dégagées. De temps à autre, les candidats s’épanchaient dans des hors sujet : avant de
commencer à rédiger, il est donc indispensable de bien lire le libellé, de le circonscrire;
rappelons à ce propos l’intérêt de l’introduction qui permet d’apprécier la compréhension du
candidat face au sujet. La conclusion est indispensable aussi : en quelques lignes, elle résume les
points forts du devoir, pour la plus grande satisfaction de l’examinateur et l’importance de la
note. Pour ce qui concerne la forme, beaucoup de copies sont à la limite de la lisibilité. La
syntaxe est souvent approximative. Il en résulte une grande confusion et un verbiage noyant les
points essentiels. L’orthographe reste défaillante. Une bonne iconographie, claire, bien légendée,
aurait grandement amélioré la qualité des devoirs : ce fut rarement le cas.
Des références à l’expérience sont souhaitables, quand cela est possible, et sans que l’on
entre nécessairement dans les détails. Elles confirmeraient simplement que le candidat est
conscient que toute connaissance s’appuie sur un travail en laboratoire. Sa note ne pourrait que
s’en ressentir ?
Des considérations d’ordre génétique ont parfois émaillé les devoirs. Elles ne sont pas
totalement hors sujet. Mais, attention ! La génétique ne doit pas être considérée comme un simple
vocabulaire et, quant on l’introduit, elle doit s’intégrer de manière logique à la vie de l’organisme
et exclure tout “ saupoudrage ”. Un effort de synchronisation serait peut-être souhaitable dans la
conception des programmes, avec rééquilibrage de la biologie des organismes et biologie
moléculaire ?
Correcteurs: Jean-Claude CALLEN, Jacques HOURDRY (rapport), Catherine REEB

1
/
4
100%