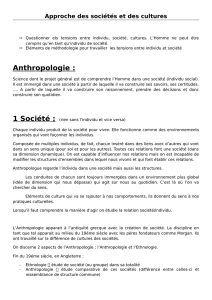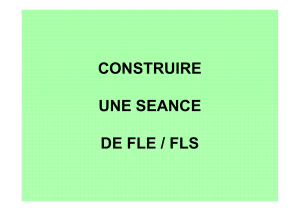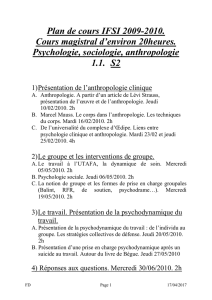L`étudiant étranger et ses "compétences culturelles": la formation à l

Education et Sociétés Plurilingues n°9-décembre 2000
L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles": la formation à
l’interculturel en question(s)
Aline GOHARD-RADENKOVIC
Interrogations
La question qui nous préoccupe aujourd’hui (1) est de discerner les
compétences et stratégies nécessaires à tout étudiant en formation
universitaire ou professionnelle à l’étranger, qui lui permettraient de
communiquer couramment en langue étrangère dans un contexte autre que
le sien. Cette interrogation ne traduit pas uniquement une réflexion
didactique. En ce qui me concerne, elle s’est progressivement formulée lors
d’un parcours personnel, soit plusieurs années dans six pays différents où il
m’a fallu inventer, de manière empirique mais pas toujours appropriée, les
stratégies de survie linguistique, d’adaptation socioculturelle et de
communication professionnelle. En effet, mes fonctions m’ont conduite à
travailler en étroite collaboration avec divers interlocuteurs locaux sur des
politiques de coopérations linguistiques et éducatives.
Dans ces situations d’exil extérieur ou d’exotopie, j’ai été également
confrontée à une situation d’exil intérieur (Todorov, 1991), devant remettre
en question un certain nombre de repères habituels, de certitudes et valeurs
héritées qui étaient parfois en contradiction totale avec celles de mon
environnement étranger (par exemple, en Russie avec l’imbrication du
privé et du professionnel à travers des réseaux de solidarité et de
cooptation; ou en Corée du sud, avec la représentation du rôle de la femme
et ses comportements de “modestie” attendus, quel que soit son statut
social). La nécessité de me tourner vers les concepts et outils d’analyse de
l’anthropologie sociale et culturelle (2) s’est avérée rapidement
indispensable pour désapprendre à “juger” spontanément à partir de ma
propre grille d'interprétation socioculturelle et à construire une
connaissance davantage raisonnée des sociétés dans lesquelles j’évoluais.
Ces concepts m’ont aidée à dédramatiser un certain nombre de situations
qui me paraissaient absurdes, incompréhensibles, pouvant menacer mon
intégration sociale dans le pays étranger, voire même mon équilibre
personnel.
La conception d'une dimension socioculturelle a investi depuis peu le
champ de la didactique des langues – qui est le nôtre – et soustend de plus
en plus les formations linguistiques destinées aux étudiants étrangers
pratiquant une “mobilité” volontaire (3). Leurs séjours à l’étranger sont
intégrés dans les cursus grâce aux accords interuniversitaires, bilatéraux et

A. Gohard-Radenkovic, L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles"
multilatéraux, aux plans européen et international. L’objectif partagé par
ces exilés temporaires est de mener à bien leur projet académique dans une
discipline autre que la langue. Le séjour d'études dans un contexte
exolingue possède donc un réel enjeu.
Caractéristiques des étudiants "mobiles"
Nous assistons depuis une vingtaine d’années à une véritable émergence
d’un marché des langues, qui se traduit par de nouveaux enjeux, de
nouvelles motivations, des besoins et comportements spécifiques des futurs
usagers des langues (Porcher, 1987). Cette conception pragmatique de
l'apprentissage des langues implique nécessairement la reconnaissance des
formations diplômantes acquises à l'étranger.
Les langues étrangères ont acquis une nouvelle légitimité par l’obtention de
diplômes reconnus sur le plan international, tels que les Delf et Dalf
(Diplôme d'étude de la langue française et Diplôme approfondi de la langue
française, cf. Oliviéri, 1993). La demande des candidats à la mobilité pour
de telles certifications va croissant: ce processus répond au besoin de se
constituer un petit “capital-langues” grâce à un système de crédits (ou
unités de valeur). C’est une démarche à la fois pragmatique et symbolique,
qui participe à la construction de leur “capital-diplômes” sur un marché de
l’emploi européen – et plus largement international – en quête de profils
plurilingues et polyvalents, préparés à une grande adaptabilité
socioculturelle et socioprofessionnelle.
Le cadre dans lequel j’interviens participe à cette demande sociale en
langues mais dans un contexte particulier: en effet, nous avons affaire à des
étudiants des programmes européens Socrates, ayant des motivations très
précises, puisqu’ils ont choisi une université proposant des filières et
diplômes bilingues (avec l’anglais comme langue de communication
internationale) dans diverses disciplines (ex. sciences juridiques,
économiques, sciences de la matière, humaines et sociales, etc.). Ces
étudiants vont vouloir très vite réinvestir leurs acquis linguistiques (en
français ou en allemand et en anglais) dans leur domaine de spécialisation.
En d’autres termes, nos publics doivent donc être très rapidement
opérationnels avec leurs compétences langagières et leurs capacités de
communication au sein d’un contexte universitaire et quotidien bi-
plurilingue dans lequel ils doivent faire aboutir leur projet d’études:
acquérir de nouveaux savoirs disciplinaires et de nouveaux savoir-faire
académiques par le truchement de deux ou trois langues dont les usages
vont varier en fonction des stratégies et des enjeux de chacun d’entre eux.

A. Gohard-Radenkovic, L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles"
En conséquence, ils doivent être capables de percevoir et d’appréhender
très rapidement leur nouveau contexte socioculturel car la plupart d’entre
eux effectuent des séjours courts, tels les programmes Erasmus allant de six
à douze mois. La compréhension de leur nouvel environnement et de ses
dimensions cachées ne peut s’acquérir uniquement à travers une démarche
empirique ou une attitude de “bonne volonté”, quoique la motivation
personnelle ne soit pas indifférente à la réussite d’un projet: elle se
construit avec l’étudiant, avec ses connaissances de départ, son expérience
préalable de l’étranger, ses habitudes d’apprentissage et ses représentations.
Dans cette perspective, comment peut-on construire avec les étudiants des
savoirs et savoir-faire culturels, comment peut-on introduire cette
composante socioculturelle dans l’apprentissage linguistique des étudiants?
Pluridimensionnalité de la communication entre individus aux
appartenances multiples
Nous partons du postulat qu’il n’existe pas une culture mais bien des
cultures, des sociétés multidimensionnelles, constituant et constituées par la
pluri-appartenance de chaque individu (Abdallah-Pretceille et Porcher,
1996): il y a par exemple la culture du pays d’origine et de la société mais
également celle de l’individu que nous accueillons, qui possède une culture
sociale, une culture éducative, une culture universitaire, une culture
professionnelle, une culture sexuelle, dans certains cas, une culture
confessionnelle, une culture ethnique autre que la culture nationale, celle-ci
étant culture d’adoption, etc.
Ainsi notre usager de la langue, ayant dans ses bagages une certaine
expérience du monde et de l’autre à partir des valeurs et codes acquis dans
sa société, va être amené à évoluer dans une société étrangère où il
rencontrera et communiquera avec des individus eux-mêmes marqués,
construits par leurs appartenances et par leurs représentations de leur
société et de celle des autres qui sous-tendent et déterminent toute
communication en contexte endolingue ou exolingue.
Un certain nombre d’obstacles se présentent toutefois dans la construction
de ces compétences socioculturelles. La plupart d’entre nous (apprenants et
enseignants) véhiculons des images préétablies de la culture, de la société
et de l’autre, comme nous le faisons quotidiennement avec nos propres
concitoyens ne partageant pas les mêmes références sociales et pratiques
culturelles: croyances, idées reçues, clichés commodes, comportements
convenus et valeurs héritées qui s’apparentent davantage à des certitudes
sociales et culturelles sur la “réalité” qui nous entoure. De ce fait, la
conception de soi, régie par ces “évidences invisibles” (Carroll, 1987),

A. Gohard-Radenkovic, L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles"
enferme l’autre dans des représentations unilatérales, figées et
monolithiques, le plus souvent héritées des liens historiques et rapports de
force politiques ou économiques ayant forgé avec le temps des stéréotypes
confortables, des hiérarchies durables, voire immuables, malgré l’évolution
des situations respectives.
Des entretiens effectués, au sein de notre institution, en début de chaque
année universitaire (1998, 1999 et 2000), auprès d’un groupe de vingt à
trente “étudiants d’échange” sur leurs représentations de la Suisse,
témoignent de la persistance des stéréotypes, partagés, de manière quasi
homogène, par des étudiants provenant de différents pays d’Europe: ainsi,
les Suisses seraient "propres et disciplinés", mais "distants et
conservateurs"; "leurs châlets fleuris avec leurs coucous évoquent une
atmosphère paisible, un ilôt d’ordre et de calme", etc. (4). On pourrait
penser que le fait d’avoir un accès quotidien à une information démultipliée
par les médias et les ouvrages spécialisés, une exposition à d’autres
sociétés par les voyages et les échanges, auraient un impact sur leur
jugement. Mais il semble que ni la pluralité de l’information, ni la
proximité géographique – qui ne signifie pas, de toute évidence, proximité
“culturelle” – ni le contact quotidien avec les “réalités” européennes,
n’élargissent le “regard” porté sur l’autre.
Ces premiers témoignages – un peu navrants, il faut l’avouer – nous ont
incités à renouveler les entretiens à mi-parcours, ainsi qu’à la fin du séjour
d’étude de nos étudiants, afin d’analyser les effets de l'immersion sur la
construction des "compétences culturelles" et sur l’éventuelle
transformation de leurs représentations sur le pays d’accueil et ses habitants
(Kohler, 2000). La nécessité d’élaborer – pour et avec l’étudiant – , de
manière raisonnée et méthodique, des parcours de formation à
l’interculturalité, s’est imposée à nous.
Conception d’une formation transverse à l’interculturalité: la démarche
Étapes préalables: interroger “ses” représentations et “ses” valeurs
Aucun enseignant ou formateur n’est préparé par sa seule intuition à cette
analyse de la communication interculturelle, quelle que soit son origine,
quel que soit son parcours social et individuel, du fait que chacun vit d’une
manière plus ou moins dramatisée cette déstabilisation de l’individualité,
tant sur le plan physiologique que psychologique et intellectuel, quand il se
trouve lui-même confronté à “l’étranger”. D’ailleurs il n’est pas besoin de
se trouver immergé dans un pays lointain et exotique pour observer ces
réactions de repli ou de rejet vis-à-vis du “différent”. Le brouillage des
repères habituels s’applique d’autant plus aux étudiants, du fait qu'ils sont,

A. Gohard-Radenkovic, L'étudiant étranger et ses "compétences culturelles"
dès leur arrivée, happés par les contraintes administratives et universitaires,
ne disposant ni des moyens ni du temps pour “s’installer” dans le pays
d’accueil. Ce processus de déstabilisation peut entraîner des peurs et des
résistances qui se traduisent, entre autres, par une crispation linguistique et
sociale dans les premiers mois du séjour en immersion.
L'accompagnement de l’étudiant à la découverte de son nouvel
environnement est donc nécessaire, tout en gardant cependant une certaine
vigilance. Nous rejoignons Raymonde Carroll (1987) quand celle-ci nous
met en garde:
Nous sommes souvent intimidés à l’idée de tenter cette incursion dans
l’imaginaire culturel de l’autre, de nous lancer avec confiance dans l’analyse
culturelle, parce que nous sommes persuadés, au fond, que cela constitue un acte
d’arrogance de notre part. En effet, comment puis-je prétendre comprendre la
culture des Japonais ou des Allemands, si je ne peux vraiment comprendre mon
voisin, mes parents, mes enfants? L’analyse culturelle n’est pourtant pas un acte
d’arrogance, mais bien au contraire un acte d’humilité dans lequel j’essaie de
faire abstraction, pour un moment, de ma façon de voir le monde (la seule que
j’ai appris à trouver valable) et de la remplacer brièvement par une autre façon
de penser ce monde, façon que par définition je ne peux adopter (même si je le
voulais), mais dont j’affirme la validité par ce geste.
Toutefois, le véritable "acte d’humilité", à nos yeux, réside dans la mise en
question de nos propres stéréotypes et préjugés, ceux que nous véhiculons
sur une société et sa population, dans le questionnement de nos propres
valeurs, croyances et certitudes, que nous reproduisons en toute bonne foi,
avant de tenter “cette incursion dans l’imaginaire culturel de l’autre”.
Étape centrale: de la décentration vers la construction de nouveaux repères
socioculturels
Néanmoins, ce premier travail de décentration ne doit pas se cantonner à la
seule “introspection”. Les apports conceptuels de l’anthropologie sociale et
culturelle nous amènent à prendre la distance nécessaire à l’appréhension
de la complexité de l’autre société et culture, ainsi que de la sienne propre.
Car la finalité de cette approche est d’acquérir des repères socioculturels en
un premier temps et des stratégies d’ajustement en un deuxième temps, en
évitant de créer de nouvelles frontières mentales ou d’enfermer
commodément l’autre dans des schémas ethnologisants et sociologisants.
Dans cette optique, nous intégrons les principes fondamentaux de prise de
distance vis-à-vis de sa propre grille de “lecture du texte socioculturel”,
dans un canevas de formation constitué en six étapes (Gohard-Radenkovic,
1999):
1. débusquer les croyances individuelles et collectives;
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%