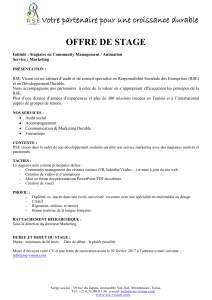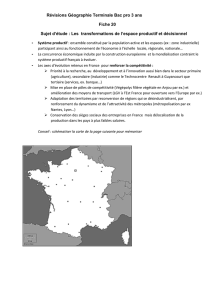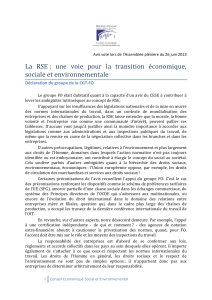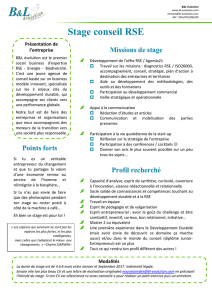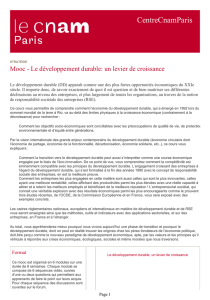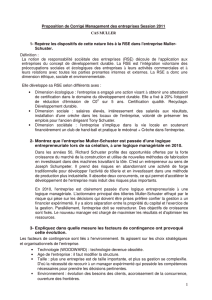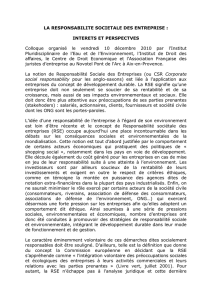made in monde,les nouvelles frontieres de l`economie mondial

1
Appel à articles
Les formes nouvelles de l’efficience productive : quels
consensus productifs pour quelles compétitivités ?
Numéro dirigé par Jean Ruffier et Frédéric-Jacques Richard
L’efficience productive a comme objectif de comparer les performances d’entreprises de
régions et de technologies différentes, et ce afin de comprendre les leviers de survie et
d’adaptation. Pour ce colloque, la notion d’
efficience productive
sera travaillée à l’aune de
l’économie monde et des formes de
consensus productifs
nécessaires à la recherche de
leviers de
compétitivité
, et ce dans tous les continents. On voit en effet, comment les
transformations du champ économique impactent les organisations, les supply chains,
les marchés et donc les leviers de compétitivité. Nous observons que la partie fabrication
prend une part beaucoup moins grande, aujourd’hui, dans les chaînes de valeurs. Nous
sommes en pleine redéfinition de la division internationale du travail. De nombreux sites
industriels ont fermé leurs portes pour se développer ailleurs et ce pour des raisons
économiques, mais aussi parce qu'ils constituaient des nuisances ou des risques pour les
populations ou l’environnement. Des matières premières vont venir à manquer, les
modes de production changent ou vont devoir changer, les crises économiques, sociales et
environnementales que le monde traverse donnent à penser les potentielles pistes de
sortie, d’adaptions ou d’opportunités de ces crises. Partant du principe qu’une approche
complexe est nécessaire pour diagnostiquer, analyser et proposer de nouveaux leviers
d’efficience productive, de compétitivité et de consensus productif, nous ferons se
rencontrer au cours de ce colloque sociologues, économistes et chercheurs en sciences de
gestion. Dans l’analyse des nouvelles formes d’efficience productive, il s’agira de penser
les consensus productifs et leur place dans la recherche de nouveaux positionnements
dans le monde économique actuel. Positionnements qui amèneront à penser les leviers de
compétitivité des pays et des entreprises.
Pour traiter de cette problématique large, trois thèmes ont été retenus
1. Quelle(s) forme(s) d’intégration dans le « made in monde en crise » ?
On peut considérer que le changement principal de ces trente dernières années s’est
exprimé par une séparation des différentes fonctions productives et une attribution de
ces fonctions dans diverses parties du monde. L’économie contemporaine reconnaît que
maintenant l’unité productive pertinente de l’analyse économique n’est plus la firme,
mais les acteurs relevant de pays et d’entreprises différentes. Et pour les économistes,
l’innovation technologique ou la montée en gamme apparaît toujours comme une solution
quasi automatique pour remonter les chaînes de valeur et accroître sa part de plus-value
(voir, par ex. BELL and ALBU,1999 ; ZENG, & WILLIAMSON, 2007). Les scientifiques
sont plutôt à la recherche de meilleures stratégies de « made in monde » pour les
entreprises, et ce, dans un monde où les économies des différents pays dépendent de la
manière dont ils s’insèrent dans des chaines de valeur plus ou moins globales. Beaucoup
de théories de gestion se focalisent sur les problèmes de logistique ou sur les modes

2
d’appropriation de la valeur selon la taille des entreprises concernées (Harvard Business
School, 2001). Dès 1986, M. PORTER décrit la chaîne de valeur comme l’ensemble des
activités permettant à une entreprise de créer des éléments clés de valeur pour ses
clients et, ainsi, de détenir un avantage compétitif. S. BERGER (2006) du Massachusetts
Institute of Technology a interrogé 500 industriels pour montrer que la fabrication d’un
produit de grande consommation pouvait prendre des formes plus ou moins regroupées,
et les stratégies gagnantes sont diverses. Les entreprises les plus développées ont tout
intérêt à jouer sur leur héritage en matière de savoir-faire, et de technologies, alors
que les économies en développement jouent davantage la carte de la flexibilité et de la
production à bas coût. Les grandes entreprises se spécialisent de plus en plus dans
l’intégration de la chaîne de valeur et développent une capacité dite stratégique
(JOHNSON, SCHOLES, WHITTINGTON, FRERY, 2005). Quant aux sociologues, dans
le milieu anglo-saxon, des auteurs ont déjà travaillé sur les chaînes de valeur globalisées
tout en se focalisant sur les acteurs et leurs relations (GEREFFI 1995, 1999 ;
HUMPHREY & SCHMITZ, 2002). Ils font apparaître les problèmes de gouvernance
qu’auraient les entreprises occidentales avec les usines des pays émergents. Chaque
mode de gouvernance correspond à une chaîne de valeur différente, c’est-à-dire que
chaque mode met en relation une suite d’intervenants spécifiques lesquels ont tissé entre
eux des liens plus ou moins formels, plus ou moins pérennes, et surtout établi des
relations de domination, de coopération et de contrôle. Voilà brutalement une division du
travail où les rapports sociaux de travail se jouent entre des acteurs multiples nouant
des relations de natures différentes les uns avec les autres, loin des ateliers taylorisés où
la division technique du travail met en relation des acteurs proches géographiquement
les uns des autres et dont les relations sont définies par des contrats très précis. Bien
que le travail reste le principal moyen de socialisation, l’éclatement des firmes va se
traduire par des socialisations nouvelles (RUFFIER, 2006, 2008).
Ainsi, la crise depuis 2008 bouleverse et remet en cause ces pensées dominantes sur la
chaîne mondiale de valeurs. Il est désormais important de poser les questions sur les
chaînes mondiales de valeurs après la crise : sont-elles en crise ? Qui sont maintenant les
véritables acteurs dans les chaînes mondiales de valeurs ? Comment évoluent les
rapports de domination (par le marché, par la possession du capital, ou par la possession
d’informations stratégiques) ? Qui tire davantage profit d’une chaîne de valeur ou d’une
autre ? Y a-t-il des changements structurels, des fragmentations de production ?
2. A la recherche de nouveaux consensus productifs
L’histoire du capitalisme a été celle de la recherche d’un
consensus productif
qui, au-delà
des divergences d’intérêts, des contradictions sociales ou de la lutte des classes, permet
et conduit à la production de biens ou de services. Le consensus productif
des « Trente
Glorieuses » constituait le fondement même du modèle fordien : d’un côté les syndicats
revendiquaient, de l’autre un patronat (ou un Etat) compensait tout désagrément par des
augmentations salariales, lesquelles accroissaient la demande au bénéfice de tous. Très
conflictuel, ce consensus productif
reposait sur des règles acceptées par tous (DURAND,
1993). Ces règles ont émergé et ont été mises en place dans la durée. L’essoufflement du
modèle productif des Trente Glorieuses, à partir du milieu des années 70 (BOYER et
DURAND, 1993) a conduit à des changements radicaux dans l‘économie mondiale
(déréglementation, financiarisation et globalisation) et dans l’organisation productive.
Les modes de gestion du travail ont modifié le consensus productif. Si aujourd’hui il
existe des formes de consensus productif, il semble que cela soit plutôt sous l’emprise de
la réponse à l’urgence plutôt que sous celui de l’analyse des contextes et de la
négociation.

3
Comment faire émerger des règles qui conduisent à pérenniser un consensus productif
face à l’accroissement des incertitudes de l’environnement économique ? Comment
empêcher que cette incertitude ne serve de prétexte au déséquilibre entre les exigences
de rentabilité et les fonctions nécessaires d’expression et de représentation des salariés ?
3. RSE et efficience productive, nouveaux leviers de compétitivité ?
A l’heure où l’on recherche des moteurs de croissance et de développement, les
thématiques liées à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) sont des pistes à
exploiter tant sur les marchés domestiques qu’internationaux.
La responsabilité sociétale est étroitement liée au concept de Développement Durable.
La norme ISO 26000 précise qu’il convient que « la contribution au développement
durable soit un objectif essentiel de toute organisation engagée dans une démarche de
responsabilité sociétale » (AFNOR, 2010, p.11). La RSE concerne les responsabilités de
l’organisation vis-à-vis de ses parties prenantes (internes et externes), de la société et de
l’environnement écologique. La RSE conduit donc à la notion de parties prenantes. En
effet, en faisant actes de responsabilités, les entreprises intègrent d’autres enjeux que
ceux qui lui sont généralement attribués. La norme précise : « Étant donné que le DD
couvre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux communs à tout un
chacun, il peut être utilisé pour traduire les attentes plus larges de la société qui doivent
être prises en considération par les organisations désireuses d’agir de manière
responsable ». Il est précisé (AFNOR, 2010, p.7) que la RSE nécessite pour les
organisations « d’être en mesure de répondre des impacts de [leurs] décisions et activités
sur la société et l’environnement ». Pour comprendre ces impacts, l’entreprise doit
prendre en compte les intérêts des parties prenantes. R.E. Freeman (1984, p.31) a défini
au Stanford Research Institute qu’une partie prenante est « un individu, ou un groupe
d’individus, qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs
organisationnels ». La notion de parties prenantes est centrale, en effet comment penser
la durabilité (ou soutenabilité) sans multiplier les échanges, ou les confrontations des
représentations ? Cette forme d’objectifs, à l’échelle des entreprises, nécessite de passer
par la mise en place d’un « dialogue permanent avec les parties prenantes » (CHABROL,
2003). La RSE – de l’ISO 26000 – fait de la notion de parties prenantes un moyen. Il
s’agit en effet de dépasser son propre cadre d’analyse et d’appréhension de l’action pour
s’ouvrir sur celui d’autrui avec lequel l’entreprise doit, ou est amené à, travailler
(RICHARD, 2006). C’est ce chemin, s’il devient un mode opératoire partagé, qui pourrait
permettre aux sociétés de tendre vers le Développement Durable. On voit bien alors
comment la RSE vient retravailler l’efficience productive.
La RSE concerne en premier lieu les grandes entreprises. Cependant, les PME voire les
TPE (FRIMOUSSE, MARCHESNAY, 2010) ne sont pas exclues d’une volonté à
participer à l’effort collectif de l’amélioration de la planète et de la société. Leur
comportement « socialement » responsable est davantage « vécu et informel »
(FRIMOUSSE, MARCHESNAY, 2010, p.243) qu’affirmé comme tel et les effets
immédiats de leurs actions concernent un territoire de proximité, local ou régional avant
de se répercuter sur l’espace monde (HORVATH & RICHARD, 2013).
La RSE pose les problématiques environnementales, sociales ou sociétales et les
contraintes qui leur sont liées comme autant d’opportunités qu’il faut apprendre à
exploiter. Ainsi, dans cet atelier, nous nous demanderons si les contraintes
environnementales, de coût de travail, d’efforts pour la santé et la sécurité contre la
souffrance au travail peuvent, tout au moins, être des leviers d’une recherche de
consensus productif, ou, au mieux, et à quelles conditions, se transformer en avantages
concurrentiels.

4
Bibliographie
AFNOR (2010),
NF
ISO 26000 – Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale
, Afnor.
BELL M. and ALBU M. (1999), “Knowledge systems and technological dynamism in industrial
clusters in developing countries”,
World Development
, Vol 27 No 9: 1715-1734
BERGER S., (2006),
Made in monde
, Seuil, Paris.
DURAND, J-P. (Dir., 1993),
Vers un nouveau modèle productif ?
, Paris, Syros.
FREEMAN R.E. (1984),
Strategic Management : A Stakeholder approach
, Boston
,
Pitman.
FRIMOUSSE S., MARCHESNAY M., (2010),
« RSE et TPE », Ethique et responsabilité sociale
,
Paris, EMS.
GEREFFI G. (1995), “Global Productions Systems and World Development”, in STALLINGS, B.
(Ed.)
Global Change, Regional Responses
, Cambridge University Press, pp. 100-142.
GEREFFI G. (1999), “International trade and industrial upgrading in the apparel commodity
chain”,
Journal of international Economics
, 48, pp. 37-70.
HARVARD BUSINESS SCHOOL (2001), Harvard Business Review on Managing the Value
Chain, by the President and Fellows of Harvard College, Boston: HBS Press.
HORVATH I., F.-J. RICHARD (2013), « Apport de l’apprentissage organisationnel à la
RSE : cas d’une entreprise de spectacle vivant », actes du 10ème congrès de l’ADERSE,
Brest.
HUMPHREY J., SCHMITZ H. (2002), “How does insertion in global value chains affect upgrading
in industrial clusters?”,
Regional Studies
, 36-9, 1017-1027.
JOHNSON G., SCHOLES K., WHITTINGTON R., FRERY F. (2008),
Stratégique
, 8e édition,
Pearson Education, Paris.
PORTER M. E. (1993, éd. Originale 1990),
L’avantage concurrentiel des nations
, InterEditions,
Paris.
PORTER M. E. (1999),
La concurrence selon PORTER
, Ed. Village mondial, Paris.
RICHARD F.-J., (2006),
Déconstruction de la notion de « développement durable » et de ses mises
en œuvre. Le « développement durable », un projet pour l’entreprise et les pouvoirs publics ?
,
Thèse en cotutelle pour l’obtention du Doctorat en Sciences de gestion, Université Jean Moulin
Lyon 3, UDELAR Montevideo, Uruguay.
RUFFIER J. (2006),
Faut-il avoir peur des usines chinoises ? Compétitivité et pérennité de
l’atelier du monde
, L’Harmattan, Paris.
RUFFIER J. (2008), “China Textile in Global Value Chain” in
Chinese Firms in the Era of
Globalisation
, Chief Editors: Jean-Francois HUCHET, WANG Wei, Published by China
Development Press, Beijing.
ZENG M., WILLIAMSON P.J. (2007),
Dragons at your door. How Chinese cost innovation is
disrupting global competition
, Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
Les propositions d’articles doivent être soumises avant le 7 février 2014 au
comité éditorial de la revue
Interventions économiques
à l’intention de Diane-
Gabrielle Tremblay
Avec copie conforme à Frédéric Jacques Richard :
Décision le 14 février 2014 ; remise des textes : 31 mars 2014.
1
/
4
100%