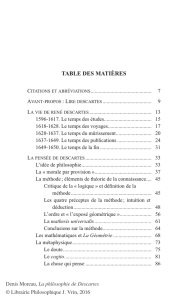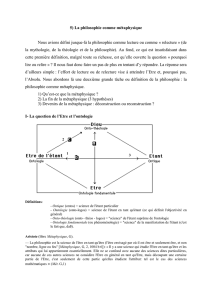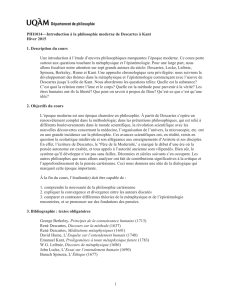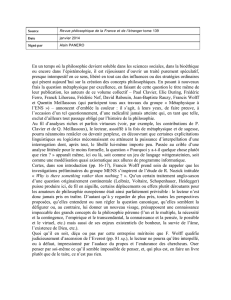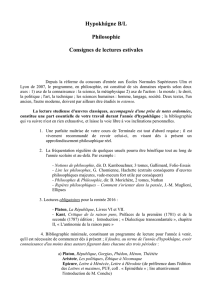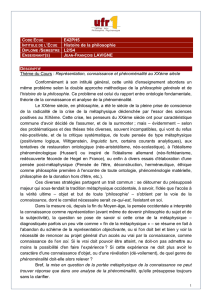Mgr Claude DAGENS M. Jean-Luc MARION

RÉPONSE
DE
Mgr Claude DAGENS
AU DISCOURS
DE
M. Jean-Luc MARION
____
Monsieur,
Ce qui nous advient nous dépasse. Cela vaut certainement pour une
élection et une réception à l’Académie française. Nous en sommes l’un et l’autre
intimement convaincus.
Ne s’agirait-il pas, dans une certaine mesure, de ce que vous qualifiez
vous-même de phénomène saturé ? Ne vivons-nous pas, en ce moment même, un
tel phénomène, c’est-à-dire un événement qui vient d’ailleurs, qui nous saisit du
dedans et qui nous transforme, en nous appelant à entrer dans cela même qui
nous est donné, dans cette Compagnie dont vous devenez l’un des membres en y
succédant au cardinal Jean-Marie Lustiger ?
Avant d’évoquer le phénomène que constitue votre pensée philosophique,
Monsieur, permettez-moi de méditer quelques instants sur le phénomène qui
nous réunit sous cette Coupole, en ce 21 janvier 2010.
Il y a près de trente-cinq ans, en 1975, nous nous sommes rencontrés pour
la première fois. J’étais un jeune prêtre ami des Pères de l’Église, et tout
particulièrement du pape saint Grégoire le Grand. Vous étiez un jeune assistant à
la Sorbonne, où vous enseigniez la pensée de Descartes, aux côtés du professeur
Ferdinand Alquié. Et surtout vous veniez d’être appelé à assumer la fondation
d’une nouvelle revue théologique appelée Communio. Telle était la raison de

notre première rencontre : vous vouliez m’associer à cette fondation, que le
cardinal Jean Daniélou avait passionnément souhaitée et préparée. J’ai accepté
sans hésiter de répondre à votre demande, car je comprenais l’enjeu de cette
initiative hardie : il s’agissait de manifester intelligemment et raisonnablement la
nouveauté de la Tradition chrétienne en un moment où, dans la société comme
dans l’Église catholique, prévalaient les ruptures de traditions.
Cet engagement nous valut, quelques mois plus tard, en septembre, de
nous retrouver à Munich, avec vos camarades Jean Duchesne et Rémi Brague,
pour une rencontre internationale à laquelle participait un théologien allemand
nommé Joseph Ratzinger, qui donna à cette occasion une conférence remarquée
sur la constitution que le concile Vatican II avait consacrée à l’Église dans le
monde de ce temps, Gaudium et spes. Il était déjà évident que les textes et les
intentions d’un concile exigent un travail approfondi et durable de
compréhension et de réception. La revue Communio se préparait à y contribuer
en faisant appel à de jeunes normaliens, qui savaient, par expérience personnelle,
que « la foi n’est pas un cri » et que la rationalité chrétienne ne doit pas hésiter à
s’exposer sur la place publique.
À ce moment-là, Monsieur, nous ne pouvions pas nous imaginer que nous
nous retrouverions un jour sous cette Coupole, mais nous comprenions cependant
que nous étions embarqués dans une aventure qui nous dépassait. Pourquoi le
cacher ? C’est à cause de ces premières rencontres que j’ai accepté d’être
aujourd’hui celui qui vous accueille en notre Compagnie, car si je n’avais été
confronté qu’à votre pensée, si incisive, et à vos écrits, parfois si rudes à
déchiffrer, j’aurais dû renoncer à cette mission qui déborde de beaucoup mes
capacités philosophiques.
Je dois sans doute être encore plus précis ou plus sincère : c’est ce terme
même de mission qui justifie mes paroles d’aujourd’hui, comme il soutient en
permanence le travail de votre pensée. Oui, en ce lieu devenu profane, je n’hésite
pas à reconnaître que nous ne serions pas nous-mêmes, ni vous, ni moi, si nous
n’acceptions pas de faire l’expérience de ces phénomènes saturés où s’atteste ce
qui vient de plus haut ou de plus profond que nous, et qui nous donne de penser,
d’écrire, de parler, non pas seulement parce que c’est notre métier, mais parce
que c’est avant tout notre raison d’être.
Et si certains, Monsieur, en apprenant votre élection, ont pu se demander :
« Comment est-il possible qu’un professeur d’Université succède à un
archevêque de Paris ? » et si d’autres, aussi ignorants des usages de notre
Compagnie, mais plus familiers de la théologie catholique, ont osé penser et
2

- 3 -
dire : « Quoi ! Ce fauteuil précédemment occupé par deux cardinaux va-t-il
revenir à un laïc, ou, pour mieux dire, à un simple baptisé ? », je les invite à lire
avec attention l’article que vous avez donné en 1979 à la revue Communio sous
le titre « De l’éminente dignité des pauvres baptisés ». Cet article était comme
son titre : volontairement provocant. Vous y dénonciez avec vigueur ce que vous
considériez comme la dérive idéologique de l’Action catholique, à laquelle vous
reprochiez de méconnaître les exigences essentielles de la conversion chrétienne.
C’est un plaidoyer passionné que vous vouliez faire entendre, pour que soit
reconnue aux baptisés, à cause du signe dont ils sont porteurs, l’identité
essentielle qui est la leur et dans l’Église et dans la société. Et vous acheviez ce
plaidoyer en montrant qu’entre la dignité des baptisés et l’autorité de l’évêque, il
n’y a aucun antagonisme, puisqu’il s’agit pour l’essentiel de la même relation au
même mystère de Dieu, qui est notre raison commune d’exercer nos missions
différentes et solidaires.
En tout cas – et je ne sais s’il s’agit d’un hasard ou d’un phénomène
providentiel – l’Académie française, en vous choisissant pour succéder à un
archevêque de Paris, vous donne de vérifier personnellement cette éminente
dignité des pauvres baptisés, inséparable de celle des pauvres évêques, et qui
dépasse infiniment nos personnes et nos histoires particulières. C’est ce
dépassement infini qui vous a rendu si proche de Jean-Marie Lustiger, comme il
l’était sans doute de vous, avec ce sentiment ou même cette certitude d’être
appelé à vivre en soi-même, en deçà des apparences et au travers des épreuves,
une distance formidable, au sens propre, un écart immense, impressionnant entre
ce que l’on est, ce que l’on mesure de soi-même et ce que l’on a la charge
d’attester.
Et c’est pourquoi je n’ai pas maintenant à faire votre éloge, j’ai à dire
comment vous avez appris à vivre cette distance et cet écart, et de quelle façon
l’acharnement, l’intensité, la persévérance de votre pensée se déploient à
l’intérieur même de cet écart.
Comme pour chacun de nous, quand il s’agit d’une vocation, la première
ou les premières impulsions viennent de loin. Pour vous, c’est durant les années
de khâgne, au lycée Condorcet, en 1965, que vous avez perçu l’appel non
seulement à devenir professeur de philosophie, mais surtout à faire du travail
philosophique l’essentiel de votre existence. Cet appel est passé par cet homme
nommé Jean Beaufret, dont on savait qu’il était un ami personnel, et même un
confident, de ce maître célèbre qu’était Martin Heidegger. Ses cours ne pouvaient

pas ne pas faire allusion à ces temps nouveaux qui s’ouvraient, dès lors que la fin
de la métaphysique n’était pas identifiée avec la fin de la philosophie.
Vous voilà peu à peu embarqué grâce à Jean Beaufret dans l’exploration
de ces temps nouveaux, sans négliger l’autre appel qui est passé au même
moment par votre professeur de Lettres, Daniel Gallois. Lui a entrepris de vous
ouvrir aux révélations des poètes et, en même temps, il vous a obligé à écrire
vraiment en français.
Écrire en français, quel programme ! Mais écrire en philosophe qui ne
cesse pas de penser ce qu’il écrit et qui, peut-être même, laisse ses livres
s’inscrire d’abord en lui ! Il m’arrive, Monsieur, de partager les tourments de vos
lecteurs non initiés à la phénoménologie lorsqu’ils essaient de vous comprendre.
Mais moi, parce que je vous connais et que je m’en suis expliqué avec vous, j’ai
compris au moins ceci : c’est le travail intérieur de l’intelligence qui façonne
votre écriture, et c’est une écriture exigeante, ardente, à travers laquelle on sent
bien que vous obéissez vous-même non pas à vos goûts, ni même à vos idées,
mais à ce qui vous est donné, surtout quand vous êtes conduit à penser Dieu
selon cette étonnante logique du don qui dépasse tellement le mouvement
spontané de l’esprit : « Dieu ne peut se donner à penser sans idolâtrie qu’à partir
de lui seul : se donner à penser comme amour, donc comme don, se donner à
penser comme une pensée du don. Au mieux, comme un don pour la pensée,
comme un don qui se donne à penser. Mais un don, qui se donne à jamais, ne
peut se penser que par une pensée qui se donne au don à penser. Une pensée qui
se donne peut seule s’ordonner à un don pour la pensée. Mais, pour la pensée, se
donner, qu’est-ce, sinon aimer ? » (Dieu sans l’être, Paris, 1982, p. 75).
Si l’on n’entendait pas cette question finale, on pourrait avoir l’impression
que vous jouez avec les mots, en les faisant cliqueter à plaisir. En vous lisant et
en vous relisant, j’ai plutôt l’impression que vous luttez intérieurement et que
votre écriture exprime et expose ce combat intime.
En tout cas, dès vos années de formation, vous avez compris que la
philosophie ne serait pas pour vous seulement un métier, mais une passion, peut-
être dangereuse, oui dangereuse, parce qu’elle ne vous laisserait jamais en repos
et vous obligerait sans cesse à aller de l’avant. La pratique du sport vous a appris
cette exigence non pas de détente, mais de dépassement, qui passe par une lutte
avec soi-même et aussi contre soi-même, à ses risques et périls. Votre style
révèle cette espèce de tension tenace sans laquelle la pensée ne pourrait pas se
déployer vraiment. L’inquiétude est bien cette tension qu’évoque saint Augustin
au début de ses Confessions et elle vaut pour le travail de l’esprit autant que pour
4

- 5 -
les mouvements du cœur. Vous le savez, Monsieur, intensément, et votre écriture
le dit : vous ne jouez pas, vous vous élancez et vous cherchez à entraîner les
autres.
Mais revenons à votre initiation philosophique. Après la khâgne de
Condorcet, votre apprentissage va se poursuivre à l’École normale supérieure,
avec d’autres maîtres qui eux aussi payaient de leur personne, chacun à sa
manière : Louis Althusser, Jacques Derrida, Gilles Deleuze. Là, vous avez
continué à comprendre, surtout durant l’année 1968 et au-delà, que vraiment, la
philosophie ne pouvait pas se contenter d’être une discipline universitaire, mais
que, tout en l’étant, elle participait à une sorte de crise culturelle et spirituelle, et
qu’il fallait donc se préparer, par tous les moyens, à affronter cette crise.
Cette crise, vous la diagnostiquez, avec d’autres et précisément avec
Heidegger, comme une crise de la rationalité, et spécialement de la rationalité
étroite réduite à sa fonction calculatrice et quantifiante, surtout quand cette
rationalité se laisse instrumentaliser par les pouvoirs de la technique et de la
politique.
Bien entendu, ce que l’on appelle la fin de la métaphysique s’inscrit à
l’intérieur de cette crise, mais cette fin ne vous semble être que le crépuscule des
idoles conceptuelles. Elle oblige à penser Dieu au-delà de ce que l’on appelle sa
mort, et qui n’est sans doute que l’effacement des concepts dans lesquels on
l’avait enfermé idolâtriquement. Voilà donc la pensée philosophique sommée de
relever un défi essentiel : c’est la rationalité elle-même qui est en état de
demande, surtout si elle dépasse les étroitesses qu’elle s’est imposées à elle-
même.
Quant à la question de Dieu, dans ce contexte de crise, on ne peut et on ne
doit surtout pas y renoncer. Mais pour vous, ce n’est pas exactement de la
question de Dieu qu’il s’agit : c’est plutôt de la figure de Dieu, de la
manifestation de cette figure et de l’accès humain à cette manifestation.
Si votre pensée s’est ouverte à ces perspectives-là, c’est en raison d’un
autre événement décisif pour votre formation, qui, lui, s’est produit non pas dans
une enceinte universitaire, mais à la basilique de Montmartre. C’est là que vous
avez été confronté et initié au mystère de Dieu selon la grande Tradition
chrétienne, celle des Pères de l’Église, que vont vous faire découvrir des
théologiens passionnés, les jésuites Henri de Lubac et Jean Daniélou, l’oratorien
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%