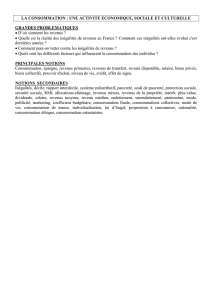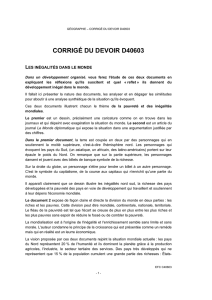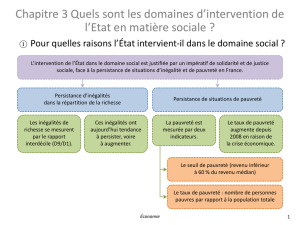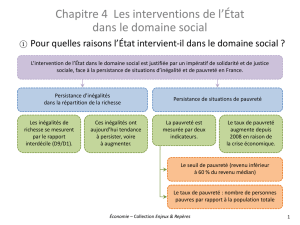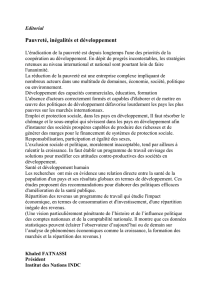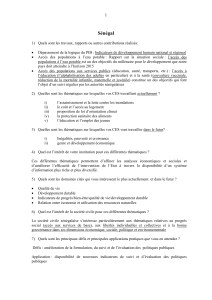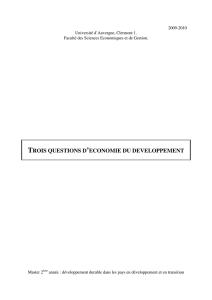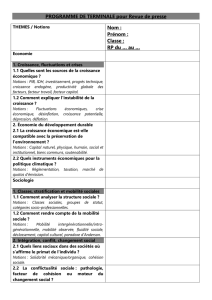Développement - France Diplomatie

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
ET DU DÉVELOPPEMENT
Direction de la stratégie, de la programmation et de l’évaluation
Développement : 12 thèmes en débat
Étude réalisée par
Audrey AKNIN
Université Versailles Saint-Quentin
Jean-Jacques GABAS
Université Paris XI-Orsay
Vincent GERONIMI
Université Versailles-Saint-Quentin.
avec la collaboration de
Michèle LECLERC-OLIVE
CNRS/CEMS
Pierre JACQUEMOT
MAE/DGCID
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Cette étude est un document interne établi à la demande du
ministère des Affaires étrangères.
Les commentaires et analyses développées n’engagent que leurs auteurs
et ne constituent pas une position officielle.
Tous droits d’adaptation, de traduction et de reproduction par tous procédés,
y compris la photocopie et le microfilm, réservés pour tous les pays.
Photo de couverture : Médiamultiplus
© Ministère des Affaires étrangères, 2000.
ISSN : 1160-3372
ISBN : 2-11-091316-9

Développement : 312 thèmes en débat
Sommaire
Avant-propos 5
1 - Développement et mondialisation : une vue d’ensemble 7
I. Prendre en considération le processus de mondialisation 7
II. Les débats au sein de quelques organisations internationales 9
1. En quels termes la Banque mondiale pose-t-elle la question du développement ? 9
2. L’approche de la Commission européenne 12
3. L’approche du PNUD : le développement humain 12
III. Contributions d’équipes françaises à huit questions essentielles 14
1. Réhabiliter la notion de politique publique 14
2. Passer de la notion de société civile à celle de l’espace public 15
3. Les décentralisations : un concept polysémique 15
4. Donner à la coopération une dimension éthique 16
5. Repenser la régionalisation des économies 16
6. Repenser les mécanismes de stabilisation 16
7. Aborder la question des institutions 17
8. Passer de l’aide aux biens publics internationaux 18
2 - Ouverture et développement 19
I. Origine et cadre général des débats 19
II. Les principaux débats dans les instances multilatérales 21
III. Les débats dans les centres de recherche français 26
3 - Biens publics internationaux 27
I. Le bien public : définition du concept 27
II. Les biens publics internationaux : production et rôle de l’état 28
III. Les débats dans les centres de recherche français 32
4 - Environnement et développement 33
I. Théorie et principes 33
II. Instruments des politiques d’environnement 35
III. L’environnement : une question globale 37
IV. La question environementale dans les politiques de développement 38
V. Environnement et développement : la question scientifique française 39
5 - Population et développement : santé, éducation, genre 40
I. Le capital humain : un concept fondateur 40
II. Les grandes instances multilatérales à l’interface santé, éducation et genre 41
III. Développement et population : la question scientifique française 46
6 - Inégalités et développement : de Kuznets à Sen 47
I. Inégalités, revenu et croissance : un cadrage théorique 47
II. De la pauvreté aux inégalités : une priorité retrouvée au sein des instances multilatérales 48
III. Inégalités et développement : l’approche française 50
7 - Aide et efficacité 52
I. L’aide comme moyen de contribuer au processus de développement 52
II. Les débats au sein des instances multilatérales 52
III. Les débats dans des centres de recherche en France 58
8 - Financement du développement et dette 59
I. Quatre traits caractérisent cette évolution 59
II. Les débats au sein des organisations multilatérales 59
III. Les débats dans des centres de recherche en France 62
9 - Analyse du post-ajustement 63
I. Origine et cadre général des débats 63
II. Les principaux débats dans les instances multilatérales 64
III. Les débats dans des centres de recherche en France 66

10 - Culture et développement 67
I. La culture et ses ambiguïtés 67
II. Culture et développement : entre capital social et participation,
la démarche des grandes instances mutilatérales 69
III. Culture et développement : l’analyse française 72
11 - Institutions et gouvernance 73
I. Origines et cadre général des débats 73
II. Les débats au sein des institutions multilatérales 74
III. Les débats dans des centres de recherche français 76
12 - Décentralisation et acteurs locaux 78
I. Décentralisation et société civile : de quoi parle-t-on ? 78
II. Les théories politiques centrées sur la société civile 79
Références bibliographiques 83
Liste des acronymes utilisés 93
Développement : 412 thèmes en débat

Développement : 512 thèmes en débat
Avant-propos
La place occupée dans la politique étrangère par les problèmes relatifs au développement est
importante non seulement en raison du rôle historiquement joué par la France auprès des pays
du Sud, mais aussi parce que ces problèmes interfèrent dans tous les grands sujets
internationaux : paix, sécurité, environnement, immigration, emploi, croissance
économique… « Notre diplomatie doit y accorder une part essentielle car l’inégalité dans le
développement est la cause première des tensions » (Charles Josselin, le 25 avril 2000 à
l’Assemblée nationale).
L’intérêt accordé aux questions de développement s’est particulièrement manifesté à Paris
pendant la semaine du 26 au 30 juin 2000 durant laquelle se sont tenues trois manifestations
importantes sur le développement (avec la Banque mondiale, le PNUD et l’Union
européenne). Le Sommet du G8 à Okinawa (juillet 2000), le Sommet du millénaire à New
York (septembre 2000) et la présidence française de l’Union européenne (second semestre
2000) seront d’autres occasions de présenter nos thèses, de mettre en valeur nos acquis et de
contribuer à la recherche de solutions aux drames du développement inégal.
La DGCID a souhaité présenter les principaux débats sur les stratégies de développement qui
se tiennent tant dans les instances internationales qu’au sein des milieux scientifiques. Elle a
donc demandé à une équipe d’universitaires de présenter un état des lieux de la pensée sur le
développement, de tracer les cheminement intellectuels, d’éclaircir les concepts utilisés et de
présenter les thèses concurrentes mises en avant.
Les auteurs appartiennent au groupement d’intérêt scientifique GEMDEV (Groupement
Économie mondiale, Tiers Monde et Développement) qui a été constitué autour de 50
laboratoires et formations doctorales de la région de l’Ile-de-France et qui réalise des cycles de
conférences sur des thèmes transversaux de développement dans une perspective
pluridisciplinaire.
Ce travail a une vertu pédagogique. Il n’est pas simple pour autant. Le développement est en
effet un carrefour très fréquenté, une discipline qui associe diverses spécialités, et qui combine
subtilement théories, faits, mythes et pouvoirs. L’impression de confusion que certains
ressentent parfois est accentuée par la difficulté à démêler ce qui relève de la doctrine et ce qui
est du domaine de l’action. L’idéologie alterne avec le discours sur la pratique.
La présentation des travaux universitaires proposée dans ce document est encore partielle. Un
travail exhaustif exigerait un travail plus long et plus systématique, en direction notamment
des équipes de recherche françaises (universités, grands établissements publics de recherche...).
De surcroît, le champ couvert par les théories du développement étant très vaste, tous ses
aspects n’ont pas été traités. 12 thèmes ont été privilégiés, mais d’autres auraient pu l’être.
Le but de ce document est notamment de mettre en avant la pensée internationale et française,
dans sa diversité et dans son actualité. Il permet aujourd’hui d’identifier ce qu’il serait possible
d’appeler « une identité française en matière de développement », à partager avec les partenaire
du Sud comme avec les Européens. Cette identité s’enracine autour de quelques idées-forces.
La première est que le développement durable (pérenne, soutenable et viable) de l’économie
nécessite des règles du jeu. Elles concernent l’environnement, dimension vitale et richesse
potentielle. Les exigences d’une gestion assurant la protection et la transmission du patrimoine
naturel et de la « résilience » (capacité de reconstitution) aux générations futures imposent des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
1
/
96
100%