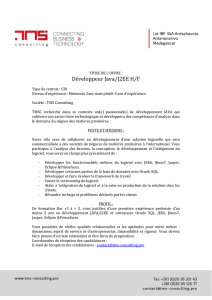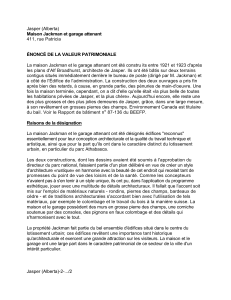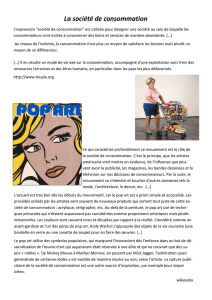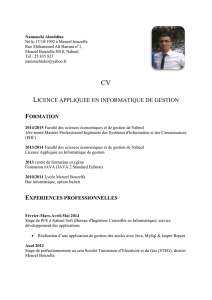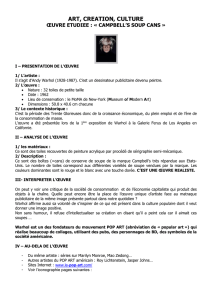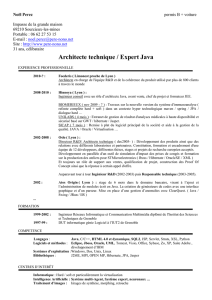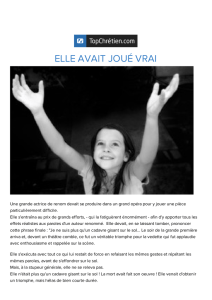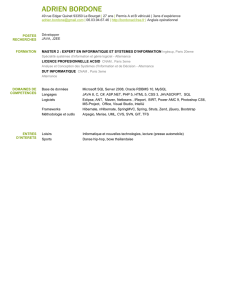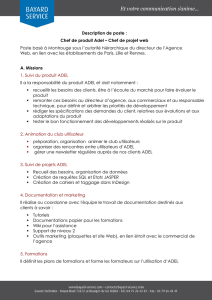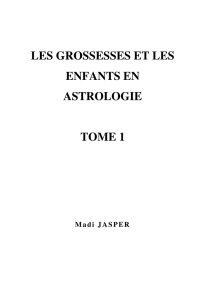Gésir (v. intr.), terme qu`on emploie surtout en parlant de personnes

...
...
bouche à oreille
152 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
20 janvier 2010 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
2 novembre 2010 00
Gésir (v. intr.), terme qu’on emploie
surtout en parlant de personnes malades
ou mortes
Le titre de l’ouvrage de Jacques
Perrin n’est pas sans évoquer ce-
lui d’une chanson de geste ; son
contenu ne le dément pas et ne modifie
pas vraiment cette impression. Si, il est
vrai, il n’est pas écrit en vers, il s’agit tout
de même d’une forme d’épopée avec
son héros, Jasper, alpiniste brisé par une
chute, gisant dans un lit d’hôpital, immo-
bile, horizontal dans un milieu où toutes
les personnes qui s’occupent de lui sont
orientées différemment, verticalement, et
le restent, ajoutant en outre une distance
à l’orientation dans l’espace : «Tous les
visiteurs (médicaux), jusqu’à présent,
n’ont jamais franchi une limite aléatoire,
une sorte de distance symbolique, un pié-
destal imaginaire peut-être, et sont res-
tés face à lui, au pied du lit.» (p. 111). D’où
une perspective particulière sur la vie à
l’hôpital.
Mais n’est-ce pas celle que partagent
tous les patients alités ? Comme toujours,
les différents moments de la condition
humaine sont à la fois communs et par-
ticuliers. Etre hospitalisé, passer quelque
temps alité dans une institution hospita-
lière est assez commun ; ce qui ne l’est
pas, c’est d’être littéralement cloué dans
un lit par de multiples fractures aux jam-
bes et au bassin, sans pouvoir bouger
pendant de longues semaines et donc
sans avoir beaucoup d’autre loisir que
de penser à ce qui s’est passé et à ce
qui va se passer. Ce qui ne l’est pas non
plus, c’est de devoir sa situation à une
chute en montagne, lors de l’ascension
d’une voie qui, de manière symptoma-
tique, s’appelle One Step Beyond.
Jasper gît dans son lit, comme un gi-
sant sur un tombeau, dans la même im-
mobilité. L’expression est d’autant plus
appropriée qu’il n’aurait pas dû survivre
à sa chute. Ainsi que le dit le dictionnaire
de l’Académie, on emploie surtout le ver-
be gésir en parlant de personnes mala-
des ou mortes. Mais on l’emploie aussi
pour des parties d’édifices renversées par
le temps ou la destruction, signification
qui est illustrée par l’exemple suivant :
«Les colonnes de l’édifice détruit gisaient
éparses». Jasper est aussi un édifice dont
les colonnes seraient éparses si elles
n’étaient pas liées entre elles par des
plaques et des clous, insérés dans son
corps au fur et à mesure des interven-
tions chirurgicales successives qu’il doit
subir. La chute n’a pas seulement épar-
pillé les parties de son corps, celles de
son âme aussi ont subi l’émiettement ;
pour en restaurer l’unité, la chirurgie est
cette fois impuissante ; par contre, l’im-
mobilité forcée du gisant est sans doute
une meilleure thérapie : permet-elle de se
reconstruire soi-même, de réinvestir son
passé et de le dire ? C’est ce qu’explore
ce livre.
Il s’agit d’un roman et non d’un té-
moignage ; mais c’est un roman qui doit
beaucoup à la réalité : l’auteur a été la
victime d’un accident analogue, et il a
souffert des cassures dont souffre Jasper
(les lettres qui constituent ce prénom se
retrouvent toutes dans le nom de l’au-
teur). Ceux qui le connaissent ou qui con-
naissent le milieu hospitalier s’amuse-
ront sans doute à deviner ça et là la pro-
saïque réalité qui affleure souvent sous
le récit. Juste un exemple. Jacques Per-
rin est connu comme gourmet et œnolo-
gue ; on attend donc avec un certain sou-
rire sa confrontation avec la nourriture
quotidienne servie à l’hôpital. Le jugement
porté ne surprend pas. Ce qui est plus
original, c’est la manière dont Jasper ten-
te de faire contre mauvaise fortune bon
cœur : imaginer que d’autres saveurs ha-
bitent sa plate pitance en les recompo-
sant à partir des menus qu’il a goûtés
avant sa chute. A la longue, c’est une ga-
geure ! Mais ce ne sont là qu’anecdotes.
L’essentiel est ailleurs, dans la perspec-
tive du gisant, et sur ce plan, le fait que
l’auteur ait enseigné la philosophie et la
littérature lui fournit des ressources moins
courantes. Avoir fréquenté les poètes, les
écrivains et les philosophes donne un
certain éclairage à ce qui est vécu : il ne
faut à Jasper – ou à Jacques Perrin –
pas moins qu’un «cortège de stoïciens»
(p. 73) pour tenter d’apprivoiser la douleur
ou, au moins, pour se familiariser avec les
échelles de la douleur. Cela colore aussi
la manière de dire les choses : «Infini de
la chute. Quand on tombe, on ne cesse
jamais de tomber. Cela n’a ni commen-
cement ni fin» (p. 25). Jasper finit toute-
fois aux urgences : «Le tableau clinique
est tout entier contenu dans ce constat
en forme de sentence "polytraumatis mes
sévères". Diagnostic comminatoire.» (p.
31) A partir de là commence la recon-
quête, lente et chaotique, semée d’es-
poirs et de désespoirs, d’envolées et de
rechutes.
L’hôpital est pour Jasper «le paque-
bot», un univers assez étrange, selon lui.
C’est un milieu clos où tout le monde
vo gue de concert, mais chacun avec une
tâche précise à remplir, structurant la jour-
née, y compris celle du patient : «La mê me
B. Baertschi
Bernard Baertschi
Institut d’éthique biomédicale
Programme des sciences humaines
en médecine
CMU, 1211 Genève 4
Rev Med Suisse 2010 ; 6 : 152-3
Coordination rédactionnelle :
Micheline Louis-Courvoisier
Livre commenté :
Jacques Perrin. Dits du Gisant. Vevey : Editions de
l’Aire, 2009.
34618_152_153.indd1 14.01.1007:33

...
...
...
...
Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
20 janvier 2010 153
loi impitoyable préside au dé coupage et
à l’organisation du temps. Tout est mis
en œuvre pour ne pas vous laisser une
frange d’autonomie, pour que vous n’ayez
pas à "employer votre temps".» (p. 182)
La bienfaisance médicale pour pallier la
peur de se retrouver seul avec soi-mê-
me ? Le week-end, tout change cepen-
dant, le désert s’installe, et seuls demeu-
rent les patients «qui ont cessé de se
penser à l’extérieur des murs» (p. 162),
comme, justement, «les cloués au lit».
Mais la semaine, le personnel soignant
défile, et notamment de nombreux mé-
decins : un tel est intarissable et, sachant
qui est Jasper, évoque avec lui – ou plu-
tôt devant lui – une dégustation de vins
rares et chers ; tel autre pontifie devant
ses étudiants. L’un évite de croiser le re-
gard du patient et tient à l’intention de
ses assistants les propos qu’il devrait lui
adresser, un autre sait se faire rassurant,
malgré la gravité du diagnostic. Un jeu
de ping-pong s’instaure peu à peu entre
médecins et malade, où chacun essaye
de percer un peu de l’autre, souvent en
vain, comme il en va avec le professeur
Sacrada, «quelqu’un que Jasper va cô-
toyer durant de nombreux mois, dont il
tentera, en vain, de faire tomber le mas-
que impénétrable qui semble être deve-
nu son vrai visage.» (p. 102) Peu en dé-
finitive «donnent à voir un fragment de
[leur] monde» (p. 111), car chacun se pro-
tège. Même les visites remplissent une
tâche sur ce paquebot, parfois dans la
gêne suscitée par le gisant, parfois mê-
me en se réfugiant dans le paradoxe : «A
peine arrivés, ils dressent l’inventaire de
leurs malheurs et de leurs anicroches […]
qu’ils commentent avec une minutie et
une gravité telles que je me sens obligé
de leur témoigner une attention soute-
nue.» (p. 181) Etre un gisant renvoie à soi-
même, cela vaut aussi pour ceux qui le
rencontrent.
La guérison est un long chemin, d’au-
tant plus délicat qu’il est pavé par le
rythme hospitalier et l’habituation à la ma-
ladie : «Malgré moi, ma vie s’est faite ici :
comment rejoindrais-je ma vie d’avant ?»
(p. 186). D’où l’angoisse de la rupture
qui accompagne le mieux aller, et qui se
double de l’angoisse de la rechute. Lors-
que Jasper redescend pour la première
fois un escalier, on lit : «Peur de tomber,
de cet abîme qui s’ouvre, de cette ab-
surdité de mourir une nouvelle fois, an-
goisse de me trouver brisé, laminé et de
tout recommencer à zéro. […] Je me re-
couche fissa, fébrile, claquant des dents»
(p. 210), et de penser au désespoir de
Rimbaud tentant de marcher avec des
béquilles à la suite de son amputation.
Marcher, cette activité si simple de la vie
de tous les jours, est devenu probléma-
tique : «J’ai appris un jour à marcher, il y
a longtemps ; il me faudra à nouveau en-
trer dans cette ascèse.» (p. 187) Etrange
renaissance, où tout ce qui était facile est
devenu difficile. Y parvenir, c’est pourtant
une question de dignité : «Se tenir debout
droit, le regard à hauteur d’homme, vivre
et penser debout» (p. 170), comme seuls
les médecins et le personnel soignant
peuvent le faire impunément à l’hô pital.
Puisque Jasper finit par revenir chez
lui après un long passage dans une mai-
son de convalescence et qu’il est à nou-
veau capable de marcher, c’est qu’il a
ressuscité physiquement. Le gisant a-t-il
toutefois aussi réussi à se reconstruire
intérieurement ? Mais que signifie «se re-
construire intérieurement» ? Ramené à
ses propres frontières physiques pen-
dant si longtemps, il semble s’être rendu
compte que ce projet de réunification
était en partie vain ou illusoire, vu qu’un
des derniers dits du livre est qu’il n’y a
pas «d’autre monde que la réunion im-
probable de tous les mondes que cha-
cun porte à l’intérieur de soi, imagine, réa-
lise parfois, croisant la trajectoire d’une
autre personne, attiré par son orbite, mû
par son énergie» (p. 238). Ses mondes à
lui, comme ceux de ses amis disparus –
tel vigneron, tel alpiniste – dont la posi-
tion de gisant a ravivé le souvenir, ou de
ceux avec qui il continuera de vivre. C’est
sans doute la leçon à la fois tragique et
ironique de ce livre que l’être humain doit
être sur le point de perdre sa vie pour
qu’il puisse en trouver le sens, et que la
maladie ou l’accident en soit l’occasion.
Jasper n’est certes pas le premier à en
faire l’expérience, mais chaque fois, elle
reste unique. La médecine, en permettant
à Jasper de surmonter cette épreuve,
ne mérite-t-elle alors pas aussi le titre
d’éveilleuse d’âme, même si c’est à son
insu et à son corps défendant ?
0000 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
2 novembre 2010
34618_152_153.indd2 14.01.1007:33
1
/
2
100%