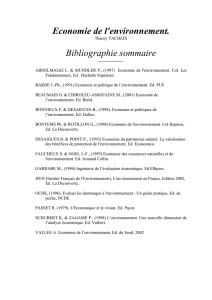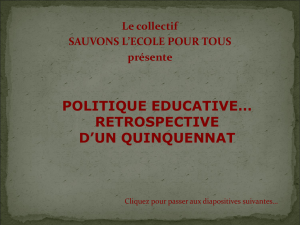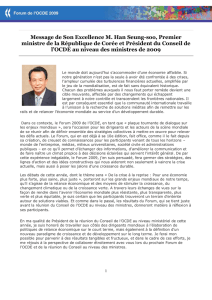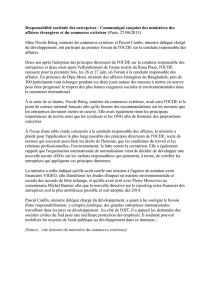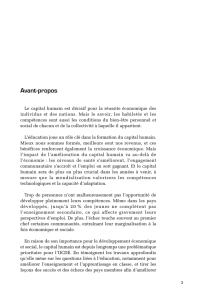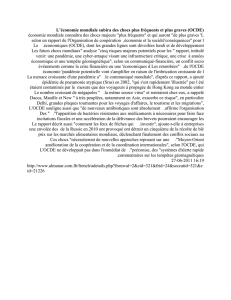Institutions sociales : quel rôle économique ? - Conférence des 6

1
INTEGRAS
Institutions sociales :
quel rôle économique ?
Colloque de Morat / 6 et 7 mai 2004
Conférence inaugurale
Marie-Luce Délez
Stéphane Mayor

2
TABLE DES MATIERES
I. LE RÔLE DES INSTITUTIONS SOCIALES DANS LA
CONSTRUCTION DU BIEN-ÊTRE SOCIAL : APPROCHE
THÉORIQUE........................................................................................ 6
1.1. L’APPARTENANCE AU TROISIÈME SECTEUR ......................................... 6
1.2. L’APPARTENANCE À UN SYSTÈME RELATIONNEL .................................. 7
1.3. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ETAT INCITATEUR ET DES RÉSEAUX .............. 8
1.3.1. Une nouvelle définition du principe de subsidiarité............. 8
1.3.2. L’organisation de la solidarité : un nouveau mode de
fonctionnement.................................................................... 9
1.3.3. Un cadre nouveau pour les institutions sociales................. 9
a) la fragilisation des institutions sociales ............................................ 10
b) la mise en concurrence avec d’autres institutions............................ 10
c) l’obligation de développer des démarches qualités ......................... 10
d) l’obligation de se soumettre à des procédures de contrôle.............. 10
e) la discontinuité dans leur mission et la difficulté à planifier une
stratégie à long terme ............................................................................ 10
f) l’augmentation des dépenses liées à l’existence du réseau ............ 11
g) la recherche de fonds privés............................................................ 11
1.4. QUELLE PLACE POUR LES INSTITUTIONS SOCIALES ? ......................... 11
II. L’UTILITÉ SOCIALE DES INSTITUTIONS SOCIALES..................... 12
2.1. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L’ÉCONOMIE
SOLIDAIRE..................................................................................... 12
2.2. LE CONCEPT D’UTILITÉ SOCIALE EN FRANCE ..................................... 13
2.3. LA FIN DE L’IDÉE D’UNE UTILITÉ SOCIALE PAR NATURE ........................ 13
III. LE RÔLE ÉCONOMIQUE DES INSTITUTIONS SOCIALES EN
SUISSE.............................................................................................. 15
3.1. LE RÔLE DES INSTITUTIONS SOCIALES DANS LA PROTECTION SOCIALE
EN SUISSE .................................................................................... 16
3.1.1. Définition de la protection sociale en Suisse..................... 16
3.1.2. Quelques résultats quantitatifs et qualitatifs pour la Suisse
........................................................................................... 17

3
3.2. LE RÔLE DES INSTITUTIONS SOCIALES DANS LA FORMATION
DU CAPITAL HUMAIN........................................................................ 19
3.2.1. La théorie du capital humain .............................................. 19
3.2.1.1. Les éléments du capital humain.................................... 20
a) L’investissement en capital humain .................................................... 20
b) Le rendement du capital humain......................................................... 20
c) Le stock de capital humain.................................................................. 21
1er indicateur : diplôme obtenu et niveau de formation..................................22
2ème indicateur : la littératie ou maîtrise de la lecture et de l’écriture .......... 22
3.2.1.2. Le stock de capital humain des professionnels
de l’action sociale .......................................................... 23
3.2.1.3. Le stock de capital humain des résidents présents
en institutions................................................................. 23
3.2.1.4. Les institutions détentrices et productrices d’un stock
considérable de capital social........................................ 24
Les institutions : une plus-value pour la société........................... 25
3.3. LE RÔLE DES INSTITUTIONS SOCIALES DANS LA FORMATION
DU CAPITAL SOCIAL......................................................................... 25
3.3.1. Le capital social : une nouvelle mesure de l’action
sociale ............................................................................... 26
3.3.2. Comment mesurer le capital social ? ................................ 27
3.3.3. A propos de l’action sociale, le débat actuel..................... 27
3.3.4. L’action sociale, un investissement dans le bien-être
pour tous !.......................................................................... 28
3.4. LE RÔLE DANS LES NOUVELLES RÉPONSES SOCIALES .......................... 28
IIII. POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ DES INSTITUTIONS
SOCIALES : QUELQUES PROPOSITIONS..................................... 30
4.1. LES INSTITUTIONS SOCIALES DANS LES STATISTIQUES OFFICIELLES..... 30
4.1.1. Les données fournies par l’Office fédéral de
la Statistique...................................................................... 30
4.1.2. Les conséquences d’un manque de lisibilité
ou de visibilité.................................................................... 30
4.2. LE MODÈLE D’ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES : LA FIN D’UNE ATTITUDE
DÉFENSIVE ?................................................................................. 31
4.2.1. La notion de valeur ajoutée de l’action des institutions
sociales.............................................................................. 32
4.2.2. Un exemple : l’analyse coûts-bénéfices dans les
traitements à base d’héroïne en Suisse............................ 33
CONCLUSION ........................................................................................ 35
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................... 37

4
INTRODUCTION
Institutions sociales : quel rôle économique ? à question évidente,
réponse évidente, semble-t-il ! Mais le chercheur est vite désillusionné.
La littérature sur le sujet est quasi-inexistante, les statistiques ne
distinguent pas les institutions sociales et la recherche ne semble pas s’y
intéresser.
Et pourtant...
À la question «les institutions sociales ont-elles un rôle économique ? »,
la réponse « oui » est immédiate et spontanée. Elles sont intégrées dans
le circuit économique, elles créent des emplois, elles génèrent des
recettes fiscales, elles fournissent de nombreux services (hôtellerie,
constructions, transports, services industriels, etc.). Elles contribuent à
l’intégration sociale d’une tranche de la population, elles sont actives
dans l’éducation, la formation et la politique de la jeunesse.
Personne n’est à même de contester ce rôle. Alors pourquoi reste-t-il
dans l’ombre ? Pourquoi n’est-il pas l’objet de recherches, d’articles,
d’analyses statistiques ? Quelles sont les raisons de ce manque de
visibilité ? de ce repli sur soi ? Pourquoi les institutions sociales se
cachent-elles ? Que craignent-elles ? Jean-René Loubat apporte une
amorce de réponse : « ces secteurs d’activité n’ont pas subi de
véritables contrôles ni d’injonction de résultat durant plusieurs
décennies. Ils sont même devenus, à partir des années soixante-dix, un
espace-refuge pour des personnes évitant le monde du travail ordinaire
ou à but lucratif, mais qui cherchaient malgré tout à s’insérer
professionnellement dans le ventre mou de la société capitaliste ».
Depuis une petite décennie, les institutions sociales se trouvent
projetées dans une forme de révolution culturelle, dans un contexte de
mutations et d’une nouvelle approche du travail social. Les indices sont
nombreux, comme la concurrence entre institutions, les démarches
qualité, les contrôles et les mandats de prestations, l’appartenance à une
logique de service ou le nouveau vocabulaire utilisé (le bénéficiaire
devient un client).

5
Dans les perspectives actuelles de restrictions budgétaires de la
protection et de la politique sociales, où toute allocation de ressources
est d’abord envisagée dans une optique de coûts, il devient impératif
pour les institutions sociales de révéler (et non pas de justifier) leur
investissement pour l’avenir, leur place dans les processus d’intégration
sociale et de bien-être social. Comme l’écrit Jean-René Loubat, « les
structures d’action sociale et médico-sociale constituent aujourd’hui une
parte intégrante et incontournable de l’univers des services d’une société
post-industrielle – part qui s’avère d’ailleurs loin d’être négligeable
puisqu’elle représente environ vingt-deux mille établissements ou
services, comprend quatre cent mille personnels et concerne un million
deux cent mille bénéficiaires sans omettre, bien sûr, tous les bénévoles
mobilisés » (ndlr : chiffres pour la France).
Que peut apporter la science économique dans une telle démarche ?
Cette discipline a un double objet : « (...) comprendre et conseiller.
Comprendre, c’est-à-dire établir objectivement une explication des
phénomènes économiques. Conseiller, c’est-à-dire apporter aux
décideurs un témoignage objectif sur les conséquences à attendre des
décisions alternatives entre lesquelles ils doivent choisir » (Malinvaud E.,
1990). L’enjeu de cette conférence et de ces deux journées de rencontre
est de stimuler de nouvelles pistes de réflexions, de comprendre les
raisons de cette discrétion et de mettre en place des projets ou des
modèles d’ouverture, afin que la société tout entière prenne
connaissance objectivement du rôle économique et social joué par les
institutions sociales.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%