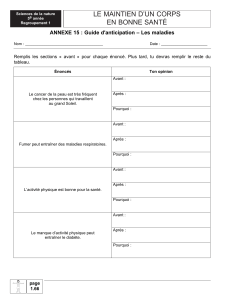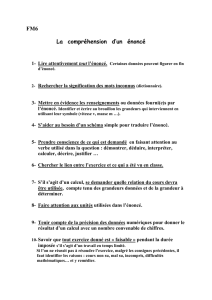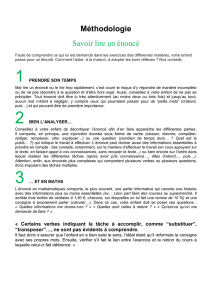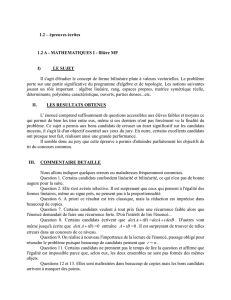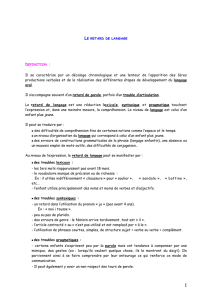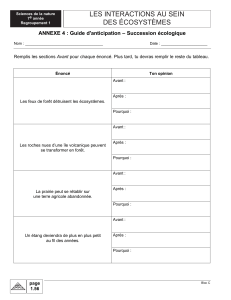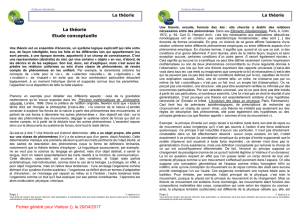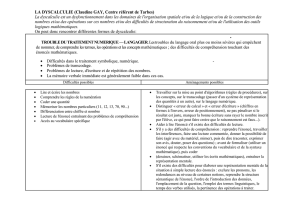Maria Tsyurupa. Énoncé simple en Yaouré.

Maria Tsyurupa
Abidjan, 12.02.07
Énoncé simple Yaouré1
0. Objet de l'étude
Cette étude représente une revue des énoncés simples en yaouré.
La langue Yaouré appartient au groupe sud de la famille linguistique mandé. La langue
apparantée la plus proche est le Gouro. L'étude présente se base sur le dialecte
taۨܕaۛܕ
parlé dans quatre
villages, y compris le Kiékiékro, d’où vient mon informateur principal.
Bradley Hopkins, dans son étude sur le système acpecto-modal du yaouré (Hopkins 1987),
propose la classification suivante des énoncés simples Yaouré (voir Fig. 1):
énoncés simples
verbaux
nominaux
nȳܕ statifs dynamiques
a / aܕS + (DO) + V + (IO)
Fig. 1. Classification des énoncés simples en yaouré
Selon la classification présentée dans Fig. 1, les énoncés simples en yaouré sont subdivisés en
deux groupes : les énoncés verbaux, caractérisés par la présence d'un lexème verbal qui peut se
combiner avec les marques du système aspecto-modal ; et les énoncés nominaux. Parmi des
énoncés verbaux, il y a un groupe des énoncés « verbaux statifs », qui se forment avec le lexème
a
(variante nasalisée :
a
ܕ), dont le statut grammatical est sujet à discussion, mais qui semble avoir
certains traits verbaux.
Ci-dessous nous examinerons les énoncés nominaux et les énoncés « verbaux statifs » avec le
lexème
a
.
1. Énoncés nominaux
1.1. Les énoncés nominaux sont construits avec la copule
ȳ
ܕ, qui a la combinaison
ȳۡ ̸
ۨ comme
son corrélat négatif :
nk
1 Ce recherche a été effectué dans le cadre du Projet commun SUBJ 062156.00 de l’Université de
Zürich et l’Université d’État de St. Pétersbourg, financé par la Fondation Nationale Suisse de
Recherche Scientifique.
Je tiens à exprimer ma gratitude à mon assistant et informateur Morton Kouamé pour son aide
précieuse dans mon recherche.
1

1 a)
Tr̸ۨ nȳۨܕ . b) Tr̸ۨ kۡ ̸ۨ . ȳ
n
k
n
n
vȳ
n
boeuf Cop boeuf Cop.Neg
C`est un boeuf . Ce n'est pas un boeuf.
La copule
nȳܕ
n’a pas de caractéristiques morphologiques du verbe. Dans (Hopkins 1987), elle a
été désignée comme un « actualisateur d'identification ».
À part sa fonction prédicative dans certains types des énoncés simples, la copule
ȳܕ
intervient
dans les constructions focalisées et relativisées, qui ne seront pas traités dans cette étude.
1.2. Interaction avec le contexte tonal
Sauf quelques rares exceptions, la copule garde son ton bas après le ton extra-bas ou bas. Après
le ton extra-haut ou haut elle assume le ton extra-haut ou haut respectivement.
Son corrélat négatif
ȳۡ ̸ۨ
garde toujours ses tons lexicaux.
1.3. Valeurs, structure
Deux types d'énoncé nominal à copule
ȳ
ۨܕ se distinguent en fonction de leur structures
syntaxiques. Il s’agit de l'énoncé d'identification et l'énoncé équatif.
1.3.1. Énoncé d'Identification: NP + Cop
L'énoncé d'identification se compose d'un syntagme nominal suivi de la copule
ȳ
ۨܕ.
Les exemples 1a, 2 et 3 représentent des phrases affirmatives, et l'exemple 1b une phrase
négative. L'énoncé de ce type exprime l'identification d'un objet de réalité à l'entité désigné par le
syntagme nominal. L'objet de réalité est introduit par le contexte (3) ou par les procédés
extralinguistiques (1 et 2).
2Mȳۛܕ tr̸ۨ nȳۨܕ.
mon boeuf Cop
C'est mon bœuf.
3 a) Aܕۨ bƥۨ nȳۨܕ. b) Maۨܕ nȳۛܕ.
moi même Cop moi Cop
(- Qui a mangé mes bananes?) – C'est moi.
Les phrases (3a) et (3b) sont synonymiques, mais il y a une différence structurelle. Dans (3a),
nous avons un pronom personnel sujet suivi de la particule d’ipséité, et dans (3b) apparaît un
pronom personnel focalisé.
1.3.2. Énoncé équatif : NP + NP + Cop
L'énoncé équatif se compose de deux syntagmes nominaux et de la copule
nȳۨܕ
.
L'énoncé de ce type établit le rapport entre les objets désignés par les syntagmes nominaux
(voir exemples (4)-(6)).
4[T
r̸ۨ laۛȳۛ][mȳۛܕ ȳۨ]nۨܕ.
boeuf Det je pour Cop
Ce boeuf est le mien.
5[
Flá s܍ȳۡvuۡ ȳۨ][aۨܕ sra۬ܕ]ȳۨܕ.
village chef Det je mari Cop
2

Le chef du village est mon mari.
6[M
iۨܕ laۛȳۛ] [flá s܍ȳۡvuۡ]ȳۨܕ.n
ƥçƥn
ƥІ
ƥ
n
homme Det village chef Cop
Cet homme est le chef du village.
Exemples (7a) et (7b) illustrent le phénomène déjà rencontré dans (3a) et (3b) : le pronom
personnel sujet avec la particule employé dans (7a) correspond au pronom personnel focalisé dans
(7b). Dans (7b), nous observons la forme
Іrȳ
ܕ, qui est le résultat de la fusion du pronom personnel de
3ème personne au singulier et de la copule:
7 a)
Flá s܍ȳۡvuۡ ȳۨ miۨܕ pl ۬ܕփ۬ܕ laۛȳۛ bۛ ȳۛܕ.
village chef Det homme grand Det il même Cop
b) Flá s܍ȳۡvuۡ ȳۨ miۨܕ pl ۬ܕփ۬ܕ laۛȳۛ rȳۛܕ.
village chef Det homme grand Det il.Cop
(Qui est le chef du village?) Le chef du village est cet homme grand.
2. Énoncés verbaux statifs
2.1 Les énoncés verbaux statifs sont construits avec le lexème
a
ۨ/
yà
(
aۨܕ
après une voyelle nasalisée),
qui a un corrélat négatif
ka...̸
:
8 a) S ۨà kpá. b) Sƥۨ ká kpá ̸۬.
pagne être bon pagne être.Neg bon Neg
Le pagne est bon. Le pagne n'est pas bon.
Dans (B. Hopkins 1987), le lexème
a
est considéré soit comme une copule, soit comme un
verbe défectif. Contrairement à copule
ȳ
ܕ, il possède certains traits verbaux. Dans ce qui suit, nous
traiterons ce problème plus en détail.
2.2. Interaction avec le contexte tonal:
Une analyse des contextes élémentaires a permis d'établir une règle préliminaire des
réalisations tonales du verbe
a
: il garde son ton bas après le ton extra-bas ou bas. Après le ton
extra-haut ou haut il assume un ton extra-haut ou haut respectivement. Cependant, les contextes
plus larges manifestent des déviations de cette règle, dont les mécanismes sont à spécifier.
Son corrélat négatif
ka
garde son ton haut. La particule négative
̸
semble avoir un ton extra-bas
après le ton haut, et dans tous les autres cas de s'assimiler au ton précédant.
2.3. Valeurs, structure
Selon leur structure, nous faisons la distinction entre trois types d'énoncé verbal statif :
l’énoncé locatif (avec un sous-type, l’énoncé équatif), l’énoncé qualitatif et l’énoncé présentatif. En
général, on peut dire que tous les énoncés susmentionnés désignent des situations statives.
2.3.1. Énoncé locatif : NP + être + LOC
L'énoncé locatif se compose d'un syntagme nominal suivi du verbe
a
et d’un complément
circonstanciel de lieu. L'énoncé de ce type décrit l'emplacement de l'objet désigné par le syntagme
nominal (exemples (9) et (10)).
3

9P
ȳۡzaۨܕnȳۛܕ aۛܕ iۨbaۡdaۡ.y
b
dƥ
dƥç
calao être arbre sur
Il y a des calaos sur un arbre.
10 Y
iۨbaۡ ȳ۬ àȳۨwlȳۛ ámaۡܕ.
arbre Det son fruit être sur
Sur cet arbre, il y a des fruits.
En plus de cela, l'énoncé locatif peut exprimer l'idée de possession ou de l'existence.
L’exemple (11) peut exprimer chacun de ces deux valeurs, selon le contexte:
11
Mȳۛܕ Ŷlá yààgá á na۬ܕ.
mon mouton trois être là
Mes trois moutons existent. / J'ai trois moutons.
2.3.1.a Énoncé équatif: NP + être + [NP + Pp]
L'énoncé équatif se compose d'un syntagme nominal suivi du verbe
a
et d’un autre syntagme
nominal avec la postposition comitative
ç
(exemples (12) et (13)). L'énoncé de ce type établit le
rapport d’équivalence entre les objets désignés par les syntagmes nominaux. La différence entre les
énoncés équatifs avec la copule
nȳܕ
et ceux avec le verbe
a
est traitée dans la section 3.
12
AܕۨŶփ̸ۡۡ áƥ۬dr ۨ ç.
moi frère être medicin Pp
Mon frère est docteur.
13
AܕۨŶփ̸ۡۡ áƥ۬dr ۨkpá .
moi frère être medicin bon Pp
Mon frère est un bon docteur.
2.3.3. Énoncé qualitatif : NP + être + Adj
L'énoncé qualitatif se compose d'un syntagme nominal suivi du verbe
a
et d’un adjectif.
L'énoncé de ce type attribue une qualité à l'objet désigné par le syntagme nominal (exemple 14).
14
AܕۨŶփ̸ۡۡ á kpá.
moi frère être bon
Mon frère est bon.
2.3.4. Énoncé présentatif : NP + être
L'énoncé présentatif se compose d'un syntagme nominal suivi du verbe
a
. L'énoncé de ce type
exprime l’idée de l’existence de l’objet désigné par le syntagme nominal (exemple (15)). En plus de
cela, cette construction est utilisée pour exprimer l'idée de possession (voir exemples (16a) et (17)
dans la section suivante).
15
Ɖàlì à.
Dieu être
Dieu existe.
4

2.3.5. Possession
Nous venons d'examiner les quatre types d'énoncé verbal statif en partant de leur structure à
leur sens. Dans la section présente, nous assumons la stratégie inverse. Ci-dessous, nous présentons
les différents moyens qui permettent d'exprimer l'idée de possession en Yaouré.
L'idée de possession est souvent exprimée par une construction présentative, comme dans les
exemples (16a) et (17).
L'autre moyen d'exprimer l'idée de possession est une construction locative (exemples (16b) et
(11)). Les constructions (16a) et (16b) ne sont pas tout à fait synonymiques : les deux peuvent
exprimer la possession abstraite, mais pour exprimer la possession actualisée on doit utiliser
seulement la construction du type (16b).
16 a) M
ȳۛܕ lá á.Ŷ
a
kƥ
ƥ
n
mon mouton être
b) Ɖlá á ۛܕlƥۛ.
mouton être à moi
J'ai un mouton.
17
AܕۨŶփ̸ۡۡ à.
je frère être
J'ai un frère.
11
Mȳۛܕ Ŷlá yààgá á na۬ܕ.
mon mouton trois être là
Mes trois moutons existent. / J'ai trois moutons.
2.4. Formes impérative et progressive
D'après (Hopkins 1987), le verbe défectif
a
possède deux radicaux verbaux: k
ƥ
ܕ,à partir duquel
est dérivé la forme impérative (19) et la forme inaccomplie (18), et
a
,qui est considéré comme la
forme accomplie. À la différence des autres verbes, le verbe défectif ne possède pas de forme
progressive et il n'apparaît pas aux autres aspects complexes du mode indicatif.
18
Ò۬ܕa۬ܕ feۡiۨtrȳۡ.
ils être.Inacc champ demain
Ils seront au champ demain.
19 K
àà k ۛܕ trƥۨlƥ۬.
nous.Incl être.Imp calm
Soyons calmes.
2.5. Nature verbale du lexème
a
Ci-dessous nous présenterons quelques exemples qui montrent la nature verbale du lexème
a
.
1. Le lexème
a
requiert la reprise pronominale après le sujet suivi par le déterminant (20). C'est
un trait caractéristique des verbes ; il faut mentionner que dans les constructions avec la copule
ȳ
ܕ
(5) une reprise pronominale n’a pas lieu.
5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%