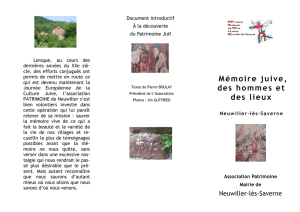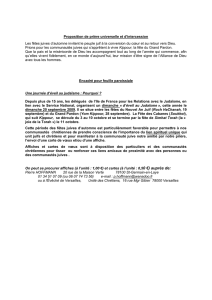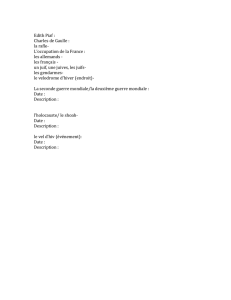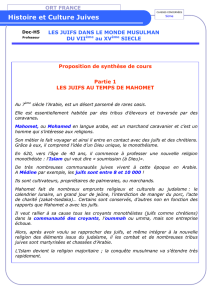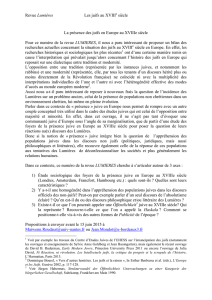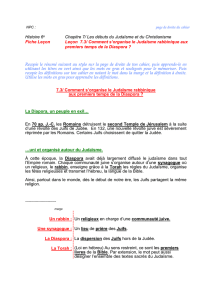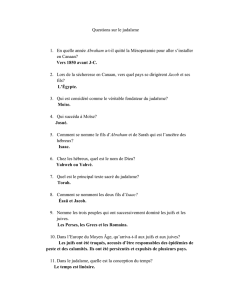NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Revuedesétudesjuives,173(3-4),juillet-décembre2014,pp.421-491.
doi:10.2143/REJ.173.3.3062109
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Moshe BAR-ASHER. — םימכח ןושלב םירקחמ («Studies in Mishnaic Hebrew»), Jéru-
salem, Mosad Bialik, 2009, 2 volumes, 394 et 379 pages («Asupot», 4-5).
Moshe Bar-Asher a rassemblé dans ces deux volumes un florilège de trente et un
articles publiés sur une période de quarante ans et les a classés en six parties consa-
crées aux différents axes de la recherche sur la langue des Sages. La première
d’entre elles s’intéresse au statut même de la langue des Sages, au corpus littéraire
et à la prise en compte de documents non rabbiniques et d’inscriptions. Diverses
questions d’ordre général sont abordées au cours de ces chapitres introductifs: Peut-
on parler d’unité de l’hébreu mishnique? Quelle relation cette langue entretient-elle
avec l’hébreu de la Bible? L’auteur a ensuite repris deux articles écrits à vingt ans
d’intervalle dans lesquels il faisait le point sur les études linguistiques en cours et
abordait la question de la typologie des différents manuscrits mishniques. Il rappelle
la position de (Edward) Yeḥezqel Kutscher pour qui seul l’hébreu de la Mishna,
conservé dans le manuscrit Kaufmann, reflète la langue des Tannaïm; puis il expose
la typologie proposée par David Rosenthal (1981) — division en deux branches,
palestinienne et babylonienne — qu’il a lui-même contribué à développer (1983),
distinction entre type occidental et oriental à l’intérieur de la branche palestinienne.
En élargissant ainsi le cadre fixé par Kutscher, Rosenthal et Bar-Asher ont réhabi-
lité des traditions et variantes linguistiques attestées dans d’autres manuscrits.
Le chapitre suivant est consacré à la spécificité de l’hébreu mishnique. L’auteur
s’oppose à Zeev Ben-Ḥayyim sur le degré de proximité des grammaires de l’hébreu
mishnique et de l’hébreu biblique. Sans remettre en cause le principe de l’unité
morphologique, il conclut que l’on est en présence de deux systèmes grammaticaux
distincts.
Dans la seconde partie, l’auteur décrit les traditions linguistiques conservées dans
trois manuscrits: [Budapest, Magyar tudományos akadémia könyvtár], Kaufmann A
50 considéré jusque là par Kutscher comme l’archétype textuel; Parme De Rossi
497 et Rome 32 [scil. Biblioteca Casanatense, 32.1] qui contient le SifreBamidbar.
Il relève de nombreuses variantes qui ont longtemps été considérées comme des
corrections tardives mais sont bien les témoins de traditions anciennes, qu’il s’agisse
de graphie, phonologie, morphologie, syntaxe ou lexique.
Dans la troisième partie, l’auteur étudie les traits linguistiques communs aux dif-
férents manuscrits, avec leurs variantes et spécificités. Il s’intéresse à la présence
d’éléments d’hébreu biblique dans la langue des Sages, dans la forme mais aussi
dans le contenu, et se demande s’il s’agit d’emprunts conscients ou de corrections
scribales au moment de la copie, voire lors du passage du manuscrit aux premiers
imprimés.
Le second volume est consacré à la grammaire de l’hébreu mishnique: la pre-
mière partie traite du verbe, la seconde de la formation du nom, également l’objet
d’une étude comparative entre l’usage biblique et celui de la langue des Sages; la
troisième partie s’intéresse aux schèmes nominaux. Tout au long de cet ouvrage,
l’auteur s’est fondé essentiellement sur les traditions linguistiques reflétées par deux
97567.indb 42197567.indb 421 28/01/15 10:1028/01/15 10:10

422 NOTESBIBLIOGRAPHIQUES
Revuedesétudesjuives,173(3-4),juillet-décembre2014,pp.421-491.
manuscrits principaux — Parme De Rossi 497 et Kaufmann A 50 — tout en faisant
appel à d’autres témoins fiables: Parme De Rossi 138, Cambridge Add. 470,1 dans
l’édition de W. H. Lowe (Cambridge, 1883); Sankt-Peterburg, Rossiiskaia Natio-
nal’naia Biblioteka, Evr. Antonin B 825; le manuscrit autographe de Maïmonide
(cote non indiquée) dont le facsimilé a été publié par Solomon David Sassoon
(Copenhague, 1956-1966), édité par Y. Qafiḥ (Jérusalem, 1963-1968); Paris, BNF,
Hébreu 328-329; Jérusalem, JNUL, Heb. 4° 1336.
Ces deux volumes reflètent le travail impressionnant accompli en vingt ans de
recherche sur l’hébreu mishnique et ses variantes et il ne nous reste plus qu’à espé-
rer la publication d’un travail synthétique à l’attention d’un plus large public.
À la fin de chaque volume, on trouve liste des abréviations, index des sources,
index des mots, index grammatical, index des auteurs et ouvrages classiques, suivi
d’un index des auteurs modernes. Liste des abréviations, bibliographie (presque
identique dans chacun des volumes); index des références bibliques et rabbiniques
(Mishnah, Midrashhalakhah, Talmud de Jérusalem, Talmud babylonien, Midrash
aggadah, autres textes) et quatre références au Nouveau Testament; index des mots,
expressions et noms propres en hébreu mishnique, araméen, akkadien, arabe et perse;
index des termes grammaticaux; index des auteurs et ouvrages. Ces deux volumes
sont publiés dans la collection «Asupot» de l’Institut Bialik, créée en 1998 pour
permettre aux chercheurs confirmés de réunir leurs articles parus dans différents
recueils et périodiques.
Judith KOGEL
Amram TROPPER. — SimeontheRighteousinRabbinicLiterature.ALegendRein-
vented, Leyde-Boston, Brill, 2013, 249 pages («Ancient Judaism and Early
Christianity», 84).
Shim‘on le juste (dans la suite S.) est une grande figure de l’époque du Second
Temple, connue notamment de Flavius Josèphe. Aucun ouvrage de synthèse n’avait
été jusqu’à présent consacré aux sources rabbiniques qui l’évoquent également. C’est
chose faite avec le nouveau livre d’A. Tropper. S. est d’abord l’un des maillons de
la chaîne de transmission de la Tora, décrite au début des PirqeAbot. Des chaînes
plus anciennes existent dans la Mishna, avec une portée plus limitée puisqu’elles ne
concernent qu’une halakha spécifique. Certaines sont très simplifiées et se contentent
de citer quelques rabbins avant de passer directement à Moïse. D’autres sont plus
étoffées: celle du traité Pe’a (2, 6) mentionne par exemple les prophètes et les paires
(zuggot). Toutes se terminent par la formule: halakhale-Moshemi-Sinay. La chaîne
des PirqeAbot, partiellement influencée par la culture hellénistique, est une pro-
duction tannaïtique: elle part de la chaîne du traité Pe’a et ajoute des maillons entre
Moïse et les prophètes (Josué et les anciens) et entre les prophètes et les paires (les
hommes de la Grande Assemblée et S.). Le modèle fourni par le livre de Néhémie
(chapitres 8 à 10) explique la mention des anciens ainsi que l’absence des prêtres.
S. a été ajouté de par le prestige qui l’accompagne dans le livre de Ben Sira ainsi
que dans la littérature tannaïtique. La version des Abotde-RabbiNatan a apporté
à son tour des maillons nouveaux dans la chaîne des PirqeAbot (les juges entre
les anciens et les prophètes, Agée, Zacharie et Malachie entre les prophètes et les
hommes de la Grande Assemblée). Toujours dans les PirqeAbot (1, 2), une maxime
97567.indb 42297567.indb 422 28/01/15 10:1028/01/15 10:10

NOTESBIBLIOGRAPHIQUES 423
Revuedesétudesjuives,173(3-4),juillet-décembre2014,pp.421-491.
est
attribuée à S.: le monde repose sur trois piliers, qui sont la Tora, le service et
la pure générosité. S. ne peut en être l’auteur, puisque le mot ‘olam n’est pas employé
au sens de «monde» avant le
I
er
siècle de notre ère
1
. Il est probable que la formule
d’introduction («le monde repose…») provient d’une autre maxime des Pirqe
Abot (1, 18),
attribuée à Rabban Shim‘on ben Gamliel. L’identité des trois piliers
a été fixée à partir d’un texte du traité Yoma de la Mishna (7, 1), contenant les
bénédictions récitées par le grand prêtre, le YomKippur, après la lecture de la Tora.
Les trois premières sont des bénédictions «sur la Tora, sur le service et sur l’action
de grâce». Seul le troisième terme diffère d’Abot, 1, 2, mais les notions d’action de
grâce (hodaya) et de pure générosité (gemilutḥasadim) sont plus liées qu’on ne
pourrait le penser.
S. apparaît comme grand prêtre dans une histoire où il est confronté à un nazir
qui lui apporte une offrande de culpabilité. La version la plus ancienne se trouve
dans le SifreBa-midbar (§ 22). Il s’agit du seul moment dans sa vie où il a consommé
cette offrande. Contrairement aux lectures traditionnelles selon lesquelles S., hostile
au naziréat, s’est privé volontairement de l’offrande, l’A. estime que cette dernière
était tout simplement rare. Quant à la figure du nazir, elle témoigne d’une nette
influence grecque. Le naziréat est réinterprété en termes ascétiques, avec l’idéal de
la maîtrise de soi et le fait que le vœu permet au nazir de surmonter ses pulsions
sexuelles et de se consacrer totalement à Dieu, dans un véritable sacrifice de soi.
L’histoire du nazir ressemble à celle de Narcisse, mais son message final est diffé-
rent, puisqu’il affirme la possibilité de la repentance. Le personnage du nazir est
conçu non seulement à partir de l’exemple de Narcisse mais aussi à partir de modèles
bibliques, comme le berger David, le bien-aimé du Cantique des Cantiques et surtout
Absalon, tous ces personnages présentant des ressemblances avec le modèle princi-
pal qu’est Narcisse. Le grand prêtre S. est également connu pour sa rencontre avec
Alexandre le Grand. Certes, selon Flavius Josèphe (Antiquitésjuives 11, 304-347 et
surtout 326-339), c’est le grand prêtre Yaddua qui est confronté à Alexandre et
non S. Ce récit est fortement inspiré par le livre de Daniel ainsi que par des motifs
littéraires typiquement grecs, ceux de l’adventus et de l’épiphanie. Trois éléments
sont communs à Flavius Josèphe et au passage de Talmud Babli, Yoma, 69a. Le grand
prêtre dirige une procession qui va au devant d’Alexandre. Ce dernier se présente à
lui, lui témoigne du respect en s’inclinant devant lui et répond positivement à sa
demande. Il rejette en revanche la requête des Samaritains. Le récit de Flavius
Josèphe a probablement servi de base à celui du TalmudBabli, mais le grand prêtre
est désormais S. et le véritable enjeu de la rencontre a changé. Le TalmudBabli
insiste sur un complot samaritain visant à détruire le Temple. S. apparaît dans cette
perspective comme un équivalent d’Esther ou de Mardochée et le récit talmudique
suit dans son déroulement le scénario du livre d’Esther. L’auteur du récit a souhaité
enfin établir un parallèle implicite entre S. qui a risqué sa vie pour sauver le Temple
et Rabban Yohanan ben Zakkay, qui a fait de même pour sauver Yavné et l’avenir
du judaïsme.
1. L’argument n’est pas pleinement convaincant, car le mot ‘olam apparaît avec le sens de
«monde» dans Qo 3, 11; Dn 12, 7; Si 3, 18: voir K. A. FUDEMAN et M. I. GRUBER, «“Eternel
King/King of the World” from the Bronze Age to Modern Times: a Study in Lexical Semantics»,
Revuedesétudesjuives, 166, 2007, p. 218.
97567.indb 42397567.indb 423 28/01/15 10:1028/01/15 10:10

424 NOTESBIBLIOGRAPHIQUES
Revuedesétudesjuives,173(3-4),juillet-décembre2014,pp.421-491.
Flavius Josèphe rapporte une autre histoire de grand prêtre en lien avec S., celle
du grand prêtre Onias, qui a fondé un Temple à Léontopolis, en justifiant sa
démarche avec les versets d’Is 19, 18-192. Le parallèle talmudique met en scène
deux fils de S.: Onias et Shim‘on (ou Shim‘i). Le Talmud Yerushalmi (Yoma, 6, 3)
connaît deux versions des événements, celles de Rabbi Me’ir et de Rabbi Yehuda.
Selon Rabbi Me’ir, S. qui savait sa mort prochaine a recommandé aux prêtres de faire
d’Onias son successeur. Son frère Shim‘on, jaloux, lui tend un piège en l’habillant
avec des vêtements de femme dans l’exercice de sa fonction. Onias est contraint de
s’enfuir en Égypte, où il fonde «un autel pour l’Éternel» (Is 19, 19). Pour le raison-
nement a fortiori par lequel se termine le récit, il est «celui qui a fui le pouvoir».
Dans la version de Rabbi Yehuda, c’est Shim‘on qui succède à son père et Onias
qui tend le piège. Il est probable que le stratagème d’Onias est découvert et qu’il
doit pour cela s’exiler en Égypte. Le raisonnement a fortiori final voit dans Onias
«celui qui n’a pas eu le pouvoir» et loin d’avoir fondé un «autel pour l’Éternel», il
est coupable d’idolâtrie. Le TalmudBabli (Menaḥot, 109b), qui part vraisemblable-
ment de la version du TalmudYerushalmi, introduit des éléments nouveaux. S. ne
recommande pas la nomination de l’un de ses fils mais l’impose sur son lit de mort:
ce testament va à l’encontre du droit d’aînesse. Selon Rabbi Me’ir, Shim‘on l’aîné
est victime d’une injustice, puisque S. nomme son frère cadet Onias à sa place. Pour
Rabbi Yehuda, Onias refuse l’honneur qui lui est fait mais se montre quand même
jaloux de son frère. Les raisonnements a fortiori que le TalmudYerushalmi attribue
aux deux tanna’im sont inversés dans le TalmudBabli. Selon l’A., il était inévitable
que l’Onias de Rabbi Yehuda soit appelé «celui qui a fui le pouvoir», puisqu’il a
refusé la grande prêtrise, mais l’inversion des conclusions réussit moins à l’Onias
de Rabbi Me’ir, désormais qualifié d’idolâtre alors que le contexte ne s’y prête
guère. Le récit talmudique est donc construit autour d’une catégorie centrale dans
la pensée des rabbins, celle de la transmission. La transmission de la Tora d’un
maître à un disciple ou d’une génération à une autre est souvent perçue comme
un moment délicat, susceptible d’engendrer des crises voire des hérésies. Il en est
de même ici au sujet de la grande prêtrise. Le texte manifeste aussi une tendance
anti-sacerdotale: l’un des fils de S. ne connaît pas les fondamentaux du service du
Temple et l’autre n’hésite pas à le tromper. S. est le dernier représentant d’une époque
idéale, où la grande prêtrise ne s’était pas encore dégradée en objet de convoitise
humaine. L’A. termine son enquête par les enjeux chronologiques. Flavius Josèphe
situe explicitement Shim‘on «le juste» au début du IIIe siècle avant notre ère et il
cite aussi son petit-fils, appelé également Shim‘on (II), dont Ben Sira a fait l’éloge.
Certains historiens préfèrent identifier ce deuxième Shim‘on avec S. Sur cette ques-
tion chronologique, les sources rabbiniques peuvent être réparties en trois groupes.
Un premier groupe date S. de manière vague, dans la période du Second Temple. Un
deuxième groupe, plus précis, estime qu’il a vécu avant le règne de Jean Hyrcan. Ces
deux premiers groupes de textes laissent penser que les rabbins auraient mélangé les
deux Shim‘on de Flavius Josèphe en une seule figure. Un troisième groupe de tradi-
tions fait de S. le contemporain d’Alexandre ou des «restes de la Grande Assemblée».
2. Flavius Josèphe fait d’Onias le fils ou le petit-fils de Shim‘on II, qui en principe est
le petit-fils de Shim‘on le juste, mais les historiens l’identifient souvent à Shim‘on le juste
lui-même.
97567.indb 42497567.indb 424 28/01/15 10:1028/01/15 10:10

NOTESBIBLIOGRAPHIQUES 425
Revuedesétudesjuives,173(3-4),juillet-décembre2014,pp.421-491.
Cette datation est en fait assez proche de celle du deuxième groupe, car, selon les
rabbins, la souveraineté perse n’a duré que trente-quatre ans. Une seule tradition est
vraiment discordante, celle qui met en scène S. avec Caligula. Cette tradition a
cependant un parallèle plus ancien dans Megillatta‘anit, où S. n’est pas mentionné.
Ce dernier aurait été introduit dans un deuxième temps, sous l’influence du récit qui
rapporte la rencontre de S. et d’Alexandre. Les sources rabbiniques sont donc cohé-
rentes dans leur datation de S.
Après ce bref résumé des résultats auxquels est arrivé l’A., il reste à dire quelques
mots sur la méthode qui les a rendus possibles et sur l’enseignement plus général que
l’on peut en tirer. La méthode suivie par l’A. est la même que celle qu’il avait déjà
mise en œuvre dans un ouvrage antérieur intitulé Ka-homerbe-yadha-yoser.Ma‘ase
hakhamimbe-sifrutHazalet recensé ici par nous
3
. Elle relève essentiellement de
l’histoire littéraire, c’est-à-dire de la recherche systématique des strates d’un récit et
des sources dont a disposé son narrateur. Cette recherche permet de montrer com-
ment le narrateur a retravaillé les matériaux qu’il avait à sa disposition, de manière
à les rendre aptes à remplir la fonction et l’objectif qu’il leur assigne. Concernant S.,
les rabbins ont hérité de matériaux d’origine diverse (Flavius Josèphe, Ben Sira, tra-
ditions rabbiniques antérieures) et ils les ont modifiés au gré de leurs préoccupations,
dans le cadre d’une matrice plus générale qui est la culture hellénistique et romaine.
Il est donc vain de chercher chez eux le S. historique, on y trouvera uniquement une
figure recomposée par l’imaginaire rabbinique d’une époque bien déterminée.
José COSTA
Benedikt ECKHARDT. — EthnosundHerrschaft.PolitischeFigurationenJudäischer
IdentitätvonAntiochosIII.bisHerodesI., Berlin-Boston, de Gruyter, 2013,
458 pages («Studia Judaica», 72).
Ce livre est issu d’une thèse, rédigée à la Ruhr-Universität de Bochum sous la
direction de Linda-Marie Günther, spécialiste entre autres d’Hérode le Grand.
L’objectif de l’auteur (B.E.) est d’explorer les transformations de la représentation
de l’«ethnos juif» dans les deux siècles qui séparent Antiochus III et Hérode. C’est
là certainement un objectif important: comme le montre B.E., la signification de ce
qui pouvait être compris par l’ethnos des Juifs/Judéens dans l’Antiquité était flexible
et liée à situation politique. Pour appréhender cette problématique de l’identité des
Juifs/Judéens en interaction avec le pouvoir politique, B.E. recourt à la notion de
«figuration d’ethnos» (Ethnos-Figuration). C’est d’ailleurs le titre de la première
partie du livre («Figurationen des judäischen Ethnos»). L’auteur s’intéresse autant
aux représentations non-juives (surtout séleucides) que juives (les Hasmonéens,
Hérode). À la suite de Steve Mason et d’autres, B.E. choisit de traduire Ioudaioi par
«Judéens» et non par «Juifs» (choix quelque peu simpliste, comme l’admet B.E.,
surtout pour ce qui concerne les textes issus de la diaspora).
Le livre de B.E. est ambitieux et comprend également une série de digressions
détaillées et très érudites. Ces dernières années, les travaux de Shlomo Sand ont
3. «Amram TROPPER, Ka-homerbe-yadha-yoser.Ma‘asehakhamimbe-sifrutHazal, Jéru-
salem,The Zalman Shazar Center for Jewish History, 2011», Revuedesétudesjuives, 172,
2013, p. 456-459.
97567.indb 42597567.indb 425 28/01/15 10:1028/01/15 10:10
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
1
/
71
100%