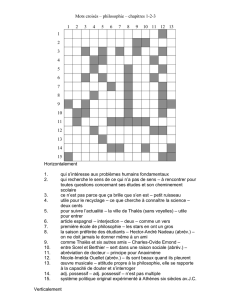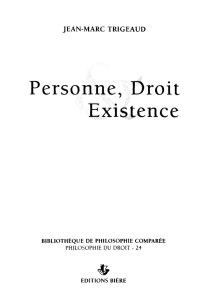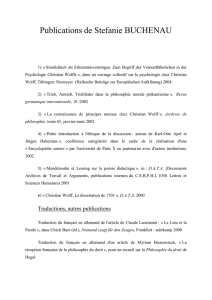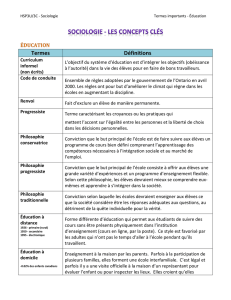Rapport d`activité sur les recherches effectuées

1
Laboratoired’ExcellenceHASTEC
Rapportd’activitéfinal
ContratPost‐doctoral
Annéeuniversitaire2013‐2014
par
PierreVesperini
RETOURSURL’ÉTHIQUEDESANCIENS:POURUNEXAMENCRITIQUEDES
THÈSESDEPIERREHADOTETDEMICHELFOUCAULT
Laboratoirederattachement:LEM(Laboratoired’étudessurlesmonothéismes‐UMR8584
Correspondantscientifique:PhilippeHoffmann
ProgrammeCollaboratif2:«Savoirscientifique,savoirreligieux,savoirsociaux»
ProgrammeCollaboratif6:«Culturedessciencesettechnologiedessavoirs»
Sommaire
Résuméduprojetderecherche–Page2
Développementetrésultatsdelarecherche–Page3
Activitésenrapportavecleprojetderecherche–Page8
ActivitéenrapportavecleLabExHaStec–Page9
Publicationsenrapportavecleprojetderecherche–Page10
Autresexposés,conférencesetactivitéderecherche–Page11
Autrespublications–Page12
Annexes–Page13

2
Résuméduprojetderecherche
Retour sur l’éthique des Anciens :
pour un examen critique des thèses de Pierre Hadot et de Michel Foucault
Dans le cadre de mes recherches post-doctorales sur les différents sens du mot philosophia
dans l’Antiquité, j’avais été de plus en plus amené à étudier l’éthique ancienne, et, ce faisant, de
plus en plus amené à me confronter aux thèses de Pierre Hadot et de Michel Foucault en la
matière.
Ces deux approches ont révolutionné la façon dont les historiens et le public cultivé
conçoivent aujourd’hui la philosophie antique, et leur influence n’a cessé de grandir, au point
qu’aujourd’hui on peut dire non seulement qu’elles font autorité, mais qu’elles définissent, aux
yeux d’un nombre croissant de nos contemporains, ce qu’il faut entendre par « philosophie
antique ». C’est la raison pour laquelle il m’a semblé important, pour éviter que ces deux grands
penseurs ne deviennent des figures doxiques et préserver ainsi la fécondité scientifique de leurs
travaux, de se livrer à un examen critique de leurs thèses. J’avais divisé cet examen en deux
grandes parties :
Il s’agissait d’une part d’essayer de resituer dans leur temps et dans leur parcours
personnel et intellectuel les travaux de Pierre Hadot et de Michel Foucault, de façon à les arracher
à cette espèce d’atemporalité à laquelle les réduit leur utilisation contemporaine, et de mieux faire
apparaître aussi tout ce qui les séparait et qui est trop souvent gommé.
Il s’agissait d’autre part de mettre en lumière trois dimensions de l’éthique ancienne que je
crois essentielles, et qui ont été négligées ou ignorées par Pierre Hadot et Michel Foucault,
comme d’ailleurs par la plupart des historiens de la philosophie antique :
1. la dimension religieuse de l’éthique ancienne : bien vivre, c’est vivre selon les dieux. Ce rapport
aux dieux est constamment présent dans l’éthique des Anciens, et est tout aussi constamment
ignoré par les savants contemporains.
2. la dimension physique de l’éthique ancienne : dans notre culture, le « spirituel » s’oppose au
« matériel », au « physique », et donc décrire l’éthique ancienne en termes d’« exercices spirituels »,
ou encore traduire askèsis par « ascèse » au lieu de le traduire par « entraînement », empêche
d’apercevoir l’écart infranchissable qui sépare l’éthique des Anciens de l’éthique chrétienne : les
exercices préconisés par les philosophes concernaient autant l’âme que le corps, et l’âme était
visée non pas en tant qu’entité isolable du corps, mais comme ce qui gouverne le corps. Les
philosophes partageaient donc avec les médecins et les entraîneurs sportifs une même
compétence sur la bonne façon de gouverner l’âme et le corps, qui reste encore en grande partie à
étudier ;
3. la dimension sociale de l’éthique ancienne : l’éthique des Anciens ne visait pas à constituer les
individus en « sujets », à leur faire inventer certains « styles d’existence », et ne procédait pas d’un
« souci de soi », mais visait ce que les Anciens appelaient une « orthopraxie », orthopraxia. C’est-à-
dire agir correctement, le caractère correct de l’acte étant défini par les conventions sociales.
Donc bien vivre, c’est vivre en bon père, en bon concitoyen, vivre en homme, toujours en
suivant les normes sociales, et non pas, sauf dans des cas très minoritaires, vivre en adoptant un
mode de vie spécifique, différent des autres.

3
Développementetrésultatsdelarecherche
Monprojetvisaità«historiciser»lestravauxdePierreHadotetdeMichelFoucaultsur
l’éthiqueancienne,et,àpartirdelà,àrevisitercelle‐cienmettantenlumièresdesaspectsquien
auraientétéméconnus.Jevaisbrièvementdonnerlesrésultatsauxquelsjesuisparvenusurcesdeux
plans,l’unhistoriographique,l’autrehistorique,etdonneraussilesquestionnementsnouveauxqui
ensontsortis,etdanslequeljesuisactuellementengagé.Cetexteserviraainsideprésentationaux
travauxquejejoinsenannexe.
Onpourraitdireque,parmilesantiquisants,lesunsconçoiventleurtravailcommeune
activitéprofessionnelle,distinctedeleurvieprivée,etlesautresleconçoiventcommeunepartie,
voirecommelatotalité,deleurexistence.Aucunedecesdeuxcatégories,entantquetelle,n’est
«meilleure»quel’autre.Ilestvraiquelapremièresemblemoinsprometteusequelaseconde.Mais
un«professionnel»scrupuleuxpeutfaireprogresserlasciencebiendavantagequ’unsavant
«engagé»,quesapassionpourraitégarer.Dansladeuxièmecatégorie,onpourraitencore
distinguerentrelessavantsquisontanimésparunpur«pathosdelavérité»,quisontobsédéspar
larechercheduvraietlaréfutationdufaux,etlessavantsqui,àtraversleurrecherche,poursuivent
unequêtepersonnelle,existentielle.UnPierreBayle,unLouisRobert,pourraiententrerdansle
premiergroupe:ilsveulentdirelevraietdémasquerleurscollèguesparesseux,brouillons,
conformistes.
PierreHadotetMichelFoucaultappartiennent,sansqu’onpuissejecroislecontester,au
deuxièmegroupe.Àtraversleurstravaux,c’estaussiunparcourspersonnelqu’ilssuivaient.Michel
Foucaultlereconnaît,dureste,dansuntextecitéparDidierÉribonaudébutdesabiographie,et
c’estaussicequisous‐tendtoutlelivred’entretiensdePierreHadotavecJeannieCarlieretArnoldI.
Davidson,LaPhilosophiecommemanièredevivre:unhommeaussipudiquequePierreHadotnese
seraitjamaislivréàdesconfidencesaussipersonnellesparfois,s’iln’avaitvouluindiquerparlàque
sontravaildevaitêtresituédansunparcoursexistentiel.
S’ilestvraiqu’onnesauraittransformerenhiérarchieladichotomiequej’aiproposéeentre
savant«professionnels»etsavants«existentiels»,ilestcependantjustedirequelesgrandes
révolutionshistoriographiquessontsouventlefaitdesseconds:ilscherchentetnetrouventpas
autourd’eux,dansl’étatdelasciencequilesentoure,dequoisatisfaireleurquête.Ilsvontdonc
chercherailleurs,ouchercherautrement,etc’estalors,quandlapassionquidonnelapuissancede
travailestassociéeausang‐froiddelacritique,quecessavantspeuventrévolutionnerleurdiscipline
etproduireunnouvelétatdelascience.
Aujourd’hui,lesconceptionsdePierreHadot,prolongéesparcellesdeMichelFoucault,
dominentlediscourshistoriographiquesurl’éthiqueancienne.Ellescourentainsilerisquedese
transformerendoxa.Montrerl’enracinementexistentieldeleursconceptions,cen’estdoncpasles
réfuter,maislesrelativiser,lessortirdeleurstatutde«véritésirréfutables».
IlfautpartirdePierreHadot,quia–del’aveudel’intéressélui‐même–influencédefaçon
décisiveletravaildeMichelFoucault.
Audébutdemarecherche,jepensaisquel’idéede«laphilosophiecommemodedevie»
étaitdueàtroisfacteurs:lesexpériencesmystiquesde«sentimentocéanique»quePierreHadot
avaitconnudèssonenfance;sonéducationcatholique,«danslesjupesdel’Église»(delà,pensais‐

4
je,lerecoursàuneexpressionaussisurdéterminéequecelled’«exercicesspirituels»;etenfin,les
différentes«philosophiesdel’existence»quiformaientl’environnementintellectueld’unjeune
hommedesagénération,ausortirdelaguerre.Toutcela,dureste,étaitbienconnu:onentrouve
témoignagedanslelivred’entretiensdontj’aiparlé,danslesrécits–écritsouoraux–deceuxqui
ontbienconnuPierreHadot,commeRichardGouletouPhilippeHoffmann,ouencoredansles
travauxdeMercèPratssurlajeunessecatholiquedePierreHadot1.
Cestroispointsmesemblenttoujoursincontestables,j’aipeudechosesàajouter,sicen’est
peut‐êtrequelaconceptiondelaphilosophiecomme«manièredevivre»et«exercicesspirituels»
étaitvraiment,plusqu’onnelecroitsouvent,dans«l’airdutemps».P.Hadotlui‐mêmed’ailleursl’a
laisséentendre,encitantàplusieursreprises,pourillustrersaconception,lelivredePaulRabbow
(1954)surla«conduitedesâmes»(Seelenführung)etlaMethodikderExerzitieninderAntikeou
encorelaphrasedeVictorGoldschmidtsurlesdialoguesdePlaton,qui«veulentformerplutôt
qu'informer».Maisonlatrouveaussi,énoncéetellequelle,dansÉpicureetsesdieux(1946)dupère
Festugière,quePierreHadotconnaissaitbienetcited’ailleursdanssonarticleclassiquesurles
«exercicesspirituels»,ouencore–eticilacoïncidenceestd’autantplusextraordinairequeletexte
étaitprobablementinconnudePierreHadot–chezJacquesLacan,selonquilescepticismeantique
consistaiten«exercicesspirituelscorrespondantsûrementàunepraxiséthique»2.LetextedeLacan
datedu15février1967,doncbienavantquePierreHadotnepubliesesrecherches.Maisjecrois,et
cecimeserviradetransition,que,quellequesoitladistanceintellectuellequileséparedePierre
Hadot,ilpartageaitavecluiundialoguepermanentaveclaspiritualitécatholique(notammentavec
sonfrèredominicain),etl’héritagedel’idéalismeallemand(onsaitl’importancequ’eurentchez
LacanlescoursdeKojèvesurlaPhénoménologiedel’Esprit).
Àmaconnaissance,onn’apasremarquéqueladéfinitiondes«exercicesspirituels»donnée
parPierreHadoten1974etrepriseensuitejusqu’àN’oubliepasdevivre,sondernierlivre,en
passantparleVoiled’Isis,étaitformuléedanslalanguedel’idéalismeallemand(«Espritobjectif»,
«totalitédupsychisme»dontlapensée(l’entendement)neseraitqu’uneexpressionponctuelle)3.
L’idéalismeallemanddontsenourritcettedéfinitionn’estpasceluideHegel(«Espritobjectif»ya
unsenstrèsdifférentdeceluiauquelpenseHadot),maisceluideGoethe,deHölderlin,deNovaliset
deSchelling.Ilmesembleque,biendavantagequesonéducationcatholique,biendavantagequeles
philosophiesdel’existenceauquelils’estinitié,c’estcettetraditiondel’idéalismeallemandqui
constitueleterrainàpartirduquelP.Hadotaabordél’Antiquité.
Dèslors,ilapparaîtquelescritiquesquivoyaientdanssonexpressiond’«exercices
spirituels»unesortedecatholicismedéguisé,etdontilseplaignaitrégulièrement(jusquedans
1 Il s’agit d’un mémoire de master 1 « Henri, Jean et Pierre Hadot, trois intellectuels catholiques » et d’un mémoire de
master 2 « Histoire de cinq clercs dissidents », encore inédits, réalisés sous la direction de Frédéric Gugelot. Je
remercie très chaleureusement Mercè Prats d’avoir bien voulu me communiquer ces mémoires passionnants.
2 Cité par J. Allouch, La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ? Réponse à Michel Foucault, Paris, EPEL, 2007, p. 61. Ce
texte est à son tour cité par Jacques Le Brun dans une conférence passionnante intitulée « Spiritualité ». Je le remercie
de m’avoir communiqué son texte.
3Danslepremiertexte,onlit(20022,p.21):«lemot“spirituel”permetbiendefaireentendrequeces
exercicessontl’œuvre,nonseulementdelapensée,maisdetoutlepsychismedel’individuetsurtoutilrévèle
lesvraiesdimensionsdecesexercices:grâceàeux,l’individus’élèveàlaviedel’Espritobjectif,c’est‐à‐direse
replacedanslaperspectiveduTout».Danslesecond,onlit(p.352):«Cetteallusionàl’immortalité,c’est‐à‐
direfinalementàlapuissancedel’esprit,laisseentrevoirquelethèmeduvoiled’Isisestinterprétéàl’époque
romantiquedanslaperspectived’unephilosophieidéaliste.DévoilerIsis,c’estreconnaîtrequelaNaturen’est
autrequel’Espritinconscientdelui‐même,queleNon‐moiqu’estlaNatureestfinalementidentiqueauMoi,
quelaNatureestlagenèsedel’Esprit.Malgrélesdifférencesprofondesquiexistententrelesdiverses
philosophiesromantiques,qu’ils’agissedeFichte,deSchelling,deHegel,maisaussideNovalis,lamême
tendancefondamentaleàidentifier,dansdifférentesperspectives,laNatureetl’Esprit,resteconstante».Cf.
aussiN’oubliepasdevivre.

5
N’oubliepasdevivre),manquaientleurcible.Les«exercicesspirituels»deP.Hadotn’ontrienàvoir
avecceuxd’IgnacedeLoyola:ilsuffitd’ailleursd’ouvrirlesExercicesspirituelsdufondateurde
l’ordredesJésuitespours’enrendrecompte.Enrevanche,ilspoursuivent,àleurfaçon,latradition
del’idéalismeallemand,tellequ’elleseprolongeaitaussichezKierkegaard,Nietzsche,Heidegger,et
biensûrWittgenstein.MaisilsemblequePierreHadotn’aitdévoiléquetrèsprogressivementson
appartenanceàcettetradition.
LestroisarticlesconsacrésàWittgensteinsontparusavantlapublicationdesesrecherches
surl’Antiquité,etn’établissentjamaisderapportavecl’Antiquité.Ils’agitdeprésentations,d’ailleurs
impressionnantesparleurmaîtriseetleurclarté,delapenséedeWittgenstein,aussibiendel’auteur
«mystique»duTractatusquedupenseurdes«jeuxdelangages»,del’auteurdesRecherches
philosophiques.C’estseulementdanssonlivred’entretiensqueHadotferaréférenceàWittgenstein,
maissurtoutauWittgenstein«mystique».Celuides«jeuxdelangage»estinvoquécommemaître
dephilologie,maisdefaçonassezpeuconvaincante,danslamesureoù,danslemêmelivre,Hadot
citecommedocumentsdela«viephilosophique»descomédiesathéniennesoudesépigrammesde
l’Anthologie,sansdonctenircomptedeleurstatuttrèsparticulierentantque«jeuxdelangage».
C’estprobablementàpartirdesonélectionauCollègedeFrancequePierreHadots’estsenti
davantagelibred’affirmersonlienàlatraditionidéalisteallemand:danslerecueildesesarticles
intituléExercicesspirituelsetphilosophieantique,iljointunindexdespassagestirésdeKierkegaard
etdeNietzsche.Ilpréfaceunerééditionduvolumineuxessaid’ErnstBertramconsacréàNietzche.
Cettepréfaceétaitd’ailleursungestepresqueprovocateur,carBertram,aprèsavoirappartenuau
cercledeStefanGeorge,étaitdevenunazi.SonNietzschen’estdoncpasdutoutleNietzschequise
voyaithéritierdesmoralistesfrançaisetdeVoltaire,maisleNietzschelyriquedeZarathoustra,que
lessoldatsallemandslisaienten1914,celuideRilkeaussi(autregranderéférencedePierreHadot).
Legestedepubliercetindexlocorumàlafindesonrecueilétaitunemanifestation,uneprofession
defoionnepeutpluséloquente:l’auteurmontraitqu’onnepouvaitlirelesAncienssanspasserpar
cesdeuxgrandsphilosophes.Etdefait,unefigureaussifondamentalequeSocrateestinterprétéeà
partirdeKierkegaardquedeNietzsche.
Cetteappartenanceàlatraditionidéalisteallemandeapparaîtenfindanslesdernierslivres,
lespluspersonnelsaussi:leVoiled’Isis,etleN’oubliepasdevivre,oùlesexercicesspirituels
antiquessontdirectementmisenparallèleavecdestextesdeGoethe.
Ainsis’éclaireaussilerapportambigudelanotiond’«exercicesspirituels»aureligieux.
Certes,iln’estpasquestiond’yvoirunquelconquerapportaveclecatholicisme.EtHadotamêmede
façoncatégorique–etd’accordencelaavecl’histoiredelaphilosophietraditionnelle,qu’ilsuffisede
penseràBréhier–opposé«philosophieantique»et«religion»4:
«Ondoitprendresoindedistinguerrigoureusementreligionetphilosophie.[…]Ilfaut
employerlemot«religion»pourdésignerunphénomènequicomportedesimages,des
personnes,desoffrandes,desfêtes,deslieux,consacrésàDieuouauxdieux.Cequin’existe
absolumentpasdanslaphilosophie.»
Onlevoit,cette«religion»queP.Hadotexclutdela«philosophieantique»,c’estlareligion
«rituelle».Àlaplace,ilérige,avecses«exercicesspirituels»,uneattitudedel’âmequi,commeily
insiste,s’ouvreàuneexpériencemystique,où«toutlepsychisme»estmobilisé.Cefaisant,ilrejoint
4P.Hadot,LaPhilosophiecommemanièredevivre,2003[2001],p.71‐72.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
1
/
64
100%