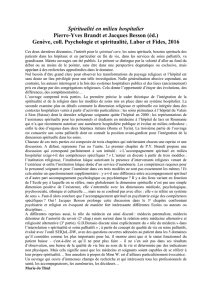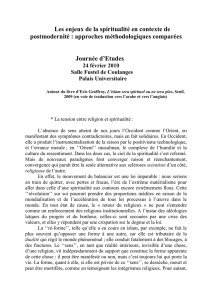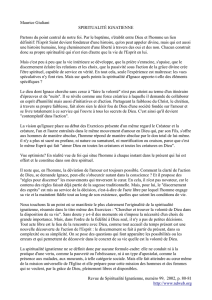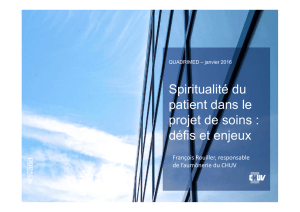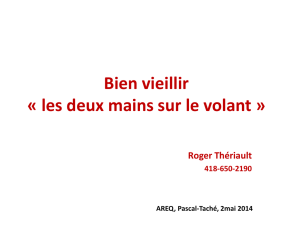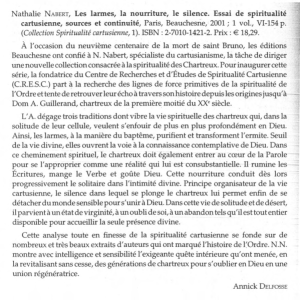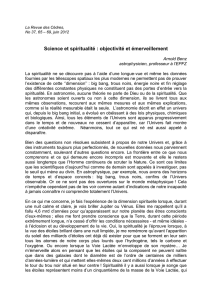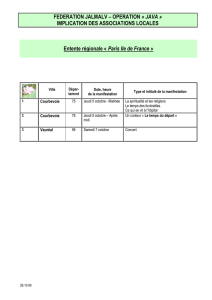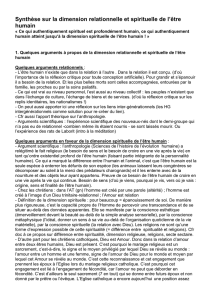Panoramique : Le mot spiritualité n`a circulé pendant très

“ REFLEXIONS POUR UNE SPIRITUALITE LAIQUE ”
INTERVIEW DU LAMA DENYS TEUNDROUP
CONDUITE POUR PANORAMIQUE PAR GUY COQ
Panoramique :
Le mot spiritualité n'a circulé pendant très longtemps que dans la littérature
théologique et de manière interne aux églises chrétiennes. Or, de manière assez soudaine, ce mot
est passé dans la culture commune. Au prix de quelles ambiguïtés, voire de quelles confusions ?
Lama Denys pensez-vous qu’il y ait une spiritualité non religieuse ? Pensez-vous
également qu’il y ait une spiritualité en dehors du domaine de chaque grande religion
traditionnelle ?
Lama Denys :
Il y a une spiritualité non religieuse ; cela dépend de ce que l’on entend par “ spiritualité ”
et “ religion ”.
La spiritualité peut se définir en général comme ce qui concerne l’esprit et, en particulier,
dans ce qu’elle a de plus profond, comme une voie de réalisation de la nature de l’esprit-
expérience. C’est le cheminement ou la pratique qui conduit à réaliser ce que nous sommes et ce
qui est, essentiellement, ainsi que les qualités personnelles qui en procèdent. Finalement, c’est la
réalisation “ du fond du fond ” de ce que nous sommes et vivons. Ainsi comprise, la spiritualité
rejoint le “ connais-toi toi-même ” de l’injonction socratique : c’est une quête philosophique,
expérimentale et expérientielle, pratique et vécue, de la nature de l’esprit et de la réalité.
Une telle démarche spirituelle a naturellement un caractère universel et intemporel. La
réalisation de la nature de l’esprit-expérience a pu se vivre il y a quelques millénaires comme
elle peut se vivre aujourd’hui, dans une même expérience. Le fond de l’expérience spirituelle est
avant les représentations conceptuelles qui la décrivent ; c’est ce qui fait son universalité et aussi
qui explique qu’elle n’est pas réductible à une approche religieuse particulière, quelle qu’elle
soit.
La pratique spirituelle peut aussi se définir simplement comme ce qui rend la personne
meilleure, ce qui l’ouvre et l’éveille aux autres, au monde et à elle-même et développe en elle les
valeurs humaines fondamentales telles que la compassion, l’altruisme, la bienveillance ou la
sagesse. Ainsi la spiritualité authentique ne dépend pas de notre adhésion à une religion. C’est
un état d’esprit, de motivation et de capacité à vivre la vie quotidienne dans une attitude de

dans l’apprentissage de cette transformation intérieure. C’est un état d’esprit susceptible de se
vivre à chaque instant ; à la limite, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la vie devenant alors sa
pratique.
Pour nous, pratiquants de la voie du Bouddha, la question se pose de savoir si la tradition
que nous suivons est une religion.
La voie du Bouddha, que l’on nomme aussi Dharma, peut se résumer en deux points : la
vision de l’interdépendance de toutes choses et l’action de compassion, de non-violence
altruiste. C’est une “ spiritualité ” au sens où nous venons de la définir : un enseignement et une
pratique qui développent l’intelligence et l’action au-delà de l’ego, l’intelligence ouverte et
l’action altruiste.
L’enseignement du Bouddha n’est pas une religion au sens d’une adhésion à une
croyance, à un credo ou à un formalisme. Nous faisons ici une distinction très nette entre
croyance et spiritualité. La croyance peut être utilisée comme un tremplin ou comme une aide
vers la vie spirituelle, mais celle-ci demande de s’en libérer : en tant que fixations mentales, les
croyances et les dogmes sont des obstacles à la réalisation ultime. Par contre, si l’on entend par
“ religion ” ce qui nous relie à l’absolu, à notre nature fondamentale et essentielle – ce qui est
aussi le sens du mot “ yoga ” -, la tradition du Bouddha est une religion.
Toutes ces précisions étant entendues, le Dharma peut être dit une spiritualité, un yoga
spirituel, une science de la réalisation de la nature de l’esprit ou une voie de réalisation de
l’illusion et de ses souffrances. Sa quête n’a rien d’exclusivement religieux. Au niveau essentiel,
elle est avant les particularités et les croyances spécifiques des différentes religions. L’expérience
spirituelle est au cœur de la religion mais n’est pas réductible à celle-ci. C’est en ce sens que nous
parlons volontiers d’une spiritualité non religieuse.
Quant à la deuxième partie de votre question, il me semble qu’il y a des spiritualités en
dehors du domaine des grandes religions traditionnelles. Nous préférons d’ailleurs la notion de
“ tradition ” à celle de religion. Tradition est synonyme de transmission et s’applique aussi bien
à la spiritualité qu’à la religion ou à des démarches philosophiques, humanistes et même aux
approches indigènes.
Les grandes religions n’ont pas l’exclusivité de la spiritualité. Dans nombre de traditions
primordiales ou indigènes, il existe d’authentiques formes de spiritualité, parfois mieux
conservées que celles de certaines grandes religions institutionnalisées. Aussi est-il juste de
parler d’une spiritualité laïque, mais je préférerais éviter ce mot qui est très connoté,
particulièrement en français : pour des raisons historiques, laïque a souvent fini par avoir un
sens anti-religieux et même par devenir synonyme d’athée. Nous pourrions plus justement
parler d’une spiritualité agnostique, c’est-à-dire ne reposant pas sur une croyance – ce qui est

Panoramique :
Quel est le sens de cet essor de la spiritualité hors les murs ? On doit constater en effet
que ce développement de l'usage du mot spiritualité est parallèle à un recul certain de
l'influence des grandes religions organisées et capables de "coder" l'expérience spirituelle. Quels
sont les risques de cette situation ? Ne va-t-on pas vers une spiritualité melting-pot, bouillie
mélangeant des apports éclectiques de style Nouvel Age ? Ne va-t-on pas vers une
spiritualité-pathos confuse, refusant l'intelligence, enfermée dans l'émotionnel et, du coup,
exposée aux pires régressions des religions archaïques ?
Lama Denys :
Le recul des grandes religions institutionnalisées et la montée de multiples formes de
quêtes spirituelles, plus ou moins sauvages, constituent effectivement un risque mais sont aussi
le signe d’une aspiration. Pour reprendre une formule qui me semble assez juste : “ Le monde a
une indigestion de religions mais il est affamé de spiritualité ”.
Il est clair que les credo, les dogmes auto-référents et les arguments d’autorité ne font
plus aujourd’hui recette en Occident. A mon sens, c’est plutôt une bonne chose et un signe
d’intelligence, mais cette situation entraîne aussi bien des problèmes.
En effet, la plupart de nos contemporains ont pour ainsi dire “ jeté le bébé avec l’eau du
bain ” en prenant des distances avec leur religion d’origine, celle-ci n’ayant plus vraiment de
sens pour eux ou ne répondant plus à leurs aspirations ; ils se sont ainsi coupés de toute
démarche spirituelle, s’exposant à un manque, un désarroi qui entraîne des problèmes
existentiels et de société.
Autre problème : le fourvoiement spirituel. Le cœur du cheminement spirituel est dans la
transformation de l’esprit, dans la libération de celui-ci vis-à-vis de l’égoïsme et de
l’égocentrisme, de leurs passions et illusions. C’est une voie très exigeante qui implique de
remettre en question le “ moi que je suis ”. Cela demande la rigueur et la discipline permettant
de lâcher les fixations passionnelles et la saisie de l’ego dans ses imprégnations les plus
archaïques. Une spiritualité profonde et authentique nécessite une voie cohérente avec une
transmission et un apprentissage précis. Au sein de celle-ci, le contact interpersonnel avec un
guide ou un instructeur qualifié est indispensable.
Or beaucoup de personnes, ayant lu de nombreux livres, essaient de se constituer leur
voie à partir de leurs lectures, disant volontiers qu’elles n’ont besoin de personne pour les
guider. Malheureusement, dans le cheminement spirituel, être ainsi autodidacte revient
finalement à être “ ego-didacte ”. C’est une position pour le moins difficile quand il s’agit
précisément de dépasser l’ego ! Comment l’ego pourrait-il diriger sa propre disparition alors

D’autre part, les progrès faits sur la voie dépendent de la cohérence et du suivi de son
apprentissage. Prenons un exemple : l’apprentissage d’une discipline telle que les
mathématiques. Différentes langues véhiculent cet apprentissage de façon claire et précise,
chacune d’elle ayant une cohérence interne. Mais si l’apprentissage est transmis en mélangeant
des mots français, russes, chinois, etc. et en changeant continuellement de syntaxe, on aboutit à
l’incohérence et à la confusion. C’est la situation dans laquelle risquent de se retrouver ceux qui
mélangent différentes approches et traditions. Chaque tradition a sa langue et ses méthodes
propres, mais les mélanger dans un syncrétisme extérieur risque finalement de neutraliser les
capacités de chacune.
Donc, tout en ayant l’ouverture d’esprit qui comprend l’universalité de la spiritualité et
permet d’éviter le dogmatisme sectaire, il est essentiel de suivre une voie spécifique et de la
pratiquer complètement. Cet équilibre est un point fondamental pour une vision et une
approche que nous nommons d’“ unité dans la diversité ”.
Panoramique :
Quels sont les avantages de la situation ? N'est-ce pas la reconnaissance enfin faite que
la quête spirituelle authentique est une aptitude inhérente à tout esprit humain? Du coup,
n'est-ce pas une formidable interpellation faite aux religions traditionnelles, un appel à
dépasser les langues de bois, une invitation à rencontrer toutes les personnes en recherche et à
dialoguer ?
N'est-ce pas une chance (ou une obligation) pour le dialogue inter-religieux, car dans la
mesure où il est mené avec rigueur, avec souci de rencontrer l'autre, il attirera beaucoup de ces
personnes en quête spirituelle ?
Certes, la tentation de la facilité peut être aussi, dans le dialogue inter-religieux, de
chercher, même au prix de la confusion et des contresens, une sorte de base commune, dans le
silence des différences.
Lama Denys :
Comme nous l’évoquions au début, la quête spirituelle est inhérente à la nature même
de l’esprit-expérience et à tout esprit humain. Les différentes approches spirituelles convergent
dans une expérience commune avant les noms et les formes que sont les représentations
culturelles ; elles se rejoignent dans ce qui manque à toutes leurs expressions.
Au contraire, les religions qui se fondent sur une formulation littérale qu’elles prennent
pour “ la Vérité ” et qu’elles enseignent comme telle, sont inévitablement dogmatiques. Des
voies de ce type auront toujours des problèmes pour communiquer entre elles, chacune étant

dite dans sa propre langue. L’attachement aux noms et formes – et pire encore : leur
absolutisation – est finalement et simplement de l’idolâtrie conceptuelle.
En résumé, l’expérience spirituelle rapproche et fait converger dans le fond universel,
alors que les formulations religieuses ou théologiques, naturellement dogmatiques et
divergentes, entraînent la séparation illusoire.
C’est là un point très important pour le dialogue inter-religieux - que je préférerais dire
“ inter-traditions ”, d’ailleurs. Il s’agit de fonder celui-ci sur la convergence fondamentale des
traditions, ce qui permet non seulement de respecter la diversité et les différences de l’autre
mais d’apprécier celles-ci comme une richesse. C’est la base de la vision d’unité dans la diversité.
Dans cette vision, nous considérons que toute tradition, spiritualité ou religion, est authentique
dans la mesure où elle développe l’harmonie et la paix fondamentales ; c’est là le critère
essentiel. De plus, une voie qui permet de réaliser ces qualités au niveau ultime ou absolu n’est
pas seulement authentique mais aussi complète. Au contraire, une tradition qui générerait
dysharmonie et guerre serait pervertie ou malsaine.
Toutes les traditions authentiques partagent ainsi un dénominateur commun éthique et
spirituel. Celui-ci est précisément constitué par les valeurs essentielles au développement et à la
réalisation de l’harmonie, de la paix et du bonheur. C’est ce qui fait sa valeur et sa pertinence
universelle et permet d’envisager une vision éthique et spirituelle globale.
L’éthique universelle peut s’établir à partir du constat que nous sommes tous égaux dans
notre motivation au bien-être : tout vivant aspire au bonheur et à éviter la souffrance. Dans
cette motivation, autrui est naturellement mon semblable. Ainsi nous pouvons tous nous
rejoindre dans le principe de non-violence qui consiste à éviter de faire subir à autrui la violence
ou la souffrance dont je ne voudrais pas moi-même être victime : “ Ne fais pas à autrui ce que
tu ne voudrais qu’il te fasse ”. Cette règle, nommée Règle d’or de l’éthique, est non seulement
la base commune de toutes les traditions authentiques mais peut aussi être considérée comme
le principe fondamental d’où procèdent les différents préceptes et entraînements éthiques
enseignés par toutes les traditions, agnostiques ou croyantes.
Remarquez que cette approche a un caratère médical plutôt que juridique. Elle transmet
l’intelligence de la santé et du bien-être plutôt que les raisons de lois et les commandements. Elle
procède de la santé fondamentale de la vie et elle l’enseigne. D’un côté est l’harmonie de la
réalité ou de l’être ; c’est la santé fondamentale analogue à la santé physique pour l’organisme,
et cet état est naturellement bien-être et bonheur. D’un autre côté est la dysharmonie ; c’est la
réalité déformée ou l’être brouillé par les interférences que sont les illusions, un état de
dysfonctionnement analogue à la maladie et qui provoque évidemment mal-être et souffrance.
La thérapie sacrée est la voie de la guérison.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%