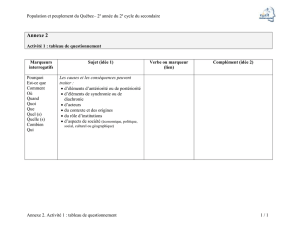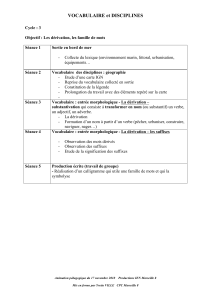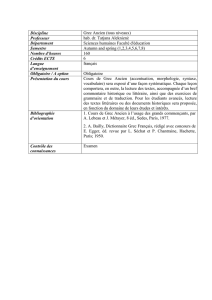- 125 - L`ILLOCUTOIRE EN GREC ET DANS LES LANGUES

- 125 -
L'ILLOCUTOIRE
EN
GREC
ET
DANS
LES
LANGUES
ANCIENNES
Françoise Letoublon Alain Pierrot
et
Université de Grenoble III Université de Paris III
La théorie de
1'ênonciation
et de
l'illocutoire
s'est
faite
à partir des langues vivantes (anglais et français principalement).
Sa méthode (comparaison de différents types d'énoncés
sémantiquement
voisins,
en vue d'analyser les différents actes illocutoires qu'ils
permettent
d'accomplir) semble appeler nécessairement le recours au
sentiment linguistique de la langue maternelle : les langues anciennes
paraissent donc
a
priori aux antipodes
d'une
telle théorie.
Or,
plusieurs exemples empiriques montrent au contraire que
l'on ne peut expliquer l'évolution sémantique de certains
termes
dans
les langues anciennes autrement que par des emplois où le sens du
moc
contient une allusion à
l'acte
illocutoire pour lequel il est
utilisé.
Certains paradoxes dans la relation sémantique entre un
lexème et sa famille de dérivation, ou entre un
lexème
et le sens de
sa racine indo-européenne ne peuvent s'expliquer que par l'histoire
de la langue, en recourant à la théorie de
1'ênonciation.
Inverse-
ment il faudra conclure que l'évolution linguistique reste dans une
(2)
certaine mesure inscrite dans chaque état de la langue
D'autre part, en synchronie, le recours à des règles de
déri-
vation illocutoire autorise une description satisfaisante
d'emplois
r
paradoxaux du verbe
eidenai,
"savoir" dans le corpus constitué par
les oeuvres de Platon, d'Aristophane et d'Euripide.
1.
DERIVATIONS
ILLOCUTOIRES
A
PARTIR
DE LA
MODALITE
DU
SAVOIR
f
L'examen
des emplois du verbe eidenai amène à se demander si
ce verbe, employé avec une subordonnée complétive ou une interrogative
indirecte, est
l'élément
central des énoncés auxquels il est intégré,
ou bien s'il fait bloc avec la subordonnée, ce qui lui donne le statut
marginal d'un adverbe modal.
"

-
126 -
(3)
O.
Ducrot
a
noté que savoir
" , du
fait
de sa
"factivité",
occupe
une
position
intermédiaire entre
les
verbes d'argumentation
comme démontrer
et les
verbes d'opinion comme
se
douter
que. De
même
que
démontrer,
savoir autorise l'enchaînement sur
Le
contenu
propositionnel
de la
subordonnée,
ce qui
tendrait
à
faire
de
celle-ci
un élément
du
posé,
mais,
comme
se
douter
que,
savoir présuppose
la
vérité
de la
subordonnée. Pour éviter d'admettre
la
possibilité d'en-
chaînement
sur les
présupposés,
O.
Ducrot envisage
La
solution
qui
consiste
â
considérer que savoir pose
en
fait
une
croyance,
et
que
les
enchaînements constatés reposent
sur
l'assertion
de
cette croyance,
considérée comme
un
argument valide pour
la
vérité
de la
proposition (4)
enchâssée,
sans que
la
vérité présupposée
de
celle-ci intervienne
Cette analyse, d'ailleurs, étayée
par une
référence
au
débat
du
Thêêtète,
semble largement conforme
aux
faits grecs anciens.
r
Le verbe
eidenai
possède effectivement
des
constructions
t _
factives,
avec des complétives
en
hoti
ou
hos,
ou
avec
une
construction
participiale. Négation
ou
mise
en
question
de
l'énoncé
global laissent
La vérité
de la
complétive hors
de
doute, comme
en
témoignent
les
exem-
—
'
-
'.
-
pies
suivants : Platon, Lois 642b : o xene
athenate,
ouk oîsth'isos
i
t _
±
_ i *
r
i
t
hoti tugkhanei
hemon
he hestia tes
poleos
oûsa
humon
proxenos.
"Peut-être
ne
sais-tu
pas, étranger d'Athènes,
que le
foyer
de
notre
ville
se
trouve être votre
proxêne".
i
t
*
»
i
t
i
id. Ion 535d : -oîstha
oûn
hoti kai ton
theaton
tous pollous
thuta
taûta
humeîa ergazesthe
; - kai
mala kalos
oîda.
"Ainsi donc, sais-tu que vous aussi, vous avez
ce
même effet
sur la
plupart des spectateurs
? - Je le
sais fort bien".
Malgré cette valeur
factive,
on
constate des enchaînements
sur
le
contenu
de la
subordonnée, comme
si le
verbe principal
se
comportait comme
un
adverbe modal marginal
:
_
r
i
i
t
id.
Critias 108d :
mnesthentes gar hikanôs
(...) ckhedon
otd'
hoti
*
_±
±
t
i
j.
'-
>
toi de toi theatroi doxomen ta prosekonta
metrios
apotetelekenai.
t x _ I
l
-
i
t
f
toût'otin aut'ede
drasteon,
kai
melieteon
ouden eti.
"Car,
en
rappelant correctement...,
je
sais bien que cette assemblée
estimera que nous avons satisfait
â
notre tâche.
C'est
donc cela même
qu'il faut faire, sans plus attendre".

-
127 -
Ce type d'enchaînement
semble
bien centrer
l'information
sur
la subordonnée,
et non sur le
verbe principal.
Une
analyse modale
serait étayée
par
d'autres arguments fondés
sur des
enchaînements
en
dialogue,
mais aussi
par des
faits syntaxiques.
Les
enchaînements
en
dialogue attestent
que
l'interrogation
peut porter aussi bien
sur le
savoir
que sur le
contenu
propositionnel,
quand oîstha,
"tu
sais",
est
construit avec
une
subordonnée interro-
gative indirecte
:
'
_ t t
i i
id.
Euthydème
294c : -
oîstha Euthudemon
hoposous
odontas
ekhei kai
i
— t
i i
_
ri
ho
Euthudemos hoposous
su;
-
ouk exarkeî
soi,
ephe3
akoûsai hoti panta
*
_
±
a
i i
iit
epistamstha;
-
medamos,
e
d'hos,
alla toûto eti
monon
eipaton...
"- Sais-tu combien
Euthydème
a de
dents,
et lui
combien
tu en as ?
-
Il ne te
suffit pas,
dit-il,
d'entendre
que
nous savons tout
?
-
Pas du
tout, reprit-il, mais contentez-vous
de
nous dire encore
cela...".
t
t t
Aristophane Cavaliers 1069 :
oîsth'ho H
estin toûto; -
Philostratos
_
-1
_
he kunalopex,
"Tu sais
ce que
c'est
? -
Philostrate
le
chien-renard
!"
Dans
les
deux cas,
le
savoir
de
l'allocutaire
est
effacé der-
rière l'interrogation
sur le
contenu propositionnel,
qui est le
véri-
table objet
du
développement discursif.
"Mais sais-tu
ce que tu
dois faire
?
Frappe
du
pied
le
rocher".
Dans
ce
type d'exemples, bien attestés,
les
deux actes marqués
entrent
en
concurrence,
et
l'usage
du
français exige soit
de les
juxta-
poser,
soit
d'en
éliminer
un si l'on
souhaite conserver
1'enchâssement.
I
t .
Syntaxiquement,
le
grec présente plusieurs usages
où
evdenai
semble marginal
par
rapport
à la
structure
de la
phrase.
On
trouve
en effet
des
exemples d'impératif enchâssé sous
oîstha
:
'
t ±
i
t
id. Cavaliers 1158 : otsth'oûn ho
drâson;
- ei de
me,
phraseis
ge su.
"Tu sais
ce que tu
dois faire
(litt.
fais
l)
? -
Sinon
tu vas
bien
(me
le)
dire".
t
*
i i
j.
t
xd.
Oiseaux 54 :
all'oîsth'ho drâsonj
toi skelei thene ten
petran.

- 128 -
r
Cette structure syntaxique est limitée à l'emploi d'eidenai comme verbe
introducteur,ce
qui invite à rechercher sa raison d'être dans la valeur
de ce verbe plutôt que dans le système syntaxique du grec ancien.
Dans les systèmes hypothétiques, on trouve fréquemment
ofd'/
t
otsth'hoti,
"je / tu sais que" préposé à l'apodose, alors que le rapport
n'est pas établi entre la protase et l'expression du savoir, ni même
marqué grammaticalement :
Platon République V 471 d : ei de kai
ta
thelu.
austvateuoibo,
(...)
t
f
_
f
_ r r
oîd'hoti tautéi pantei amakhoi
an eîen.
"Si même les femmes combattent avec eux
(...),
je sais qu'alors ils
seront absolument
invincibLes".
Enfin on note des emplois en incise du verbe, généralement
déterminé par un adverbe; il semble dès lors plus proche d'un adverbe
d'énonciation
que d'un prédicat susceptible d'ouvrir un développement
discursif.
'
r
J.
' —
* '
i
'
_
id*
Apologie 37b : anti toutou de
helormi
hon
eu.
oîda ti kakon onton
t
«,
t
toutou
timesamenos;
"Dois-je
à la place choisir quelque chose dont je sais bien (que
c'est)
mauvais pour m'y condamner ?".
i
L'ensemble
de ces emplois tend donc plutôt
à
faire d'eidenai
(5)
un modal marginal commentant
1'énonciation,
limité
à
un rôle d'incise " ,
Toutefois,
il paraît plus avantageux de considérer ces usages
comme dérivés par rapport à une valeur centrale, pleine,
d'eidenai»
de manière à éviter de créer une classe syntaxique particulière pour
rendre compte de la "transparence" logique des énoncés du savoir.
Cette analyse peut s'appuyer sur le fait que, construit avec
i
hoti
dans une interrogative,
otstria
fait d'ordinaire véritablement
l'objet
de l'interrogation : en témoigne l'exemple tiré
d'Ion
535d cité
plus haut, où seul le savoir de l'allocutaire est en cause.
D'autre part, dans les enchaînements où le contenu de la
subordonnée est en question, c'est-à-dire lorsque celle-ci est en
ques-
tion dans le développement discursif, ou est une interrogation indirecte,

- 129 -
certains exemples imposent de rapprocher savoir et croyance, conformé-
ment
à l'hypothèse
d'O.
Ducrot :
*
£
I r ± _
i
_
id. République 544d :
otstk'oûnt
en
d'ego,
hoti kai anthropon eide
tosaûta
anagke
etnai,
hosaper
kai
pctiteion;
e oisi ek
druos pothen
e
I I
II
±
F
m
I
_ f
ek petrae tas politeias
gignesthai,
... -
oudartos
egog',
ephey
allothen
jt
e
ent^ûthen.
"Ainsi donc, dis-je, sais-tu qu'il y a nécessairement autant d'espèces
de caractères que de gouvernements ? Ou bien crois-tu que les gouver-
nements viennent d'un chêne, ou
d'une
pierre, ... - Absolument pas,
dit-il,
d'ailleurs que de là, pour ma
part"(litt.).
La réponse porte à la fois sur le contenu du savoir
{l'allocu-
taire reconnaît l'origine humaine des types de
gouvernement),
mais
aussi sur sa croyance personnelle, comme le marque la référence à la
première personne.
On trouve
également
des enchaînements où ce qui est requis est
le savoir de
1'allocutaire
sur un point présenté dans une interrogative
indirecte. Le dialogue se poursuit alors sans que la réponse à l'inter-
rogation contenue dans la subordonnée ait à être exprimée. Cet usage
est d'ailleurs bien représenté en français :
" - Sais-tu
où
est le marchand de vin où je vais d'ordinaire ? - Oui.
- Eh bien, va y acheter six bouteilles de Corton
47..."
' t
i
J.
t _ t _
Platon Cratyle 434e : ... oude
oîstha
su
nùn
ho
ti
ego
legoj
-
egoge,
t
ri
» r
dia ge to
ethos,
o philtate
"... et dès lors tu ne comprends (litt. "tu ne sais") même plus ce
que je dis ? - Si, par habitude, très cher".
Le groupe par habitude s'applique bien évidemment à comprendre,
qui fait
l'objet
de la question.
Si l'on veut voir un usage d'abord descriptif du savoir dans
r
les
expressionSoù
eidenai est employé, il faut justifier la dérivation
des premiers exemples présentés. Or, cette dérivation est mise à jour
par certains textes, où
l'acte
d'interrogation est décomposé, avec
l'expression explicite des conditions préliminaires à son succès, sans
que cette décomposition ait l'apparence polémique qu'elle revêt dans
l'exemple de
l'Euthydème
cité plus haut :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%