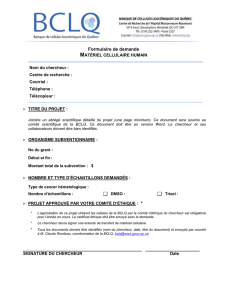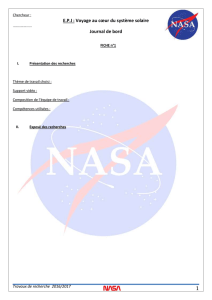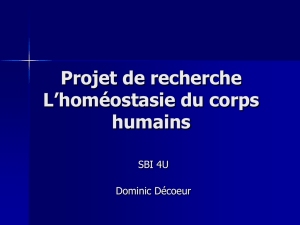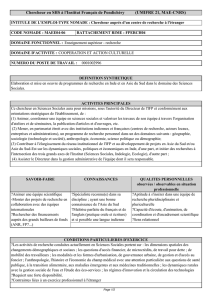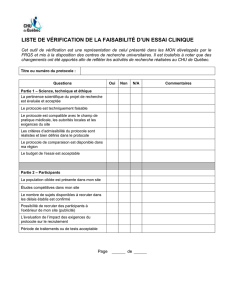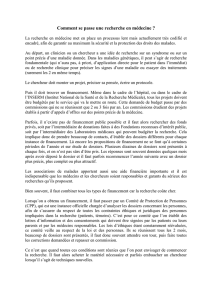INVENTER ou ESTIMER la puissance statistique

TutorialsinQuantitativeMethodsforPsychology
2007,Vol.3(2),p.35‐42.
Inventerouestimerlapuissancestatistique?
Quelquesconsidérationsutilespourlechercheur
LouisLaurencelle
UniversitéduQuébecàTrois‐Rivières
Lapuissancestatistiqueestunconceptdontladéfinitionmathématiqueetl’utilisation
parleschercheurssoulèventencoredesdifficultés.Nousrevisitonsdifférentsaspects
duproblèmedanscetarticlepolémiqueetformulonsenfinquatrepropositions
argumentéesdanslebutd’éclairerlechercheur:1.Lerecoursàunevaleurd’effet
prescrite,selonunargumentcliniqueoudeportéepratique,produituneestimationde
puissancedélibérémentfausse,etquicontrevientdecefaitauxraisonsdéontologiques
surlesquellesilrepose.2.Ilestillusoireetpeutêtremensongerdecalculerune
puissancequin’estpasbaséesurdesdonnéesdudomainederecherche.3.Le
chercheurquipossèdedel’informationnumériquepréalablesursonprojetpeuts’en
servirutilementpourenestimerlapuissance.4.Lecalculdelapuissanced’untest
d’hypothèsesbidirectionnelnedoitpasinclurelacontrepartiedeprobabilité.
Themathematicaldefinitionandpracticaluseofstatisticalpowerbyresearchersraise
logicalaswellascomputationaldifficulties.Inthispolemicalpaper,werevisitsome
aspectsoftheproblemandformulatefourbackeduppropositionsintendedforthe
user:1.Useofaprescribedeffectsize,onthebasisofitsclinicalorpractical
significance,entailsadeliberatelyfalseestimationofpower,whichcontravenesalso
withitsdeontologicaljustification.2.Itisillusoryandmaybedeceitfultocalculateand
topropoundapowervaluethatisnotgroundeduponrelevantdataintheresearch
area.3.Iftheresearcherhaspreviousnumericalinformationpertainingtohisresearch
venture,hemayusefullyapplyitforestimatingtheanticipatedstatisticalpower.4.It
isabsurdtoincorporatethealternate‐tailprobabilitywhencomputingthepowerofa
two‐tailedtest.
Lechercheurquiplanifieuneexpérimentationprochaine
sevoitsouventconfrontéaubesoind’évaluerlapuissance
statistiqueassociéeàsonprojetou,équivalemment,de
déterminerlenombredesujetsqu’illuifaudrarecruterpour
atteindreunepuissancesuffisante.Ilesteneffetpeu
rentablepourlechercheurd’entreprendreuntravailde
recherchedontlapuissance,c.‐à‐d.laprobabilitéd’obtenir
unrésultatsignificatif,seraitd’embléeinsuffisante,sans
parlerdesenjeuxdéontologiquesquiendécoulent.Ce
besoind’évaluerlapuissanceestaussiuneobligation
qu’imposentplusieursorganismesbailleursdefonds,etla
justificationdonnée,uneconditiond’attributionbudgétaire.
Besoinouobligation,laquestiondepuissanceconstitueun
pivotpourtouteentreprisederecherche:quellequesoitla
valeurdel’hypothèsederechercheoulaqualitédu
protocolemisenoeuvre,letravailneserapasfructueuxsila
puissancen’yestpas.
Danscetarticle,enpartiepolémique,nousrappelons
d’abordlesdéfinitionsetquelquesélémentsdenotation
mathématiqueliésàlapuissancestatistique.Nous
présentonsensuitequatreargumentstraitantchacund’un
aspectdistinctducalculdepuissance,desargumentsde
controversequiheurtentcertainesconceptionsetpratiques
courantesenrechercheetdontnoustenteronsd’établirle
bien‐fondé.
35

36
Définitionsetnotation
Laquestiondepuissanceestétroitementliéeàla
pratiquedestestsd’hypothèsesstatistiques,unepratique
dontlecadreconceptuelanaguèreétécampéparJ.Neyman
etE.S.Pearson(voirKendalletStuart,1979):ils’agitdes
procéduresdecalculgrâceauxquelleslechercheurpeut
décideretaffirmerquelesdifférencesobservéesdansses
donnéesexpérimentalessontsignificativesounon.
Schématiquement,cecadreconceptuelinclut:
l’hypothèsenulle,symboliséeparH0,etqui,enignorant
leseffetsexpérimentauxpossibles,exprimelavaleur
attenduedesrésultatssousleseuleffetduhasard;
lacontre‐hypothèse(ouhypothèsederecherche,ou
hypothèsealternative),symboliséeparH1,parlaquellele
chercheurindiquecommentleseffetsexpérimentauxse
manifesterontdanslesrésultatsoucommentl’hypothèse
nulleseracontredite;
larèglederejet,quimetenjeuunestatistique(p.ex.un
t,unχ2,unz,unF),unseuildeprobabilitésymboliséparα
etune(oudeux)valeur(s)critique(s),délimitantleszones
d’acceptationetderejetdeH0.
Prenonsl’exemplesuivantpourconcrétisercesnotions.
Unchercheurveutdéterminersil’ajoutd’unsupplément
vitaminiqueàladiètedesourisdelaboratoirepeut
augmenterleurniveaud’activité.Pourcela,ilutilise20
souris,qu’ilpartageauhasardendeuxgroupesde=10
sourischacun,ladiètedugroupeExpérimentalétant
enrichiedurantunesemaineavantlaprisedemesure,au
contrairedugroupeTémoin.Lessourissontplacéesdans
uneroued’activitédurantuneheure:lenombredetours
comptésconstituelavariabledépendante.Lechercheur
anticipedesrésultatsplusélevésdanslegroupe
Expérimental.
Nouspouvonsdoncécrire,symboliquement:
H0:μE=μT(ouμE–μT=0)
H1:μE>μT(ouμE–μT>0)(1)
RejetdeH0auprofitdeH1siTE XX −
Laprocéduredetest,aveclaformuledecalculindiquéepar
t≥t18[0,95]=1,734.
TE XX −etsesconditionsdenormalité,additivitédeseffetset
égalitédesvariances,estréputéerespectée.
t
Lechercheurdenotreexempleobtiendra‐t‐ilunrésultat
significatif,c.‐à‐d.desdonnéesquiaboutirontàuntplus
élevéque1,734?Enfait,ilestimpossiblederépondreàcette
questionaveccertitude,maisilarrivequ’onpuisseen
concocteruneprédiction:c’estlecalculdepuissance.En
voicilesgrandeslignesthéoriques.
Soitl’hypothèsenulle(H0)estvraie.Danscecas,les
niveauxdeperformanceréelsdesdeuxpopulations
(ExpérimentaleetTémoin)sontégaux,i.e.μE=μT,etla
probabilitéderejeterparerreurH0estégaleauseuilde
signification,iciα=0,05.
Soitl’hypothèsenulle(H0)estfausse.Danscecas,sous
H1,leniveaudeperformanceréeldelapopulation
expérimentale(μE)aunevaleurspécifique1,quiestplus
grandequecelledesTémoins(μT),avecunedifférence,ou
effet,dénotéeθ=μE–μT>0.LaprobabilitéderejeterH0est
évidemmentaugmentée:elledépendenfaitdequatre
paramètresclés:ladifférenceréelle(θ)entreles
populations,lavariabilitéintra‐population(mesuréepar
l’écart‐typeσ),latailleéchantillonnale()etleseuilde
probabilitéα.C’estcetteprobabilitéqu’onappellepuissance
statistique.Envoiciladéfinitiontechniqueusuelle:
(Définitionusuelledepuissancestatistique)(2)
Lapuissancestatistiqued’untestd’hypothèsesestla
probabilitéqu’ilrejetteH0lorsqueH0estfausse.
Mathématiquement,pournotreexemple,onpeuten
représenterlecalculparl’expression:
Pu=Pr{
TE XX −
t≥t2n–2[1–α]|θ,σ,,α}(3)
Silesvaleursdesquatreparamètresmentionnés(θ,σ,,α)
étaientconnues,c.‐à‐d.connuesduchercheur,ilpourrait
effectuerlecalculdepuissanceenseservantdel’undes
nombreuxoutilsmisàsadispositionàcettefin.L’obtention
d’unepuissance(Pu)de0,50luiindiqueraitque,dansson
expérience,ilaunechancesurdeuxd’obtenirlaconclusion
significativequ’ilsouhaite.AvecPu=0,90,ilseraitpresque
sûrd’yparveniralorsque,avecPu=0,10,c’estpresquedu
tempsetdel’argentperduspourluiquedepersévérer.Qui
plusest,lavaleurdel’effet(θ)luiétantconnue,àquoilui
serviraitderéaliserl’expérienceoudefairelecalcul,
puisqu’ilenconnaîtraitdéjàlerésultatultime?
Enfait,pourlaplupartdeschercheursetdansleplupart
descas,seullefacteur«seuildesignificationα»estconnu
ouestprédéterminédansunerecherche,etlaquestiondu
calculestimatifdelapuissanceresteouverte.
Nousproposonsaulecteurd’examineravecnous
différentsaspectsdecettequestion,unequestiond’ailleurs
peuoupasdébattuedanslesgrandstraitésdestatistique.
Surlabasedecetexamen,nousseronsàmêmedeformuler
quatreconclusionsprincipales,desconclusionsenpartie
polémiquesparcequ’ellesquestionnentlesconceptionset
pratiquescourantesdesstatisticiensappliquésetdes
1Techniquement,l’hypothèsederecherchepeutêtresimple
(p.ex.μE=μT+4)oucomposée(p.ex.μE>μT),lepremiercas
aboutissantaucalculd’unepuissanceponctuelle,lesecondà
celuid’unecourbedepuissance.Pourlechercheur,
cependant,sonhypothèseestintrinsèquementsimple(ence
sensoùlagrandeurd’effetescomptéeestuneconstante
plutôtqu’unintervalle),maisilestordinairementincapable
despécifierlavaleurattenduedesonrésultatexpérimental,
d’oùunecertaineambiguïtédansnosformulations.

37
chercheurs.Maisvoyonsd’abordlestroiscontextes
d’informationdanslesquelsseprésenteleproblèmedu
calculdepuissanceetdeladéterminationdelataille
échantillonnale.
Contextesetenjeuxducalculdepuissance
C’estàjustetitrequelesorganismespublicsouprivés
quifinancentlarecherchesesoucientdesaproductivitéet
deseschancesdesuccès:pourquoi,eneffet,accorderun
importantsubsidepouruneentreprisedontlaprobabilitéde
conclure,c’est‐à‐direlapuissance,esttropfaible?C’estla
raisonpourlaquelleplusieursorganismessubventionnaires
exigentd’entréedejeu,danslademandedesubvention,un
calculdepuissanceetunejustificationdu,lataille
d’échantillonproposée.C’estpourquoiaussicertains
auteursontdéveloppéuneméthodologiedétailléepour
aiderleschercheursàmeneràbiencecalcul:Cohen,avec
sonouvrage«Statisticalpoweranalysisforthebehavioral
sciences»(1988),estsansdouteleplusconnu.D’autres
auteurssesontcantonnésdansl’autrevoletdececalcul,soit
ladéterminationdunombredesujetspouratteindreune
puissancedonnée:voirparexempleDesuetRaghavaro
(1990)etKraemeretThiemann(1987).Laméthodologie
applicablesupposequel’onconnaisselesvaleursréellesdes
facteursθ,σ,etαmentionnés,notammentl’effetθet
l’indicedevariabilitéσ,telsqu’ilsserapportentàla
rechercheenvisagée.Queprévoitdonccette«méthodologie
»pourlechercheur?DesuetRaghavarao(1990),àl’instar
desauteursclassiquesenstatistique(p.ex.Guenther,1965;
HoggetCraig,1978;KendalletStuart,1979),posentcomme
connuslesfacteursθetσ(avecα)et,àpartirdelà,ils
procèdentàladéterminationdelataillenécessairepour
atteindreunepuissancedonnée.Toutsepassecommesiles
auteursvoulaientfaireunedémonstrationducalculde
puissanceetdesonutilitédansuncontexteidéal,enfaisant
abstractionducontextedanslequellechercheursetrouve
réellement.Oùdonclechercheurtrouvera‐t‐illesvaleurs
d’effet(θ)etdevariabilité(σ)dontilabesoin?
Danslaplupartdescas,notammentenrecherche
expérimentale,c’estpourlapremièrefoisquelechercheur
abordeuneproblématiqueparticulière,ouqu’ill’abordede
cettefaçonparticulière,avecsonhypothèseetsontypede
mesure:rienn’existeàl’horizonquipuissel’informersurθ
ouσ.Dansd’autrescas,cependant,lechercheurreprend
uneproblématiquedéjàexplorée,planifieunenouvelle
étudesurlamêmequestion,etilpeutdisposeralorsd’une
informationsérieusesurlesparamètresmentionnés.Par
exemple,ilapuréaliserunepremièrefoisl’expérimentation
suggéréeplushautsurl’effetd’unsupplémentvitaminique,
etobtenir,disons,untestt=1,200,nonsignificatif(parce
qu’inférieurà1,734),àpartirdedeuxgroupesde=10
souris.Mêmes’ilestnonsignificatif,cerésultatl’informe
néanmoinssurl’effetθ,parladifférenceempiriqueET
X‐X
observéeaunumérateurdutestt,etaussisurlavariabilité
σ,parunepartiedesondénominateur,22
ET
(s s )/2+.Enfin,
ilexisteaussiunedernièrecatégoriedecas,ceuxdesessais
cliniques(EAEMP,1998)etdesapplicationsindustrielles,
pourlesquelslavaleurdel’effetθestobtenuepar
prescription:cettevaleur,notéeθ
~
,estlavaleurminimale
exigible,endeçàdelaquellel’impactdel’effetθdansle
monderéel(biologique,physique,industriel)n’existepas,et
c’estcettevaleurquivaservirpourcalculerlapuissanceou,
équivalemment,latailleéchantillonnalerequise.
L’utilisationd’unevaleurd’effetprescrite
Lenth(2001;voiraussiEAEMP,1998)revoitendétailla
procédureparlaquelleunevaleurdeθpeutêtreprescrite
(= θ
~
),enconsidérantd’unepartlesenjeuxpratiquesen
causedanslephénomèneétudiéetd’autrepartlesbesoins
del’évaluationstatistiquedepuissance.Dansuncontexte
biochimique,parexemple,ilsepeutqu’uneaugmentation
d’unmédiateurendocriniendel’ordredeθ<2mmolsoit
insuffisantepourdéclencherlaréactionmétaboliquevisée,
alorsqu’uneffetplusgrand,soitθ≥2mmol,yparviendrait.
Lecalculdepuissancepeutalorstablersurlaquantitéseuil
θ
~
=2mmol;pourunepuissanceprédéterminée,le
chercheurpourrafixerlatailleminimale( )exigiblequilui
correspond.
n
~
Notonsbienquelavaleurprescrite θ
~
nepermetpas
d’établirlapuissanceréelledel’expérienceàfaire:ellefait
voirlapuissanceminimalequecetteexpérienceauraitsi
l’effetréelθrejoignaitouexcédaitlavaleurprescrite.
Supposonsmaintenantquel’effetréelexistemaisqu’ilest
moinsgrandquel’effetminimalsuffisant,soit0<θ<.
L’estimationdelatailleéchantillonnale,calculée
d’après
θ
θ
~
pourunepuissancedonnée,vafournirunevaleur
detaillen
~
moindrequecellequ’onauraitdûprendrepour
faireapparaîtrel’effetréelθ;lapuissanceeffective(sousla
vraievaleurθ)seramoindrequecelleanticipéeet
l’expérienceréaliséerisqued’êtredécevante,non
concluante.
L’utilisationd’unevaleurd’effetprescrite(θ)créedonc
unparadoxe.D’unepart,lesauteurscitésplaidentenfaveur
d’untelprocédésurlabased’unargumentréaliste(«Ilest
futiled’obtenirunrésultatstatistiquementsignificatifqui
n’apasd’impactréel,enpratique»)etd’unargument
déontologique(«Ilestinconvenantd’employerdessujets
humainsouanimauxdansunerecherchequin’apas
d’impactréel»)alorsque,d’autrepart,lerecoursàune
puissancesurestimée(sil’effetréelθestmoindrequel’effet
prescrit)rendtoutel’expérimentationinfructueuse.D’un
autrecôté,sil’effetréel(θ)serévélaitêtresupérieuràla
valeurminimalestipulée(θ),latailleéchantillonnale
appliquée(n)seraitexcessive(avecunepuissanceplus
θ

38
grandequecelleprédéterminée),etl’argument
déontologique(soitl’utilisationd’unnombreexagéréde
sujets)s’appliqueraitencore.Enfait,ilnoussemblequec’est
parerreurqueleconceptd’effetminimal,notéiciθ
~
,aété
importédansledomainedel’évaluationdelapuissance
statistique,alorsqu’ilprovenaitd’unautredomaine,celui
delagrandeurd’effet,etd’unautredébat,celuidela
différenceexpérimentalementsignificativeplutôtque
statistiquementsignificative(Klerges1982,Davidson1994,
Weber1994,RutledgeetLoh2004).HoenigetHeise(2001)
contestentd’ailleurscetteimportationetre‐justifientle
conceptd’effet(oudifférence)cliniquementsignificatif,dans
lecontextecettefoisdelaméthodedesintervallesde
confiance.
Enconséquence,nousformulonsainsinotreproposition
1:«Lerecoursàunevaleurd’effetprescrite,selonun
argumentcliniqueoudeportéepratique,produitune
estimationdepuissancedélibérémentfausse,etqui
contrevientdecefaitauxraisonsdéontologiquessur
lesquellesilrepose.»
L’inventionpureetsimpled’unegrandeurd’effet
Quandlechercheurabordepourlapremièrefoisune
problématique,commeilarrivesouventenrecherche
expérimentale,lecomportementdesesmesures(sa
«variabledépendante»)neluiestpasconnu,nonplusque
lagrandeurd’effetescomptéeàpartirdesconditions
d’expérienceimposées(sa«variableindépendante»):iln’a
doncaucuneconnaissancepréalablenidel’effetθ,nidela
variabilitéintrinsèqueσ.Peut‐iltoutdemêmeestimerla
puissance?
Lesorganismesbailleursdefonds,auQuébecetau
CanadacommeauxÉtats‐Unis,exigentdetouslescandidats
quisoumettentunprojetpoursubventionuneestimationde
puissanceetlajustificationdelatailleéchantillonnale()
proposée.Or,nonobstantl’ignorancedeθetσ,Cohen
(1988),avecd’autresquis’eninspirent(p.ex.Kraemeret
Thiemann1987),croientqu’unetelleestimationestpossible
etilsseportentausecoursduchercheurenmalderéponse.
Pourlecontextestatistiqueévoquéparnotreexemple,soitla
comparaisondutauxd’activitéchezdeuxgroupesdesouris,
lessourisdugroupeexpérimentalrecevantunsupplément
vitaminique,Cohenproposeunindiced’écartstandardiséd,
définipar:
d=ET
μμ θ
σσ
−=;
telqu’indiqué,lesingrédientsdelaformulesontles
constantesdepopulation(μE,μT,σ)plutôtquedes
estimationsstatistiquesbaséessurl’expérimentation.Cohen
élaborel’interprétationdesonindiceddedifférenteset
intéressantesmanières.Ainsi,quandd=0(uneffetnul),il
imaginequelesdistributions(normales)desdeux
populationscomparéesserecoupentcomplètementalors
que,pourunécartégalàd=0,50,environ60%dela
populationsupérieure(i.e.expérimentale)dépasse60%de
l’autrepopulation(i.e.témoin).Deplus,puisquel’indiced
standardisel’effet(ouécart)θenledivisantparσ,son
impactsurlapuissanceestdirect,cequipermetàCohende
présenterdestablesdepuissancebaséesd’unepartsur
l’indicedetd’autrepartsur.
L’approchedeCohen(1988),toutepédagogiquequ’elle
soit,n’aconsistéjusqu’àprésentqu’àremplacerdeux
paramètres,θetσ,parunindiceunique,d=θ/σ,basé
encoresurlesvaleursréellesdeθetσ,etdontlavaleurreste
àtrouver(Lenth2001).Pour«faciliter»laréflexiondu
chercheur,quisecroitobligédecalculerlapuissance,eten
raisondulienétroitentrel’indicestandardisédetla
puissance,Cohen(p.24‐27)metdel’avantlescatégories
verbalessuivantes,soitquelechercheurcroitavoiraffaireà
uneffet«petit»avecd=0,20,«moyen»avecd=0,50,ou
«grand»avecd=0,80.QueproposealorsCohen(1988)?Il
proposed’inventerpurementetsimplementd,àpartird’un
«raisonnement»métaphorique,quinousaparusaugrenu.
Envoicideuxexemples.
«Unepsychologueexpérimentaleplanifieune
expérienceafindemesurerl’impactquepeutavoirpourdes
ratsl’opportunitéd’explorersansrécompenseunlabyrinthe
surl’apprentissageultérieurdecelabyrinthe.Des
échantillonsde30animauxchacunsontformésetassignés
augroupeexpérimental(E),quibénéficied’unephase
exploratoire,etaugroupetémoin(T),sanschance
d’exploration.Lesratssontensuitetestés,lenombred’essais
requispourdeuxparcoursconsécutifsparfaitsconstituantla
variableretenue.L’hypothèseH0(non‐directionnelle)est:
|μE–μT|=0.Lachercheuseprévoitquel’effetseratelque
lesmeilleurs60%d’unepopulationdépasserontles60%
moinsbonsdel’autre,soitl’indiceU2≈60%.Référantàla
table2.2.1(enp.22),elletrouvequeU2=59,9%équivautà
uneffetmoyen,d=0,50.Donc,l’hypothèsederecherche
(H1)spécifiequelesmoyennesdesdeuxpopulations
s’écartentd’undemiécart‐type(ouθ=½σ)l’unedel’autre...
D’où,pouruntestbilatéralauseuilα=0,05(avec=30
sujetspargroupe),...lapuissanceégale0,47.»[Cohen1998,
pp.40‐41;lescaractèresgrassontdenous.]
«Unchercheurenpsychiatrie,intéresséàcertains
facteursendocriniensimpliquésdanslaschizophrénie,fait
uneexpériencepourcomparerleséchantillonsd’urinede
500schizophrènesetde500normauxéquivalents,y
mesurantunproduitmétaboliqueconnupoursedistribuer
àpeuprèsnormalementetavecvariabilitéconstantedansla
population.Étantdonnéquelefacteurendocrinien
soupçonnén’estqu’indirectementliéauproduit
métaboliquedansl’urineetpeut‐êtrepourd’autres
raisons,lechercheurn’espèrequ’unpetiteffet,

39
spécifiquementd=0,20....Enconséquence,pourd=0,20et
=500(pargroupe),Pu=0,72.»[Cohen1988,pp.41‐42;les
caractèresgrassontdenous.]
A‐t‐ondéjàvuunchercheurquipuisseaffirmerque60%
dessujetsexpérimentauxaurontdesrésultatsdébordant
ceuxde60%dessujetstémoins,voireunchercheurqui
réfléchisseàsonexpérienceencestermes?Quantàla
secondecitation,le«petiteffet»escomptéenditsansdoute
pluslongsurlaprudenceoulacirconspectionduchercheur
quesurl’effetréelprésent,uneffet(θ),voireuneffet
standardisé(d)dontniunchercheurnil’autreneconnaîtla
valeur.
Enrésumé,hormislecasd’unegrandeurd’effetprescrite
(surlabasedelasignificationcliniqueoudesaportée
pratique)discutéplushaut,lesauteursrecenséstraitentde
puissanceentermesdeparamètresdepopulation,
notammentθetσ(oud)etleursvraiesvaleurs.Or,dansle
butévidentdedépannerlechercheurqui,souvent,n’apas
d’idéeprécisesurlesgrandeursnumériquesàespérerdans
sonprojetexpérimental,Cohen(1988)suggèredebaserle
calculsuruneffetimaginaire,catégoriséverbalement(petit,
moyen,grand),c’est‐à‐diresurl’appréhensionquele
chercheuradesesrésultatsfuturs.Unefoisl’effet«verbo‐
numérique»(d)ainsifixé,leresteestaffairedecalcul,qui
aboutit,commenousvenonsdeledémontrer,àunevaleur
totalementfictivedepuissance.
D’oùnotreproposition2:« Ilestillusoireetpeutêtre
mensongerdecalculerunepuissancequin’estpasbaséesur
desdonnéesdudomainederecherche».
L’estimationdepuissanceàpartirdedonnées
expérimentales
Ilarrivetoutdemêmeque,dansunprojetdonné,un
chercheurreprenneuneproblématiqueouunepartie
d’expérimentationquiadéjàétéexploréeetquiaproduit
desdonnéesempiriquescrédibles.C’estnotammentlecas
des«confirmatorytrials»enrecherchemédicale,pour
lesquelsl’AgenceEuropéennepourl’Évaluationdes
Médicamentsindique:«assumptionsshouldnormallybe
basedonpublisheddataorontheresultsofearliertrials»
(EAEMP,1998,p.19).Hélas,etsoulignons‐le,la
documentationrecenséenefaitpasétatdel’exploitation
possibledetelsrésultatsempiriquespourestimerla
puissance.Seul,leclassiqueGuilford(1965)yvad’une
suggestion,enproposantd’estimerlataille(pargroupe)
nécessairepourrendreletestobtenutoutjustesignificatif,c’est‐
à‐direpourqueletestégaletoutjustelavaleurcritique.
Notreexemplecomportaitaudépartdeuxgroupeségaux,
avec=10sujetschacunett=1,200.Enmanipulant,nous
aurionsàrésoudre:
ET
22
ET
XX
ss2
−
+⎛⎞
obtenantéventuellement≥20,cequisuggèreicide
doublerlatailledechaquegroupe.Évidemment,letest
incluantles10sujetssupplémentairespargroupene
deviendrapeut‐êtresignificatifquesilestendances
observéessurlespremierssujetssemaintiennent.Kendallet
Stuart(1979),dansunautrecontexte,mentionnentqu’une
telleégalisationdutestsursavaleurcritique(àpartir,cette
fois,desvaleursthéoriquesdeθetσ)correspondàune
puissance(Pu)de0,50:nousrevenonsplusloinsurcette
«correspondancemédiane»entrepuissanceetparamètreθ
(ouδ).Est‐ilpossibled’allerplusloinetdeproposerune
méthodologiecomplètedel’estimationempiriquede
puissanceàpartirdedonnéesexpérimentales?
Nousrépondonsparl’affirmativeàlaquestionposéeci‐
dessus.Nefait‐onpasdemêmelorsque,àpartird’unpetit
échantillondedonnées,onbâtitunintervalledeconfiance
pourunestatistiqued’intérêt,oulorsqu’onexploitela
statistiqueobtenuedansl’échantillon(p.ex.X,s2,r)comme
uneestimationdelavaleurparamétriquecorrespondante(p.
ex.μ,σ2,ρ)?C’estprécisémentàcebutqueserventles
donnéesstatistiques:estimerlesparamètresdela
populationétudiée.
Danslecasdelapuissance,l’extrapolationd’information
àpartirdesdonnéespréalablesrequiertlestroisétapesque
voici:1)obtenir(réunir)desdonnéesnumériques
préalables;2)estimerleoulesparamètresdepopulation
appropriés;3)exploiterlesestimationsfaitespoureffectuer
uneprojectiondepuissance.Mêmes’ilestrigoureusement
conçuetappliqué,ceprocessuscomportedel’incertitude.
L’incertitude,c’est‐à‐direlavariabilitéstatistiquedansce
processus,tientessentiellementauxdonnéesdel’étape1,
particulièrementàlatailled’échantillonutilisée:plus
nombreuxseral’échantillon,plussûresserontles
estimationsetlesprojectionsétabliessursabase.
L’incertitudedansl’échantillonserépercutedirectement
dansl’estimation,àl’étape2;elleengendreunemarge
d’imprécisioncalculableautourdelavaleurestimée.C’estla
mêmeincertitudequitransitedesétapes2à3,sansplus:
rienn’yestajouté,desorteque,àincertitudeégale,lestrois
étapesducalculdepuissancesontaussivalablesetniplus
nimoinssûresquel’estimationd’unemoyenneou
l’établissementd’unintervalledeconfiance.
Logiquementdonc,ilestpossibled’estimerlapuissance
àpartirdedonnéespréalables.Or,nousl’avonsdéjàdit,la
documentationrecenséenerapporteaucuneméthodepour
instrumentercetteestimation.Dansunerechercherécente
(Laurencelle,2005),nousnoussommespenchésérieusement
surcettequestion,enconsidérantleproblèmed’estimation
sousl’angled’uncalculdepuissance.Cetterecherche
s’appuyaitsurunelogiqued’estimationenquelquesétapes,
dontvoiciladescriptionsommaire:
2n
⎜⎟
⎝⎠
≥t2n–2[0.95],1)Danslecadred’unesituationderechercheetd’untest
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%