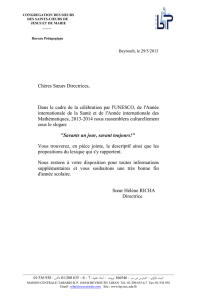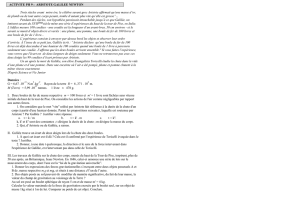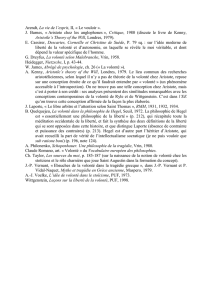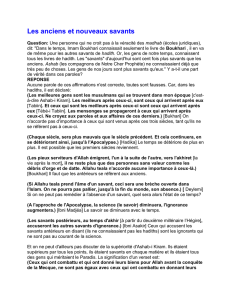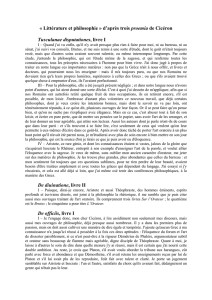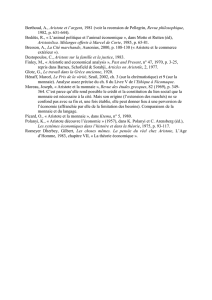CM D. Foucault

CAPES Agrégation – Cours du 12/12/2016 – Didier Foucault - Ancienne pensée scientifique et nouvel esprit scientifique (XVe-XVIIIe siècles)
1
Ancienne pensée scientifique et nouvel esprit scientifique
(XVe-XVIIIe siècles)
[J’ai noté entre parenthèses des mots et expressions qu’il convient de bien assimiler et de savoir réutiliser dans
un devoir ou un oral]
Dans le programme qui vous a été annoncé et qui a été élaboré au début de l’été, j’avais
proposé comme titre de cette leçon : « Pensée préscientifique et nouvel esprit scientifique ». A la
réflexion, j’ai trouvé plus juste de changer la première partie de ce titre en remplaçant « pensée
préscientifique » par « ancienne pensée scientifique ». En effet, l’expression « préscientifique » ne
me semble pas appropriée parce qu’elle est avant tout entachée d’anachronisme. Comme si la
« Science » dans toute sa vérité, serait sortie de l’obscurantisme préscientifique au XVIIe siècle.
Certes, la science moderne est née à ce moment-là ; c’est encore dans ses grandes lignes qu’elle se
définit de nos jours ; ce n’est pas une idée que je récuse et mon exposé va s’attacher à le montrer.
Mais, avant ce moment décisif, ce qu’il convient d’appeler la science ancienne, qui reposait certes
sur d’autres paradigmes – principes et méthodes de pensée – présentait une conception du
monde basée sur la raison et qui était relativement cohérente.
J’ai ainsi retenu trois thèmes à partir d’une idée-force : il y a eu, autour du second tiers du
XVIIe siècle, une profonde mutation de la manière de penser la science et de faite de la science.
Qu’on l’appelle « révolution scientifique », selon une expression souvent utilisée, « changement de
paradigme » en suivant Thomas Khun ou même « discontinuité dans l’épistémé » pour reprendre
une formule proposée par Michel Foucault… qu’on nuance ou discute tel ou tel point des
théories que cela a entraînées, il est difficile de nier, qu’à l’échelle du continent européen, et plus
particulièrement au cœur d’un espace qui va de l’Italie à l’Angleterre en englobant la France et les
Pays-Bas, bien des choses ont changé dans l’univers et les pratiques des savants qui s’intéressent
aux sciences entre 1600 et 1700.
Ces trois thèmes sont : Science, pensée rationnelle et religion ; les Modernes contre les
Anciens, science et expérience
1) Science, pensée rationnelle et religion
- La science comme explication rationnelle du réel
Si l’on prend ces deux points – l’activité rationnelle d’une part, et la recherche d’une
compréhension globale et cohérente du réel d’autre part – comme le socle sur lequel s’édifie toute
pensée méritant d’être qualifiée de scientifique – alors, oui, avant le XVIIe siècle, il existait une
forme de science. Pour être plus précis, c’est pour l’essentiel, et somme toute avec peu
d’évolutions majeures, la science que les Grecs ont élaborée autour des Ve et IVe siècles avant
notre ère, qui était au fondement de celle qu’étudiaient et pratiquaient les savants encore vers
1600.
Pour aborder l’étude des sciences à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, il faut en
premier lieu se demander quel sens avait alors ce mot. Cette précaution est essentielle car, en
plusieurs siècles, bien des choses ont changé… En n’oubliant pas que le latin demeure la langue
savante par excellence jusqu’au XVIIe siècle et, qu’en conséquence, peu de traités scientifiques
sont alors écrits en français ou dans une autre langue vernaculaire de l’Europe.
« Science » est une francisation ancienne du latin scientia. Les deux mots concernent très
généralement la connaissance, avec des emplois qui englobent différents domaines du savoir :
théorique, scientifique et même technique et religieux. Ils dérivent du verbe scio/scire, « savoir ». À
l’époque médiévale, sciens/scientis, le participe présent du verbe latin, adjectivé dans le sens de « qui

CAPES Agrégation – Cours du 12/12/2016 – Didier Foucault - Ancienne pensée scientifique et nouvel esprit scientifique (XVe-XVIIIe siècles)
2
sait, instruit, habile », avait « scient » pour équivalent en français ; alors que scientificus donnait
« scientifique », adjectif qu’il fallait entendre plutôt dans le sens actuel et vague de « savant » que
dans celui, plus restrictif aujourd’hui, de « scientifique ». Si les hellénistes connaissaient έπιστήμη
(épistêmê), l’équivalent grec de scientia, il est inutile de rechercher dans le lexique des langues
parlées des mots qui en dérivent. « Épistémologie », que le français emprunte à l’anglais, n’est
attestée qu’en 1907 ; quant à « épistémé », c’est Michel Foucault qui en fait le premier usage dans
Les Mots et les choses en 1965. Accordons cependant un statut d’exception à Rabelais, qui baptise un
compagnon de Pantagruel du nom d’Épistémon : un savant qui – au propre mais aussi au figuré –
perd la tête, tranchée lors d’un combat contre les Géants.
Une autre discipline avait également vocation à couvrir le vaste domaine du savoir
rationnel : la « philosophie ». Le mot provient du grec φιλοσοφία et de sa transcription latine
philosophia. Il signifie « amour du savoir et de la sagesse ». Au Moyen Âge, comme dans
l’Antiquité, la philosophie se subdivise en plusieurs branches. La « philosophie première » ou
« métaphysique » s’intéresse aux grandes catégories de la pensée. Elle entretient – non sans
difficultés – une relation étroite avec la « théologie », que – de manière quelque peu provocatrice
– l’on pourrait définir comme « la science de Dieu » (une nouvelle science, donc ?). La
philosophie « morale », elle, s’intéresse à l’éthique et à la recherche de la sagesse. Toutefois, sans
négliger ces deux versants essentiels de l’activité philosophique, l’historien des sciences
s’intéressera plus particulièrement à un troisième, celui qui lui vaut d’être qualifiée de « naturelle ».
Cette partie de la philosophie prend la « nature » comme objet de connaissance : une »physique »,
par conséquent, puisqu’en grec φυσικός (phusikós, d’où dérive le latin physica) est l’étude de la
« nature ».
Science et philosophie, si l’on suit ces acceptions, apparaissent ainsi comme deux modes
d’accès à la connaissance qui s’appuient sur la raison. En ce sens l’activité scientifique se distingue
d’un autre mode d’accès à la connaissance : la religion, qui repose sur des mystères inaccessibles à
la raison.
- Religion et science, foi et raison seraient-elles incompatibles ?
Rappelons qu’en se situant dans l’univers mental de la fin Moyen Âge et du début de
l’Epoque Moderne, le christianisme se définit comme une idéologie « dogmatique » fondée sur
des « mystères » :
- Dogmatique : en ce sens que les vérités sur lesquelles repose la religion ne peuvent être
discutées et à plus forte raison contestées, que ce soit par la raison ou par l’expérience.
- Reposant sur des mystères : seule la foi permet d’atteindre la vérité suprême de la
révélation contenue dans le message du Christ (l’Evangile/ la Bonne Nouvelle). Cela veut dire
que cette vérité est inaccessible à la raison humaine, notamment lorsque ce qu’elle enseigne
contredit l’enseignement de l’Eglise.
Ce dilemme agite la pensée chrétienne depuis l’Antiquité. Il a été souvent à l’origine de vifs
débats entre savants chrétiens. Comment se pose-t-il à la veille de la révolution scientifique ? En
fait, la conception dominante est celle d’un compromis entre foi et raison ; ce que l’on peut
appeler un « rationalisme chrétien », qui trouve dans le « thomisme » son plein aboutissement. Un
bref retour en arrière est nécessaire.
A la fin de l’Antiquité de grands débats eurent lieu entre les Pères de l’Eglise. On peut les
résumer ainsi : Est-ce que les chrétiens ont besoin de la science, puisque par leur foi ils ont accès
à la révélation divine, alors que la raison est impuissante à leur donner l’évidence de cette vérité
qui transcende tous les autres modes de connaissance ? Cette question apparaissait d’autant plus

CAPES Agrégation – Cours du 12/12/2016 – Didier Foucault - Ancienne pensée scientifique et nouvel esprit scientifique (XVe-XVIIIe siècles)
3
pertinente que la philosophie et les sciences étaient des inventions « païennes », antérieures au
christianisme.
Deux théologiens de la fin de l’Antiquité, originaires d’Afrique du Nord, sont les principaux
représentants des deux tendances qui se sont affrontées :
- Tertullien (vers 150-220) a une position antiintellectuelle : il récuse tout intérêt de la
philosophie et de la science pour un chrétien.
- Augustin d’Hippone (354-430) considère au contraire que par la raison et la science les
hommes connaissent la Création et que, par ce biais, ils se rapprochent du Créateur. Les savants
païens ne sont donc pas à rejeter. Comme ils étaient doués de raison, ce qui est un don de Dieu,
leur connaissance des sciences naturelles, de l’astronomie, de la médecine et de toutes les sciences
est utile car, en montrant la grandeur et la perfection des œuvres créées par Dieu, elle permet
d’entrevoir quelle est la grandeur et la perfection divine. Elle ne supplante pas la foi ni ne se
substitue à elle mais la conforte.
Dans cette perspective, la science s’inscrit dans une « visée apologétique ». Cela valide
l’activité rationnelle des philosophes et des savants mais cela la balise également : en effet, en
aucune manière, la raison ne peut contredire les dogmes, ne peut s’opposer à l’enseignement de
l’Eglise. Outrepasser ces bornes, ferait du savant un hérétique. Une formule souvent employée au
Moyen Âge et que l’Eglise martèlera contre tous les novateurs de l’époque moderne résume cette
idée : « la philosophie (ce qui englobe, rappelons-le, la science) servante de la théologie ».
- Un compromis médiéval entre foi et religion : le rationalisme thomiste
Ce débat a été réactivé au XIIIe siècle, au temps de Thomas d’Aquin. Le contexte
intellectuel est marqué par la création des universités et d’intenses débats soulevés par la
découverte et la traduction de manuscrits inconnus auparavant en Occident chrétien. Il s’agit des
œuvres d’Aristote (sa métaphysique mais aussi ses œuvres scientifiques sur la physique,
l’astronomie, la météorologie, la zoologie), des grands traités d’astronomie, de médecine, de
mathématique, d’alchimie des savants grecs (Ptolémée, Euclide, Hippocrate, Galien) et Arabes
(Averroès, Avicenne, Al Khwarismi)… Découverte qui se fait auprès des savants musulmans
d’Espagne ou de Sicile. Le même débat qu’à la fin de l’Antiquité ressurgit alors. Il tourne
principalement autour de la philosophie et de l’œuvre d’Aristote, car, par leur ampleur et leur
cohérence, elles permettent de synthétiser tous les champs du savoir de la fin du Moyen Âge.
Certains (les Franciscains en premier lieu) voient dans Aristote un danger pour la foi et
s’opposent vivement à l’engouement des jeunes intellectuels chrétiens pour les penseurs païens et
musulmans. Tout en restant de farouches adversaires d’Aristote, leur position à Paris et surtout
en Angleterre, évolue aux XIVe et XVe siècles. Ce que refusent Nicolas Oresme ou Guillaume
d’Ockham et leurs disciples « nominalistes », c’est d’enfermer la science dans une théorie
globalisante qui n’a rien à voir avec le christianisme. En revanche, ils accordent une place plus
large à une science « empirique » : une science basée sur « l’expérience », qui permet de
comprendre non pas « l’essence » des choses mais, plus modestement, des « phénomènes »
précis : ils s’intéressent par exemple aux mouvements des corps et sont à l’origine d’une approche
mathématique de la dynamique des solides.
D’autres, font une lecture radicale d’Aristote et de son grand commentateur arabe
Averroès, au point d’exalter la supériorité de la philosophie et de la science sur les obscurités de la
religion : on les appelle « averroïstes » ; chassés de Paris au XIVe siècle, beaucoup se réfugieront à
l’université de Padoue, près de Venise, où, en dépit des poursuites de l’Inquisition, ils resteront
très influents jusqu’au XVIIe siècle.

CAPES Agrégation – Cours du 12/12/2016 – Didier Foucault - Ancienne pensée scientifique et nouvel esprit scientifique (XVe-XVIIIe siècles)
4
Enfin Albert le Grand et surtout Thomas d’Aquin tentent une « synthèse entre
l’aristotélisme et la théologie chrétienne ». Vivement combattue du vivant de Thomas, cette
« christianisation d’Aristote », triomphe au XIVe siècle : alors que Thomas est canonisé, son
enseignement devient la base de la formation dans les facultés de théologie jusqu’au XVIIIe siècle.
Parallèlement, dans les facultés des arts, ce sont la philosophie, les traités scientifiques
aristotéliciens et ceux des grands savants grecs (mais aussi arabes) qui servent de socle à
l’enseignement.
Le thomisme repense totalement la théologie chrétienne en intégrant les catégories
philosophiques d’Aristote. Il se donne un caractère rationnel et n’hésite pas à s’appuyer sur des
données admises par la science du temps. Ainsi, dans sa réflexion sur les « preuves de l’existence
de Dieu », Thomas reprend la théorie astronomique du « premier moteur ». Considérant que les
cieux sont animés de mouvements autour de la terre, Aristote pensrait que la sphère ultime du
cosmos, l’orbe des « étoiles fixes », était animée par un « premier moteur » qu’il assimilait à une
divinité. Thomas reprend ce schéma géocentrique qui s’accorde bien avec l’enseignement de la
Bible, pour faire du Dieu des chrétiens le premier moteur ce dernier la première preuve de
l’existence de Dieu.
Aux XIIIe et XIVe siècle, le « rationalisme thomiste » resserre ainsi les liens entre science et
religion, entre aristotélisme et christianisme. Mais un rationalisme qui maintient la science et la
philosophie en position de « servantes de la théologie ».
- Le rôle décisif de Galilée
Dans la tradition réputée averroïste, ce courant minoritaire et réprimé par l’Eglise défend le
primat de la philosophie. Il s’intéresse avant tout à la métaphysique. Il cherche à montrer que sur
certaines questions, comme par exemple l’immortalité de l’âme, Aristote avait une position
opposée à ce dogme du christianisme (Pietro Pomponazzi). Quand ils font appel à la philosophie
naturelle, c’est, par exemple, pour montrer que les miracles de la Bible seraient soit des
manifestations naturelles, soit des stratagèmes d’habiles imposteurs (Jérôme Cardan). En fait ces
critiques ne concernent que de loin la pensée scientifique.
On peut même dire cela du premier procès dont un copernicien est la victime, celui qui
conduit Giordano Bruno sur le bûcher en 1600 à Rome. Ce que l’on reproche à ce philosophe
platonicien (qui n’était pas un astronome), c’est parmi d’autres positions ouvertement hérétiques,
d’avoir soutenu que l’univers était infini ; autrement dit, d’avoir accordé à la création (l’univers)
un attribut (l’infinitude) qui est un attribut exclusif de Dieu.
C’est Galilée qui, le premier, provoque, après ses découvertes astronomiques, non pas un
renversement du rapport science/religion mais une dissociation de ces deux termes. Le texte qui
exprime le mieux ce point de vue est la lettre qu’il écrit en 1615 à la grande duchesse de Toscane :
« Dans les disputes relatives aux problèmes de la nature, on devrait commencer par
évoquer non pas l’autorité des Ecritures, mais bien les expériences sensibles et les
démonstrations nécessaires ».
Galilée n’est pas un adversaire du christianisme. C’est un chrétien non dogmatique,
indifférent aux querelles théologiques. Il ne rejette pas la Bible ; il partage l’essentiel des valeurs et
des enseignements qu’elle dispense, mais il ne s’attache pas à la lettre de son texte, comme le
faisaient en son temps les théologiens. Aussi tient-il pour de peu d’intérêt les considérations

CAPES Agrégation – Cours du 12/12/2016 – Didier Foucault - Ancienne pensée scientifique et nouvel esprit scientifique (XVe-XVIIIe siècles)
5
bibliques qui portent sur des questions éloignées de la religion. Pour Galilée, et à sa suite la
majorité des grands savants de son siècle, l’Eglise doit accepter l’autonomie du travail des savants
lorsqu’ils se penchent avec rigueur sur l’étude des phénomènes naturels. L’on sait que, confrontée
aux défis qu’après Galilée la science lui a lancés, l’Eglise a refusé ce compromis, elle l’a rejeté avec
vigueur. Le procès de 1616 qui condamne l’héliocentrisme de Copernic et surtout celui de 1633,
dont il est l’accusé et qui le condamne à la réclusion et au silence, sont les moments cruciaux de
ce divorce qui s’amorce entre la science moderne et le christianisme.
- L’autonomie de la pensée scientifique moderne vis-à-vis de la religion
C’est certainement l’Italie (les Etats pontificaux mais aussi le royaume de Naples ou la
Toscane) qui a le plus pâti de cette intransigeance dogmatique. Loin de s’assouplir, la position de
la papauté reste très ferme pendant tout le XVIIe siècle. Les disciples de Galilée (Torricelli,
Borelli) sont obligés de redoubler de prudence pour éviter les poursuites. Les cartésiens, les
atomistes sont contraints de se taire ou sont en butte à des persécutions et ne trouvent que peu
d’appuis : comme ceux de l’ancienne reine de Suède, Christine, qui vit à Rome et qui protège les
savants novateurs. La France, toute catholique qu’elle soit, laisse les savants conduire assez
librement leurs recherches. Certes, après le procès de Galilée, ceux-ci sont prudents : Descartes,
par exemple, renonce à publier son traité Du Monde, dont il ne livre que des passages dans le
Discours de la méthode (1637) ; les romans d’inspiration copernicienne de Cyrano de Bergerac (Les
Etats et empires de la Lune et du Soleil) sont publiés à titre posthume et expurgés en 1658. Comme en
France les sentences de l’Inquisition romaine ne sont pas reçues, ils sont nombreux ceux qui
accueillent favorablement les idées de Galilée : depuis « libertins érudits » (le bibliothécaire de
Mazarin Gabriel Naudé, le mathématicien Le Pailleur) jusqu’aux protestants (Pierre Borel,
médecin de Castres), en passant par des jansénistes (Blaise Pascal) et même des religieux
catholiques (Mersenne, Bouillau, Gassendi). Sous Louis XIV et grâce à Colbert, l’Académie des
sciences reçoit les astronomes héliocentristes, comme le Hollandais Christian Huygens, qui
découvre les satellites et l’anneau de Saturne, où l’Italien Jean-Dominique Cassini qui dirige
l’Observatoire de Paris. Enfin, lorsque Fontenelle publie ses Entretiens sur la pluralité des mondes
(1686), l’ensemble de la communauté savante a basculé en faveur de l’astronomie nouvelle. Quant
aux pays protestants, Angleterre ou Provinces-Unies, bien qu’au siècle précédent Luther et Calvin
aient témoigné leur désaccord avec Copernic, ils restent indifférents aux décisions de
l’Inquisition ; c’est même pour beaucoup d’adversaires du « papisme » une incitation à lire les
traités de Galilée ! Malgré, de-ci de-là, quelques réactions conservatrices d’hostilité protestante
contre les novateurs (Descartes eut ainsi maille à partir avec des universitaires réformés
d’Utrecht), les travaux des savants ne sont guère entravés. Newton est couvert d’honneurs
officiels et, s’il se montre prudent vis-à-vis des autorités anglicanes, c’est parce qu’il est
antitrinitaire, et non parce qui synthétise dans la théorie de l’attraction universelle un siècle-et-
demi de révolution astronomique.
Au XVIIIe siècle, les adversaires de la science moderne et du nouvel esprit scientifique qui
s’est répandu dans le sillage de l’astronomie, de la physique, de l’optique et de la physiologie
(notamment la découverte de la circulation sanguine par Harvey en 1628) continuent un combat
d’arrière-garde et sans espoir. D’autant que bien des savants chrétiens (et notamment des
religieux) ont adopté dans leur démarche les principes de la science nouvelle. L’Eglise cible alors
plutôt les savants proches des courants radicaux des Lumières, qui, en s’appuyant sur les avancées
de la science, rejettent le christianisme au profit du matérialisme mécaniste. Helvétius dans De
l’Esprit, La Mettrie dans L’Homme machine, les essais de Diderot, du baron d’Holbach et des
encyclopédistes franchisent un pas que Galilée n’avait pas franchi. Ils rompent les derniers liens
qui reliaient encore foi et raison, science et religion. Pour ces penseurs, la raison est le seul guide
qui peut conduire l’homme dans sa recherche de la vérité ; celle-ci n’a aucun caractère divin ou
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%