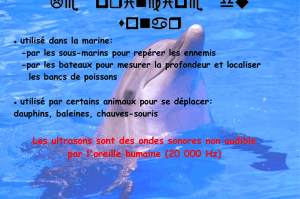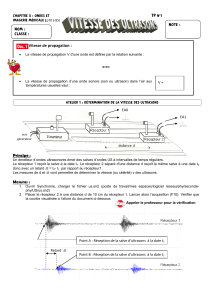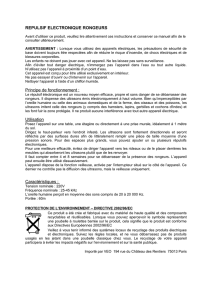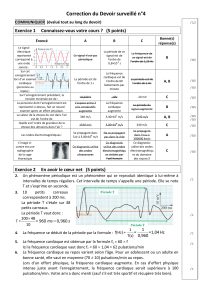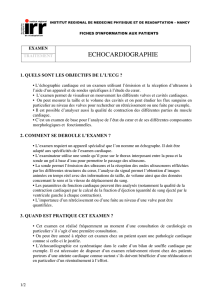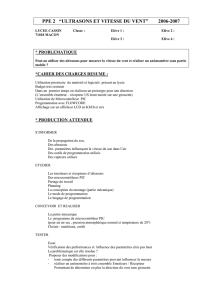(Activité 1 - les ultrasons

1
Activité n°1 – Les ultrasons
Document n°1 :
Est représenté ci-dessous le spectre visible de la lumière :
Couleur λ (nm)
Violet 400
Bleu 470
Vert 550
Jaune 590
Orange 630
Rouge 800
Document n°2 :
L’oreille humaine peut percevoir des ondes sonores dont les fréquences sont comprises entre 20Hz
et 20kHz
Document n°3 :
Les ultrasons sont des vibrations acoustiques de fréquence trop élevée pour produire une sensation
auditive.
Un ultrason correspond à une fréquence supérieure à 20 000 Hz ; il est, par rapport aux sons
audibles, ce que les radiations ultraviolettes sont aux radiations visibles du spectre.
La production des ultrasons
Ce n'est qu'en 1917, sous l'influence des nécessités pressantes de la lutte anti-sous-marine, qu'est
apparu le premier générateur d'ultrasons. Actuellement trois phénomènes sont utilisés ; dans les
trois cas l'énergie électrique transportée par des courants alternatifs de fréquence élevée est
transformée en énergie mécanique (oscillations d'un système mécanique).
Les générateurs piézoélectriques
La piézoélectricité a été utilisée par Langevin pour réaliser un générateur d'ultrasons dans lequel
l'élément essentiel est constitué par une sorte de mosaïque de lamelles de quartz, d'orientation et
d'épaisseur rigoureusement identiques, collées entre deux disques d'acier. L'ensemble est appelé un
triplet. On relie les deux disques métalliques aux deux bornes d'une source de courant alternatif. Les
lames de quartz présentent la propriété de se déformer à la même fréquence que celle de la tension
qui leur est appliquée. Elles produisent des vibrations mécaniques qui sont transmises au milieu
dans lequel se trouve l'appareil.
λ
(nm)
400 800 600
f (Hz)

2
Les émetteurs magnétostrictifs
Les émetteurs magnétostrictifs constituent une application d'une propriété des corps
ferromagnétiques qui consiste en une variation des dimensions du corps lorsque celui-ci est placé
dans un champ magnétique variable (magnétostriction). Par exemple, on peut utiliser un
empilement de tôles de nickel et le placer à l'intérieur de deux enroulements, l'un parcouru par un
courant continu (pour obtenir un champ magnétique constant convenable), l'autre parcouru par un
courant alternatif (pour produire un champ magnétique variable). Le champ résultant permet
d'obtenir une contraction relative assez importante et donc une vibration d'amplitude assez grande.
Ces émetteurs sont très robustes mais ils ne permettent pas de produire des ultrasons de fréquence
supérieure à 50 000 Hz.
L'électrostriction
L'électrostriction de certaines céramiques (titanate de baryum, zirconate de baryum ou de plomb)
consiste en une variation des dimensions du corps lorsque celui-ci est placé dans un champ
électrique variable. L'utilisation de cette propriété permet d'obtenir des vibrations ultrasonores.
La détection des ultrasons
La détection et la mesure des ultrasons sont réalisées au moyen d'appareils divers. Les phénomènes
piézoélectriques, magnétostrictifs et électrostrictifs étant réversibles, les dispositifs utilisés à
l'émission peuvent constituer des récepteurs. Dans ce cas, les vibrations mécaniques engendrent une
tension électrique de même fréquence que les ultrasons à détecter et c'est cette tension qui est
étudiée. Les ultrasons exercent une pression de radiation qui devient appréciable quand l'énergie de
rayonnement est suffisamment grande. La poussée qui est alors exercée sur une petite palette de
surface connue peut être mesurée. Les ultrasons sont aussi détectés au moyen de différents
dispositifs interférométriques ou d'appareils conçus pour étudier les ondes stationnaires.
Les applications des ultrasons
Le repérage d'obstacles
En 1917, Langevin met au point le premier projecteur ultrasonore permettant d'obtenir des
faisceaux suffisamment intenses et bien dirigés ; cet appareil est destiné à détecter les sous-marins
ennemis. Le principe de cette méthode est simple : les ultrasons se réfléchissent sur un obstacle et
reviennent à leur point de départ en produisant un écho : connaissant, d'une part, le temps séparant
l'émission de l'onde et la réception de l'écho, d'autre part la vitesse de l'ultrason dans l'eau de mer
(environ 1 500 m/s), il est facile de déduire la distance de l'obstacle dans la direction du faisceau.
Cette méthode a été adaptée à d'autres problèmes : repérage d'obstacles tels que les icebergs,
sondage, téléphonie sous-marine, repérage des bancs de poissons. Lors de la guerre de 1939-1945,
le problème du repérage des sous-marins est redevenu d'actualité et de nombreux appareils appelés
« asdics » puis « sonars » ont été construits.
L'utilisation industrielle
En métallurgie, les ultrasons sont utilisés pour le dégazage des métaux, pour la détection de défauts,
pour l'usinage et la soudure de certains matériaux. Pour le perçage, un foret solidaire de la partie
mobile d'un générateur d'ultrasons effectue des mouvements de va-et-vient à la fréquence des
ultrasons. Bien que facilitée par la présence d'une pâte abrasive, cette opération est cependant

3
relativement lente. Une précision de quelques micromètres est obtenue très facilement. De surcroît
les matières les plus dures peuvent être percées par ce moyen.
Les ultrasons sont employés également pour l'amélioration des émulsions photographiques, la
stérilisation de certains liquides, notamment du lait, la prospection de gisements minéraux, la
déflagration d'explosifs commandée à distance, le nettoyage de certains corps et la soudure entre
elles de matières plastiques souples ou rigides. Au point de vue médical, des succès ont déjà été
obtenus dans le traitement des névralgies, de certains spasmes d'origine neurovégétative, de
certaines formes d'artériosclérose. Les ultrasons ont été utilisés pour déterminer des lésions
localisées de certains organes ou tissus (les ultrasons sont plus ou moins absorbés durant leur trajet
à travers les tissus humains). Cette méthode d'étude a notamment été employée pour la recherche
d'anomalies dans la boîte crânienne, au niveau des cordes vocales, pour l'observation de l'œil et
pour des observations gynécologiques (en début de grossesse). Des cannes spéciales pour aveugles
contiennent un émetteur d'ultrasons ; un récepteur recevant les ondes réfléchies par un obstacle
utilise leur énergie pour la production de sons audibles.
Texte issu de l’encyclopédie « Larousse » en ligne
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/ultrasons/181001
Questions :
1. a. Dans le document n°1, compléter les deux carrés avec IR (pour Infrarouge) et UV (pour
Ultraviolet).
Pour des longueurs d’ondes inférieures à 400 nm, on a les UV.
Pour des longueurs d’ondes supérieures à 800 nm on a des IR.
b. On rappelle que les valeurs de longueurs d’onde sont données dans le vide. Quelle est la
célérité de la lumière dans le vide (dans le SI avec 2 chiffres significatifs) ?
La célérité de la lumière dans le vide est : c = 3,0.10
8
m.s
-1
c. Calculez alors les fréquences correspondantes pour les couleurs rouge et violette.
Calcul pour le rouge :
f = v / λ = 3,0.10
8
/ 800.10
-9
= 3,8.10
14
Hz (Attention ! 2 chiffres significatifs)
Calcul pour le violet :
f = v / λ = 3,0.10
8
/ 400.10
-9
= 7,5.10
14
Hz (Attention ! 2 chiffres significatifs)
d. Commenter alors la phrase du document n°3 : « Un ultrason correspond à une fréquence
supérieure à 20 000 Hz ; il est, par rapport aux sons audibles, ce que les radiations ultraviolettes
sont aux radiations visibles du spectre. »
Les ultrasons ont des fréquences supérieures aux sons audibles comme les UV qui ont des
fréquences supérieures aux radiations du visible.
2. Effectuer un schéma légendé qui permet d’illustrer comment l’effet piézoélectrique permet de
créer une source d’ondes ultrasonores.

4
3. Effectuer un schéma légendé qui permet d’illustrer comment l’effet piézoélectrique permet de
détecter des ondes ultrasonores.
4. Exercice :
Un sonar utilise un émetteur-récepteur qui envoie de brèves impulsions d’ondes de fréquence 40
kHz. La vitesse de propagation de ces ondes dans l’eau est de 1500 m.s
-1
.
a. Pourquoi peut-on affirmer que les ondes utilisées sont des ultrasons ?
La fréquence des ondes est de 40 kHz. Les ondes sont appelées ondes sonores lorsque leurs
fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Au-delà de 20 kHz elles sont qualifiées d’ondes
ultrasonores.
b. Ce type d’onde se propagerait-il plus ou moins vite dans l’air ? A expliquer.
Oscilloscope
Les
ultrasons mettent
en vibration les
lamelles de quartz qui
vibrent avec la même
fréquence que les
ultrasons et créent ainsi
u
ne tension aux bornes
des disques en acier.
L’oscilloscope
permet de
détecter la
tension créée
aux bornes des
disques.
Lamelles de quartz
Disques d’acier
Source de courant
alternatif
Les lamelles se déforment et
vibren
t avec la même
fréquence que la tension
:
cette vibration est
communiquée
au milieu
environnant
: il y a création
d’ultrasons.

5
D’une manière générale, plus le milieu est dense et plus le son se propagera rapidement. Dans l’air,
les ultrasons se propagent donc moins vite que dans l’eau.
Dans l’acier le son se propage entre 5500 et 6000 m.s
-1
.
c. Ecrire la formule qui lie d, la distance entre le sonar et l’obstacle, ∆t, la durée qui sépare
l’émission et la réception et v, la célérité de l’onde.
Attention ! La durée ∆t correspond en fait à la durée mise par les ultrasons pour parcourir l’aller et
le retour entre le sonar et l’obstacle donc à la durée mise pour parcourir 2d. On en déduit :
2d = v × ∆t
d. Le sonar reçoit un signal réfléchi 0,53 s après l’émission. A quelle distance d se trouve
l’obstacle ? d = (1500 × 0,53) / 2 = 397,5 m
Le résultats doit être donné avec deux chiffres significatifs donc d = 4,0.10
2
m
e. Pour quelle technique de diagnostic médical un tel type d’onde est-il utilisé ?
Les ultrasons sont aussi utilisés pour réaliser des échographies. On peut ainsi suivre une grossesse
mais son usage est plus général, on peut en effet mesurer la taille d’un organe et diagnostiquer ainsi
une anomalie (tumeur etc).
f. Quels animaux utilisent aussi le principe du sonar pour se repérer ?
Pour explorer leur environnement les chauves-souris et les dauphins émettent des ultrasons d’une
fréquence supérieure à 100 kHz. (D’autres animaux émettent des infrasons pour communiquer
comme les baleines et les éléphants.)
1
/
5
100%