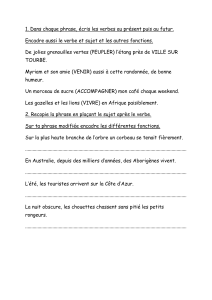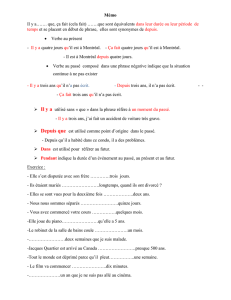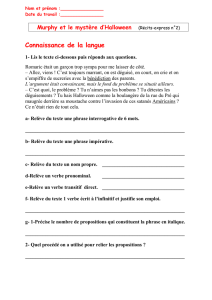Grammaire Française : Lire, Écrire, Comprendre la Langue

LIRE, ÉCRIRE,
COMPRENDRE
LA GRAMMAIRE
ET LA LANGUE

DONNÉES CONCEPTUELLES
• Conception UMER - Unité des moyens d’enseignement romands
Secrétariat général de la CIIP
• Réalisation Imaginemos France
Jean Gomez (coordination éditoriale)
Philippine Lefas, Justine Massel (suivi éditorial)
• Mise en page Stéphanie Capitolin Deleau
RÉDACTION
• Auteur Pierre-Alain Balma, formateur IUFE, maître secondaire, GE
• Co-auteur Christian Tardin, COMEO, maître secondaire, BE
DONNÉES SCIENTIFIQUES
• Experts scientifiques Jean-Paul Bronckart, UNIGE - La grammaire du texte
Ecaterina Bulea, UNIGE - La grammaire du texte
Noël Cordonnier, UNIL - Les vocabulaires thématiques
Frédéric Gachet , UNIFR - La grammaire de la phrase
Christopher Laenzlinger, UNIGE - La grammaire de la phrase
Aurélie Reusser-Elzingre, UNINE - L’histoire de la langue
Pascal Riverin, Université LAVAL (Québec) - La grammaire de la phrase
Christophe Ronveaux, UNIGE - La grammaire du texte
• Groupe de validation Anne Christe de Mello, présidente (VD)
Sandrine Codourey (FR)
Carole Donnet-Monay (VS)
Gilles Saillen, délégué SER (VS)
Fabian Zadory, délégué SER (VD)
DONNÉES TECHNIQUES
• No CATARO 011258
• No d’édition 2013
• Copyright Neuchâtel, 2013 © CIIP, Conférence Intercantonale
de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin
Faubourg de l’Hôpital 68, case postale 556
CH-2002 Neuchâtel,
www.ciip.ch
Tous droits réservés pour tous pays.
Contact Unité des Moyens d’Enseignement Romands (UMER)
•
Expert CIIP Jean-François de Pietro, IRDP, NE

BESOIN DE CONSENSUS ET NÉCESSITÉ D'HARMONISATION
Le Plan d'études romand (PER) et les moyens d’enseignement qui l’accompagnent (MER) s'inscrivent
dans la mise en œuvre de la Convention scolaire romande édictée par la CIIP en juin 2007, convention
qui vise au niveau romand à mettre en œuvre HarmoS et à renforcer l’Espace romand de formation.
En ce qui concerne l’enseignement du français, l’étude du fonctionnement de la langue est l'une
des huit composantes de la langue de scolarisation retenues dans le domaine Langues du PER :
compréhension de l’écrit, production de l’écrit, compréhension de l’oral, production de l’oral, accès
à la littérature, fonctionnement de la langue, approche interlinguistique, écriture et instruments
de communication.
Sur le plan terminologique, on trouve dans le PER environ 280 expressions de nature métalinguis-
tique, dont un tiers figure sous la rubrique LA GRAMMAIRE DE LA PHRASE. Ces notions sont utilisées
et exposées dans le PER sans pour autant y être développées et explicitées, ce qui serait, il est
vrai, plutôt le rôle des moyens d’enseignement. Mais ces derniers, si bien élaborés soient-ils, sont
issus d'éditeurs différents et ne présentent pas toujours une explication univoque des phénomènes
de la langue. Face à la compréhension des objectifs d'apprentissage du PER et à l'harmonisation
souhaitée au niveau romand, il subsiste forcément des zones d’ombre, des imprécisions sujettes à
interrogation ou à inconfort.
Afin de combler cette lacune, un document de référence faisant état du fonctionnement de la
grammaire, de la langue et des textes, a été jugé depuis longtemps indispensable. Longuement
élaborée puis validée par des experts et des praticiens, cette grammaire de référence se présente
sous forme d'un ouvrage électronique facile à consulter et non destiné à une publication classique.
Elle s’adresse aux répondants cantonaux pour la langue de scolarisation, aux auteurs de ressources
didactiques, aux formateurs et aux enseignants. Tout comme le PER, cette grammaire conserve un
caractère évolutif et servira de référence dans la sélection et la production de moyens d'enseigne-
ment tout comme dans la formation des enseignants en Suisse romande.
CHOIX TERMINOLOGIQUES
La grammaire – et sa terminologie – est un domaine complexe où de nombreuses difficultés et
questions demeurent largement ouvertes, tant sur le plan du contenu que sur le plan des finalités
de cet enseignement. La linguiste Marie-José Béguelin le relève judicieusement dans son ouvrage
De la phrase aux énoncés : grammaire scolaire et descriptions linguistiques
, commandité par la CIIP
dans la deuxième moitié des années nonante :
« Au chapitre des difficultés générales, signalons que la langue est un objet d’étude particuliè-
rement complexe, multiplement déterminé, sujet en variation en synchronie et à changement en
diachronie. De leur côté, les théories linguistiques ne sont ni achevées, ni unifiées, aucune d’entre
elles ne pouvant prétendre modéliser les faits langagiers sous l’ensemble de leurs aspects. Non
seulement les théories sont lacunaires, mais elles sont parfois incompatibles entre elles, ce qui
rend plus délicat le travail de transposition didactique. Un tel travail suppose en effet que certains
modèles linguistiques soient privilégiés par rapport à d’autres; il suppose aussi que l’on décide, pour
chaque catégorie de faits, de retenir telle variante de modélisation plutôt que telle autre, sans qu’il
soit toujours possible de parvenir d’emblée au choix le plus judicieux.
D’autre part, pour des raisons qui concernent autant les visées pragmatiques de l’enseignement
grammatical que le souci de préserver le consensus social, une réforme de l’enseignement
AVANT-PROPOS

grammatical ne peut que difficilement conduire à un bouleversement complet et brutal des usages
terminologiques et des méthodes d’analyse. Comme on aura l’occasion de l’illustrer dans la suite
de cet ouvrage, toute réforme de ce genre est portée à préserver, au moins en partie, les notions
traditionnelles et les pratiques pédagogiques éprouvées, voire à les réintroduire de manière plus
ou moins subreptice après avoir prétendu les détrôner. »
La grammaire de référence n’échappe pas à ce constat : tout au long de la rédaction, des choix
terminologiques ont été effectués. Ces choix prennent essentiellement en compte les notions et
les objectifs exposés dans le PER ainsi que les approches des moyens d’enseignement introduits
dans les cantons romands ces dernières années. Cependant il est quelques options qui, pour des
raisons linguistiques, diffèrent de ce que proposent le PER et les moyens d’enseignement, et dont
les plus déterminantes sont motivées ci-après, sous le titre PRINCIPAUX NŒUDS TERMINOLOGIQUES ET
CHOIX GRAMMATICAUX.
Pendant leur travail comme au moment de la validation finale, les auteurs ont bénéficié des com-
mentaires, des suggestions et des conseils d’un groupe d’universitaires et de praticiens. C’est sou-
vent lors de ces interactions que les choix sur le plan terminologique ont été déterminés. Fonda-
mentalement, la grammaire de référence se veut évolutive afin que la réflexion sur la langue et sur
son enseignement puissent se poursuivre sur le plan romand.
La CIIP adresse de chaleureux remerciements aux auteurs, aux experts et aux enseignants, ainsi
qu'à toutes les personnes qui ont contribué à ce long, délicat et précieux travail et se réjouit de
mettre cet ouvrage de référence à la disposition d'un large public par le biais de son site internet.
Secrétariat général de la CIIP - Juin 2013
PRINCIPAUX NŒUDS TERMINOLOGIQUES
ET CHOIX GRAMMATICAUX
La phrase graphique et la phrase orale
Nous ne considérons pas la phrase graphique et la phrase orale comme des structures syntaxiques.
À l’écrit, l’émetteur peut choisir de délimiter une section de texte par une majuscule et un signe de
ponctuation forte; à l’oral, par deux pauses importantes de la voix.
La phrase écrite et la phrase orale dépendent donc d’un choix effectué par l’émetteur et relèvent
de la grammaire du texte.
La phrase complexe
Dans la partie 3, LA GRAMMAIRE DE LA PHRASE, nous distinguons la phrase simple, les enchaînements
de phrases et la phrase avec subordination. Seule cette dernière est dénommée phrase complexe.
Le PER, quant à lui, considère qu’une phrase (graphique !) est complexe si elle contient au moins
deux verbes conjugués, ce qui permet d’inclure dans cette notion les enchaînements de phrases
(juxtaposition, coordination et phrase incise).
Il est difficile toutefois, sur le plan linguistique, d’analyser une phrase avec enchaînement et une
phrase avec subordination sur le même plan.
La structure de base d’une phrase complexe est la même que celle d’une phrase simple : S + P (+ CP).
Seule différence : au moins un des groupes qui constituent la phrase complexe est lui-même une phrase.
Dans un enchaînement, il y a autant de structures de base que de phrases juxtaposées, coordon-
nées ou incises.
La notion de modificateur
Cette notion est introduite au cycle 2 et au cycle 3 dans le PER. Sur le plan de l’analyse gramma-
ticale, il n’est pas toujours évident de différencier les fonctions
modificateur
et complément de
phrase, comme le soulève Marie-José Béguelin dans l’exemple suivant :
ex
Le camion passe lentement sur le boulevard.

Dans cet exemple,
lentement
est supprimable et déplaçable et pourrait donc être identifié comme
un CP. Mais on peut tout aussi bien le considérer comme un modificateur du verbe dans la mesure
où il ne dépasse pas la portée de celui-ci. En fait, comme de nombreux linguistes l’ont souligné,
une structure syntaxique est parfois susceptible de deux analyses grammaticales concurrentes.
La phrase corrélative
La phrase corrélative n’est pas abordée dans le PER, du moins sous cette appellation métalinguistique.
Le PER mentionne toutefois l’analyse des valeurs sémantiques de conséquence et de comparaison.
Il nous a paru important de consacrer quelques pages à la phrase corrélative dont le fonctionnement
est particulier dans la mesure où elle s’articule avec l’adverbe modificateur d’un groupe nominal,
d’un groupe verbal, d’un groupe adjectival ou d’un groupe adverbial.
Par ailleurs, l’étude de la corrélative comparative peut être utile pour l’apprentissage des L2 et L3
(comparatif et superlatif en allemand et en anglais).
Les valeurs sémantiques
Nous avons opté pour l’appellation « valeurs sémantiques » plutôt que « nuances sémantiques »
(PER) afin de désigner les différentes réalités (temps, lieu, cause, manière…) qu’expriment les com-
pléments de phrase.
En effet, le terme nuance implique une référence à un hyperonyme (les nuances d’une couleur
par exemple). Or, en l’occurrence, l’hyperonyme serait la fonction
complément de phrase
(CP de
lieu, de temps, de cause…). Il y a donc une intersection entre l’axe syntaxique (la fonction) et l’axe
sémantique (la valeur exprimée).
C’est pourquoi nous avons préféré le mot valeur dans la distinction que nous effectuons entre la
classe grammaticale, la fonction et les valeurs sémantiques liées à la signification d’un mot, d’un
groupe ou d’une phrase.
Les compléments de temps et de lieu essentiels (CV) et non essentiels (CP)
La notion de complément, fréquemment utilisée bien que récente en grammaire (XVIIIe siècle),
recourt à la fois à des critères syntaxiques et sémantiques comme le relève Marie-José Béguelin :
« Pour le cas épineux des compléments, on peut résumer la situation de la manière suivante : les
typologies traditionnelles, fondées sur des critères plutôt sémantiques, coexistent cahin-caha
avec une approche plus strictement syntaxique, opposant complément de verbe et complément
de phrase. Cependant, cette opposition binaire se révèle trop simple, et la solution aux problèmes
rencontrés ne peut venir que d’une théorisation des relations entre lexique et syntaxe. »
Il y a donc lieu de distinguer très clairement ce qui relève de la fonction et de la valeur. La fonction
grammaticale désigne la relation qu’un constituant entretient avec un autre à l’intérieur d’une
phrase. La valeur relève d’une approche sémantique et est fortement liée à la signification d’un
mot ou d’un groupe de mots.
Sur le plan purement syntaxique, et c’est la perspective que nous retenons, un complément est
essentiel (CV) ou non essentiel (CP), quelle que soit la valeur sémantique exprimée. Les complé-
ments qui expriment des valeurs de temps et de lieu (ainsi que de prix et de mesure) n’échappent
pas à ce constat. Il convient avant tout d’effectuer une distinction entre les compléments qui entre-
tiennent une relation étroite avec le verbe et ceux qui ne dépendent pas du verbe mais de la phrase.
Le groupe pronominal
Cette notion n’a pas été retenue dans la mesure où le pronom, dans de nombreux cas, est déjà le
substitut d’un groupe nominal. Le pronom peut toutefois avoir des expansions. Nous rejoignons en
ce sens la position de Suzanne-G. Chartrand dans
Grammaire pédagogique du français d’aujourd’hui
(. BIBLIOGRAPHIE).
Les rectifications de l’orthographe du français
Un extrait du document
Les Rectifications de l’orthographe du français
, publié par l’IRDP en 1996,
figure en annexe. Nous n’avons pas tenu compte des orthographes rectifiées dans la rédaction de
la grammaire de référence, sauf dans le chapitre consacré à l’orthographe où les deux graphies
sont proposées.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
1
/
228
100%