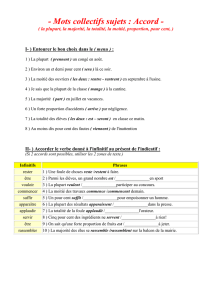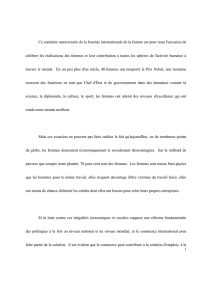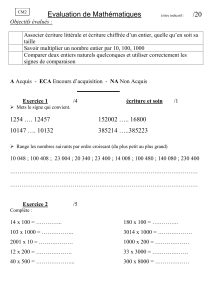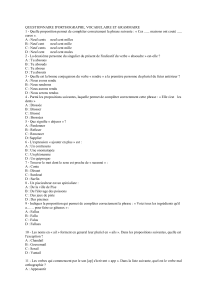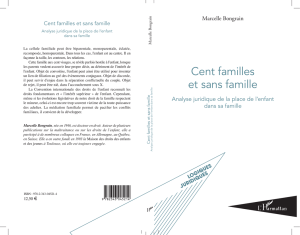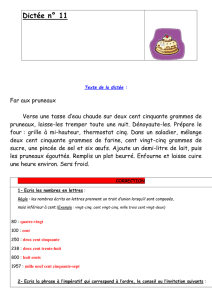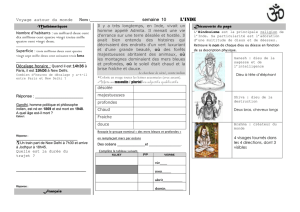télécharger le document - Banque Centrale de Madagascar

v
SOMMAIRE
L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL…………………………. 1
PREMIERE PARTIE
L’EVOLUTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
CHAPITRE I : LE SECTEUR REEL
1.1-LE PRODUIT INTERIEUR BRUT………………………………………………… 3
1.1.1-LES ORIGINES DU PIB…………………………………………..…………..… 4
1.1.2-LES EMPLOIS DU PIB……………………………………………..…………… 5
1.2-L’EVOLUTION DES PRIX……………………………………………..…………... 6
CHAPITRE II : LE SECTEUR EXTERIEUR
2.1-LA BALANCE DES PAIEMENTS…………………………………………………. 8
2.1.1-LA BALANCE COMMERCIALE………………………………………………. 8
2.1.1.1-Les exportations……………………………………………………………. 8
2.1.1.2-Les importations………………………………………………………..…... 8
2.1.2-LES SERVICES NETS ET REVENUS DES INVESTISSEMENTS……………. 9
2.1.3-LES TRANSFERTS COURANTS.………………….…………………………… 9
2.1.4-LES OPERATIONS EN CAPITAL ET FINANCIERES………………………... 9
2.2-LE MARCHE INTERBANCAIRE DE DEVISES…………………………………. 10
2.2.1-LE VOLUME DES TRANSACTIONS………………………………………….. 10
2.2.2-LES OPERATIONS DES BANQUES COMMERCIALES……………………... 10
2.2.3-LA BANQUE CENTRALE ET LE FRANC MALGACHE……………………... 10
2.3-LA DETTE EXTERIEURE………………………………………………………….. 11
2.3.1-SERVICE DE LA DETTE EXTERIEURE…………………………………...….. 11
2.3.2-ENCOURS DE LA DETTE EXTERIEURE…………………………………...… 12
CHAPITRE III : LES FINANCES PUBLIQUES
3.1-LES RECETTES PUBLIQUES……………………………………………….…….. 13
3.2-LES DEPENSES PUBLIQUES……………………………………………….…...… 14
3.3-LE FINANCEMENT DU DEFICIT GLOBAL……...……………………………... 16

vi
CHAPITRE IV : LE SECTEUR MONETAIRE ET FINANCIER
4.1-L’OFFRE DE MONNAIE PAR LE SYSTEME BANCAIRE…………………….. 18
4.2-LES COMPOSANTES DE LA MASSE MONETAIRE…………………………... 19
4.2.1-LES DISPONIBILITES MONETAIRES M1……………………………...…….. 19
4.2.2-LA QUASI-MONNAIE (M3 – M1)…………………….…………………….…. 20
4.3-LES CONTREPARTIES DE LA MASSE MONETAIRE………………….……... 21
4.3.1-LA POSITION EXTERIEURE NETTE…………………………………...……... 22
4.3.2-LES CREANCES NETTES SUR L’ETAT….………………………………….... 22
4.3.2.1- Les créances nettes sur l’Etat de la Banque Centrale……..…………….. 22
4.3.2.2- Les créances nettes sur l’Etat des banques primaires ……..………….... 22
4.3.3-LES CREDITS A L’ECONOMIE………………………………………………... 23
4.3.3.1- Les crédits à court terme…………………………………....…………….. 24
4.3.3.2- Les crédits à moyen et long termes…………………………..………….... 25
4.3.3.3- Répartition des crédits par secteur d’activités……………..………….... 25
4.4-LES TAUX D’INTERETS ET LA LIQUIDITE BANCAIRE…………….…..…... 26
4.4.1-LES TAUX D’INTERETS…………………………………...…………………….... 26
4.4.1.1- Le taux directeur de la Banque Centrale et les taux bancaires……….... 26
4.4.1.2- Le rendement des titres publics………………………………………....... 27
4.4.2-LA LIQUIDITE BANCAIRE ET LA LIQUIDITE DE L’ECONOMIE…………..... 28
4.4.2.1- La liquidité des banques………………………………………………....... 28
4.4.2.2- La liquidité de l’économie……………………………………………….... 29
DEUXIEME PARTIE
ACTIVITES ET GESTION DE LA BANQUE CENTRALE
I-L’AMELIORATION DU SYSTEME DE PAIEMENTS…………………..………. 30
II-LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION ………….……….... 30
III-LE DEVELOPPEMENT DES MOYENS LOGISTIQUES…………………….….. 31
IV-LE RENFORCEMENT DE L’AUDIT INTERNE……………………………...….. 31

vii
V-ENQUETE SUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS ET SUR
LES INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE……….…...……………………. 32
VI-L’ADMINISTRATION DE LA BANQUE CENTRALE…………..……….…...…. 33
1-LE GOUVERNEUR……………………………………………………………………... 33
2-LE DIRECTEUR GENERAL………………………………………………………….... 33
3-LE CONSEIL D’ADMINISTRATION………………………………………………….. 33
4-LES CENSEURS……………………………………………………………………..….. 34
5-LES DIRECTEURS…………………………………………………………………....... 34
VII-LES COMPTES DE LA BANQUE CENTRALE…………..…….……….…….. 35
1-LE BILAN DE LA BANQUE CENTRALE…………………………………………….. 35
2-LE COMPTE DE RESULTATS………………………………………………………… 36
3-LES HORS BILAN……………………………………………………………………… 37
4-OPINION DE L’AUDITEUR…………………………………………………………… 38
LISTE DES TABLEAUX
T1. Produit intérieur brut aux prix de 1984
T2. Contribution à la croissance du PIB
T3. Balance des paiements
T4. Service de la dette extérieure
T5. Encours de la dette extérieure
T6. Evolution de la structure des recettes publiques
T7. Evolution de la structure des recettes budgétaires
T8. Evolution de la structure des dépenses publiques
T9. Evolution de la structure des dépenses courantes
T10. Evolution de la structure des dépenses en capital
T11. Evolution du financement du déficit global du Trésor par le système bancaire
T12. Répartition de l’orig ine de la croissance annuelle de M3
T13. Structure et évolution des disponibilités monétaires
T14. Structure de la quasi-monnaie
T15. Evolution des créances et des engagements de la Banque Centrale vis-à-vis de l’Etat
T16. Evolution des créances et des engagements des banques commerciales vis-à-vis de l’Etat
T17. Répartition des encours de crédits bancaires à court terme
T18. Répartition des crédits bancaires à moyen et long termes
T19. Encours des risques bancaires par branche d’activité économique
T20. Evolution des taux de base et taux débiteurs des banques
T21. Situation des réserves des banques
T22. Evolution de la vitesse de circulation de la monnaie
T23. Compte de résultats de la Banque Centrale de Madagascar
T24. Les hors bilan de la Banque Centrale de Madagascar

viii
LISTE DES GRAPHIQUES
Fig.1: Evolution de la consommation globale, privée et publique
Fig.2: Evolution de l’épargne et des investissements
Fig.3: Evolution des indices des prix par origine des produits
Fig.4: Evolution des recettes publiques
Fig.5: Evolution des dépenses publiques
Fig.6: Evolution des taux d’intérêts
ANNEXES
Annexe 1 : Balance des paiements 2000-2003………………………………………….… 40
Annexe 2 : Evolution des importations………………………………………………….… 41
Annexe 3 : Evolution des exportations……………………………………………….…… 42
Annexe 4 : Evolution des crédits bancaires par agent économique bénéficiaire………..… 43
Annexe 5 : Evolution des Opérations Globales du Trésor………………………………… 44
Annexe 6 : Résumé des résultats de la première enquête sur les investissements directs
étrangers et sur les investissements de portefeuille………………………..….. 45
1- Objectifs…………………………………………………………………….. 45
2- Situation des entreprises selon la part de capital des investisseurs non-
résidents……………………………………………………………………….. 46
3- Les entreprises des IDE par branches d’activités…………………………... 46
4- Les indicateurs de résultat………………………………………………….. 47
5- Niveau général des investissements étrangers…………………………….... 48
6- Origines géographiques de la composante IDE…………………………….. 49
7- Le stock de capital par branche………………………….………………….. 49
8- Les principaux pays investisseurs à Madagascar……………………….…... 50
9- Situation générale des flux…………………………...…………………….. 51
10- Situation des flux des IDE par type d’entreprise d’investissement
direct…………………………………………………………………………… 51
11- Situation des flux des IDE par pays d’origine…………………………….. 52
12- Remerciements……………………………………………………...…….. 53
Annexe 7 : Le bilan de la Banque Centrale de Madagascar……………………………….. 54
Liste des tableaux de l’Annexe 6
T1. Répartition des entreprises selon la part de capital détenue par les non-résidents
T2. Répartition des entreprises des IDE par branche en 2000 et en 2001 (en %)
T3. Indicateurs de performances des entreprises à investissement étranger par branche
en 2000 et en 2001
T4. Répartition des capitaux étrangers par type d’investissement (en FMG)
T5. Répartition des stocks des IDE selon leurs composantes (en FMG)
T6. Répartition par zone géographique des stocks des IDE

ix
T7. Parts de chaque branche dans le stock de capital des IDE (en %)
T8. Structure du flux des IDE des années 2000 et 2001 (en FMG)
T9. Répartition des flux des IDE par type d’entreprise d’investissements directs (en FMG)
T10. Répartition par pays des flux des IDE des années 2000 et 2001
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
1
/
61
100%