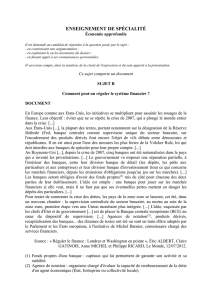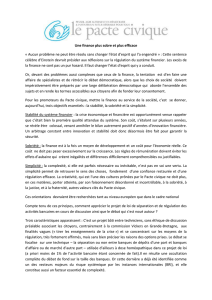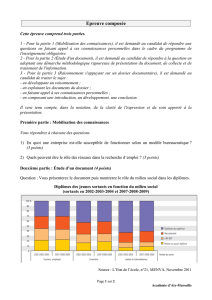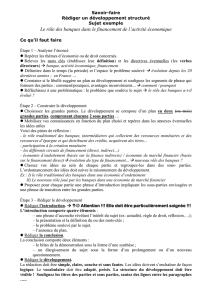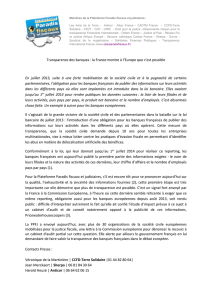La banque coopérative pour une autre finance mondiale

LA BANQUE COOPÉRATIVE PEUT-ELLE DEVENIR UNE
ALTERNATIVE À LA FINANCE CAPITALISTE ?
Daniel Bachet
Direction et Gestion (La RSG) | La Revue des Sciences de Gestion
2012/3 - n° 255-256
pages 97 à 102
ISSN 1160-7742
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2012-3-page-97.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachet Daniel, « La banque coopérative peut-elle devenir une alternative à la finance capitaliste ? »,
La Revue des Sciences de Gestion, 2012/3 n° 255-256, p. 97-102.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Direction et Gestion (La RSG).
© Direction et Gestion (La RSG). Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 255-256 – Finance
mai-août 2012
97
Dossier II
Financer autrement ?
La banque coopérative
peut-elle devenir une alternative
à la finance capitaliste ?*
par Daniel Bachet
Daniel BACHET
Professeur de sociologie à l’Université d’Évry,
Chercheur au Centre Pierre Naville
France
L
es banques coopératives rassemblent dans les années
récentes en Europe 37 millions de membres sociétaires,
100 millions de clients et 4000 banques locales, soit la
moitié des établissements de crédit. Leur place est particuliè-
rement importante en Allemagne (avec la DZ en tête de réseau)
ou en France avec plus de 40 % de dépôts.
Les banques issues de la tradition coopérative occupent en
France aujourd’hui une place majeure dans la banque de détail
tout comme dans la banque d’investissement. Ces banques ont
vu confirmer leur statut « spécial » par la loi bancaire du 24 janvier
1984. Ce statut est celui de société coopérative bancaire de
droit privé. Les clients qui sont des personnes physiques et/ou
morales ont aussi le statut d’associés et détiennent le capital.
Les banques Populaires, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel,
pour ne citer que les plus connues, se constituent respectivement
en 1878, 1894 et 1899 afin de rendre accessibles les services
bancaires et le crédit aux populations qui en sont exclues (paysan-
nerie pauvre, petite bourgeoisie, catégories ouvrières) et dont
le seul recours possible était l’usure. Ces banques s’inscrivent
dans le mouvement coopératif qui émerge d’abord en Allemagne
au cours du XIXe siècle et se développe par la suite.
Le Crédit Agricole (et sa filiale LCL, ex-Crédit Lyonnais), le groupe
BPCE (issu de la fusion des Banques Populaires et des Caisses
d’Épargne) ou le Crédit Mutuel sont progressivement devenus de
véritables groupes financiers. Certains se sont engagés récem-
ment dans les dérives de la finance libéralisée et en ont même
été parfois les agents actifs. C’est le cas par exemple du Crédit
Agricole et des Banques Populaires et Caisses d’Épargne avec
Natixis, leur véhicule coté étant directement impliqué dans la
crise des subprimes à travers sa filiale américaine CIFG.
* Une version de cet article en langue anglaise sera publiée avec l’autorisation
de notre revue dans l’ouvrage à paraître en 2013 sous la direction de William
Barnett and Fredj Jawadi (Eds), International Symposia in Economic Theory
and Econometrics: Recent Developments in Alternative Finance: Empirical
Assessments and Economic Implications, Emerald Publishing, Bingley, UK,
2013.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 255-256 – Finance98
Dossier II
Financer autrement ?
mai-août 2012
En principe, les finalités, les valeurs et la gouvernance de ces
banques ne sont pas identiques à celles des banques capitalistes
classiques orientées vers la seule maximisation du rendement
financier à court terme.
L’idée affichée depuis les origines du mouvement coopératif est
profondément « démocratique » puisqu’un homme (une femme)
= une voix et que le concept de « propriété collective » reste
toujours d’actualité.
Dès lors comment concevoir que certains dirigeants de ces
établissements aient eu pour priorité ces dernières années
de développer des stratégies de croissance avec pour seul
objectif de devenir toujours plus puissants et de se verser des
salaires comparables à ceux des dirigeants des grandes banques
capitalistes ? Les revenus du directeur général du Crédit mutuel
ont atteint en effet 1,370 million d’euros en 2007 et ceux du
directeur général de Crédit Agricole SA ont été de 1,666 million
d’euros en 2010.
Qu’a-t-on fait du profit et le contrôle des processus de décision
demeure-t-il dans les mains des sociétaires ?
La question qui se pose est donc celle du mode d’organisation
des pouvoirs et des processus de décision c’est-à-dire de la
démocratie. C’est aussi la question de la véritable finalité
institutionnelle des banques issues de la tradition coopérative
dès lors que celle-ci ne semble plus toujours s’orienter vers un
exercice alternatif du métier de banquier.
1. Les fondements de la banque
issue de l’économie sociale
La logique des banques de l’économie sociale et solidaire est
étroitement liée à la philosophie de la coopérative. À l’origine
de la mise en œuvre de la production des biens et des services
se trouvent les différents membres du collectif. Ceux-ci sont
aussi les bénéficiaires de la production. Ils sont propriétaires
et bénéficiaires, c’est-à-dire sociétaires et usagers. La finalité
n’est pas la rémunération du capital mais l’amélioration du sort
des populations par la mise en commun de ressources. C’est
la pérennité de l’entreprise qui est visée et la rentabilité ne
s’exprime que sur le long terme.
L’actionnaire n’a pas d’existence spécifique dans ce modèle
puisque la création de valeur est destinée au collectif, les résultats
étant réinvestis dans la coopérative. Le principe démocratique
gouverne la gestion de ces organismes car les coopératives sont
détenues et contrôlées par leurs sociétaires qui élisent leurs
représentants dans les instances statutaires.
Durant la crise de 2008, des flux importants de capitaux se sont
un peu plus orientés vers les banques coopératives. On peut
penser que la recherche moins exacerbée de profit que dans
les banques classiques et la plus grande stabilité d’établisse-
ments dont l’objectif est la pérennité de l’organisation ont été
les raisons principales de ces adhésions. Deux autres points
majeurs méritent d’être soulignés.
D’une part, l’activité bancaire de type coopératif est plus engagée
vers le financement de la production et de la commercialisation
et d’autre part, le banquier s’implique davantage directement
dans les activités de production ou bien construit une relation
de proximité avec les entreprises concernées.
Sandrine Ansart et Virginie Monvoisin rappellent ces dimensions
structurantes des banques coopératives :
« La place de la communauté, le développement d’une terri-
torialité renforcent les liens, la fréquence des contacts, des
échanges d’information, la compréhension des activités, une
vision partenariale de la relation, l’établissement d’une confiance
réciproque fondée a priori sur des principes communs » (S. Ansart
et V. Monvoisin, 2011, p.205).
Les modes de financement proposés par l’économie coopéra-
tive bancaire semblent en mesure de répondre à des besoins
que la finance de marché ne peut satisfaire. Moins prisonnier
du court terme et de la recherche d’une rentabilité démesurée,
cette finance est en capacité de s’organiser selon des principes
importés du modèle démocratique. Elle génère d’autres formes
d’organisation productive et sociale. L’enjeu est de produire à
l’endroit où les citoyens consomment et de consommer près des
lieux de production. La coopération se développe localement, de
manière décentralisée et horizontale au sein de circuits courts
et distribués, afin de veiller à une meilleure réappropriation du
produit.
Compte tenu de ces valeurs et de ces pratiques de solidarité
et de démocratie, pourquoi les dirigeants de grandes banques
coopératives (Banques Populaires-Natixis, Crédit Agricole, Crédit
Mutuel, Caisses d’Épargne-Natixis) ont-ils cédé à la tentation de
copier les comportements des banques classiques en s’enga-
geant dans des dérives financières totalement opposées à leur
philosophie d’origine ?
Conscients de ces dérives, des individus ou des groupes organisés
se sont mis en mouvement pour recadrer les missions de ces
banques. C’est ainsi qu’un collectif, « Agir pour une économie
équitable », vient récemment de se créer en France pour entraîner
ses électeurs à être présents et actifs dans les assemblées
générales des banques coopératives et mutualistes. Il s’agit
d’inciter les sociétaires à exiger de ces banques une utilisation
de leurs dépôts et de leur épargne en faveur d’actions d’intérêt
général, respectueuses de la dignité des personnes (S. Mayer
et J.-P. Caldier, 2007).
2. Les dérives des banques
coopératives
La dérèglementation des marchés des biens et des services
(libre-échange), la dérégulation financière (financiarisation de
l’économie) et le nouveau gouvernement d’entreprise (corporate
governance) qui donne tout pouvoir aux détenteurs de capitaux
sont les trois composantes de la nouvelle configuration écono-
mique et sociale qui se met en place à la fin des années 1970
et au début des années 1980. Dans cette nouvelle configuration,
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 255-256 – Finance 99
Dossier II
Financer autrement ?
mai-août 2012
les banques de l’économie sociale vont jouer elles aussi la carte
de l’internationalisation. L’entrée en bourse du groupe ou de ses
filiales et le développement par croissance externe constituent
une forme de rupture avec les caractéristiques majeures du
modèle coopératif bancaire.
La banque coopérative était attachée au cercle de proximité,
au collectif et à la communauté d’intérêts. Le sociétaire (ou
l’adhérent) est en principe le personnage-clé du fonctionnement
coopératif. Avec l’internationalisation des banques, les usagers
ne sont plus tout à fait des sociétaires et s’ils le deviennent, ils
ne respecteront pas pour autant les modèles de base du système
coopératif. Dans le cadre d’une croissance des établissements
qui s’accentue et qui dilue les pouvoirs, comment ces usager–
sociétaires pourraient-ils continuer à exercer leur action lors des
assemblées générales en respectant le principe un individu =
une voix, en particulier lorsqu’il s’agit de définir les orientations
stratégiques de la banque ?
La participation aux votes des sociétaires dans les assemblées
générales des caisses locales dépasse rarement 5 %. Seuls la
Nef et le Crédit Coopératif en France ont un nombre de votants
supérieur à 10 %. Ce taux de participation peu significatif
s’explique par la faiblesse de la capacité des sociétaires à
peser sur les décisions et à percevoir un impact immédiat sur
la situation de chacun (A. Rousseau et Y. Regnard, 2011). De
fait, la démocratie représentative l’emporte nettement sur la
démocratie participative.
Concernant le mode de gouvernement, les fonctions de présidence
et de direction sont dissociées. Les sociétaires participent à
l’élection de leurs représentants, c’est-à-dire les administrateurs,
qui vont ensuite eux-mêmes élire un président. La coopérative
peut également retenir dans ses statuts la mise en place d’un
conseil de surveillance et d’un directoire, formule préconisée
pour les sociétés de capitaux. Ce choix conduit le plus souvent
à la professionnalisation très forte des fonctions de direction
et de contrôle et atténue le caractère démocratique du système
coopératif.
Alors que le président est élu au sein d’une fédération parmi
les sociétaires puis parmi les administrateurs, le directeur est
désigné et il est salarié. Il dirige la structure salariée et organise
les activités nécessaires pour mettre en œuvre les orientations
fixées par la structure politique. Dans le cas des banques
coopératives, le président n’est pas porteur de parts sociales. Il
n’exerce pas une fonction ouvrant droit à une rémunération mais
il peut recevoir une indemnité pour le temps et l’énergie déployés.
Cette approche fondée sur le bénévolat ne correspond pas
toujours à la réalité. Ainsi les montants perçus par le président
du conseil d’administration du Crédit Agricole en 2006 se sont
élevés à 288 000 € de rémunération fixe, 16 500 € de jetons
de présence et 141 000 € d’avantages divers (C. Collette et
B. Pigé, 2008).
Les droits individuels permettent formellement à chaque sociétaire
de faire entendre son point de vue mais ces droits ne lui donnent
pas réellement la possibilité de contrôler les dirigeants salariés.
Ce sont en fait ces professionnels qui disposent d’une grande
liberté d’action. Les représentants des sociétaires ne pourront
exprimer un désaveu à l’égard des professionnels que face à
de mauvais résultats économiques. On peut comprendre que
les dirigeants salariés agissent dans le sens des intérêts des
sociétaires dès lors que les primes sont liées aux performances
annuelles ou pluriannuelles. La « technostructure » salariée
prend néanmoins de plus en plus d’importance au regard de la
hiérarchie « politique ».
Certes les conditions d’attribution des primes dépendent d’objec-
tifs quantifiés et fixés au nom des sociétaires ou par le conseil
d’administration. Elles ne dépendent pas des marchés finan-
ciers.
L’entrée en bourse des groupes ou de leurs filiales va pourtant
introduire une composante actionnariale et des liens plus étroits
avec les marchés financiers. Cela a été le cas avec l’introduction
du Crédit Agricole en 2001 ou avec la création de Natixis, filiale
des Banques Populaires cotée en bourse. Le modèle coopératif
en est déstabilisé car il y a bien introduction d’une société
anonyme et apparition de nouveaux agents, les actionnaires. La
croissance externe, en lien direct avec l’introduction en bourse,
produit de nouveaux comportements et de nouvelles approches
en termes d’organisation, de rapport au client, de portefeuille
de produits proposés et de valeurs.
Dans le prolongement de ces logiques, la question cruciale de
l’évolution des fonds propres des banques coopératives a été
soulignée par Sandrine Ansart et Virginie Monvoisin :
« Les normes réglementaires et les nouveaux accords de Bâle III
n’intègrent pas toutes les spécificités des banques coopératives
et risquent de les plonger d’autant plus dans des exigences et des
comportements similaires aux banques capitalistes » (S. Ansart
et V. Monvoisin, op.cit., p.216).
Pourtant, Philippe Naszályi a justement indiqué que les établis-
sements mutualistes comme le Crédit Mutuel, les Banques
Populaires ou le Crédit Agricole disposaient d’un ratio de solvabilité
(ratio Cooke) supérieur à 10 % alors que la norme fixée est de 8
%. De même, le ratio de solvabilité dit « core tier one », présenté
comme pivot de la réforme Bâle III s’établit à 9% pour le Crédit
Agricole, 10% pour PBCE et 11,5% pour le Crédit Mutuel, soit bien
au-dessus des seuils exigés (Ph. Naszályi, 2011). Cela montre
que la forme bancaire coopérative et mutualiste apporte jusqu’à
ce jour les garanties et les sécurités souhaitables.
L’association Attac et Les Amis de la terre viennent de publier en
novembre 2011 un rapport de notation citoyenne des banques.
Ces dernières sont jugées sur leur comportement dans les cinq
domaines d’impact de leur activité : la stabilité financière, leurs
usages-clients, leurs salariés, l’environnement et les populations
locales et la démocratie.
« Deux petits établissements coopératifs, le Crédit Coopératif
et La Nef (qui n’est pas encore une banque à part entière), se
distinguent par leur fidélité à leurs idéaux coopératifs et solidaires.
L’un comme l’autre sont loin devant le reste des banques,
tant par leur prise en compte des conséquences sociales et
environnementales de leurs pratiques, que par leurs politiques
commerciales et de prise de risques. À noter que ces acteurs
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 255-256 – Finance100
Dossier II
Financer autrement ?
mai-août 2012
sont cependant très différents l’un de l’autre : ainsi le Crédit
Coopératif, quoiqu’assez exemplaire sur un certain nombre de
ses politiques, est néanmoins membre du groupe BPCE, qui
a refusé de répondre à notre questionnaire, et fait l’objet de
nombreuses controverses quant à ses pratiques » (Attac et Les
Amis de la terre, 2011, p.1).
Ainsi, avec les nouvelles formes de rationalisation, il semble bien
que l’évolution des structures bancaires ait conduit les technos-
tructures dirigeantes à se professionnaliser. Celles-ci, faisant
alliance avec les technostructures politiques, se sont adaptées
aux finalités de l’économie marchande et aux réglementations
imposées en faisant souvent passer au second plan les valeurs
des élus et donc des sociétaires.
3. Revenir vers le projet coopératif
et opérer des refondations
indispensables
Le modèle coopératif bancaire français puise sa force et sa
légitimité dans le contrôle mutuel des salariés-sociétaires qui
avait su durant de longues périodes se dégager d’une domination
actionnariale étouffante. Durant les quatre dernières décennies,
la déréglementation de l’économie a donné la preuve que la
concurrence généralisée n’était pas le meilleur moyen de créer
des richesses et de les répartir. Elle a affecté et même déstabi-
lisé le secteur de l’économie sociale et solidaire. C’est donc le
mythe de la « concurrence » qu’il faut remettre en question mais
aussi celui de l’agent libre et autodéterminé qui lui est associé. Il
faut enfin revoir la conception de l’entreprise conçue comme un
« nœud de contrats » dont les détenteurs de capitaux seraient
en dernière analyse les seuls propriétaires.
La crise économique et financière récente a produit des effets
délétères qui interrogent l’approche économique standard dont
Léon Walras avait en son temps formulé les grands principes.
Depuis déjà longtemps il était pourtant devenu de plus en plus
manifeste que l’autorégulation (ou l’auto-équilibration) des
marchés ne relevait pas de la science mais plutôt d’un dogme.
Les « marchés » ne sont pas des êtres naturels dans la mesure où
ils sont le produit d’évolutions sociales et historiques complexes
qui engagent de multiples agents porteurs d’intérêts particuliers
mais aussi de nombreuses institutions.
Pour garantir l’existence des marchés, il faut préalablement
des arrangements institutionnels spécifiques. Une transaction
entre deux ou plusieurs agents est d’abord un transfert légal
de propriété avant d’être un transfert physique ou un échange
de biens. Le transfert auquel donne lieu l’échange ne porte sur
des objets que parce qu’il porte sur des droits. Autrement dit,
le marché suppose que les agents acceptent l’existence de
droits de propriété sur les biens qui font l’objet de l’échange.
Ces droits sont codifiés par des institutions et dépendent de
normes et de règles collectives qui s’imposent aux agents selon
des modalités qui peuvent être diverses. Le marché est donc une
institution complexe, non réductible à des relations bilatérales et
qui constitue une relation durable dans le temps. Loin d’être un
fait naturel, il s’agit d’un construit social dont les formes peuvent
être très variées (B. Coriat et O. Weinstein, 2005).
Il en est de même de la notion de « concurrence » qui demande
à être repensée et refondée. On sait que Léon Walras postule un
équilibre entre les demandes des uns et la capacité des autres
à y répondre. Avec Vilfredo Pareto, cet équilibre deviendra « par
nature » à la fois économique et social.
De plus, l’information doit être parfaite et complète comme si les
agents étaient tous omniscients. Or, on sait aussi qu’il existe des
imperfections et des asymétries dans l’information des agents.
Dès lors que l’on admet que les marchés ne sont plus systéma-
tiquement efficients et que la concurrence est souvent déstabi-
lisatrice, il faut admettre dans le même temps que l’intervention
publique peut et doit devenir nécessaire. Enfin le modèle d’un
« agent individuel », pivot de l’équilibre général dont les réactions
seraient prévisibles dans tout contexte et dans toute situation
a été invalidé depuis longtemps.
En fait, nos préférences sont déterminées par le contexte du choix
(le framing effect) ou par notre richesse matérielle (l’endowment
effect). Notre système cognitif réagit plus à des pics qu’à des
évolutions progressives, et l’introduction d’éléments nouveaux
entraîne en permanence une reconfiguration de nos modèles
de choix (J. Sapir, 2006).
L’homo oeconomicus reste cependant une fiction nécessaire à
l’idéologie de la concurrence libre et du marché autorégulateur.
Comme l’écrit Jean-Luc Gréau : « il permet tout autant de maintenir
l’illusion de la réciprocité que de raccommoder le marché avec
la société démocratique » (J.-L.Gréau, 2008, p. 214).
La confrontation quotidienne avec la réalité souligne pourtant
le décalage entre le discours néoclassique et les faits. Les
logiques économiques modernes propres au salariat ne sont
pas compatibles avec la vision d’un monde d’individus libres et
égaux. Dans le cadre du marché du travail par exemple, le salarié
se situe dans un état de dépendance et de subordination vis-à-
vis de l’employeur qui achète son temps et sa force de travail.
Pour valider l’idée selon laquelle les individus sont libres et
rationnels, il fallait construire le personnage fictif de l’homo
oeconomicus en faisant disparaître les agents concrets que
sont les entrepreneurs, les capitalistes, les épargnants, les
consommateurs ainsi que les salariés et les employeurs.
À partir du moment où disparaissaient les agents de l’économie
réelle, il était possible de construire des fictions et des abstrac-
tions c’est-à-dire des discours purement spéculatifs.
La question pertinente est donc celle des règles et des condi-
tions qui permettent à chaque individu concret de rechercher un
intérêt qui soit convergent avec l’intérêt d’autrui et de favoriser
les mobiles qui associent souci de soi et souci d’autrui.
Replacer l’agent au cœur de l’économie signifie clairement que la
liberté individuelle ne peut être le point de départ pour construire
une société solidaire et humaine. Aucun individu ne fixe à partir
de lui seul ses normes de pensée et ses comportements sociaux
car aucun être humain n’est entièrement autodéterminé.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - uqam - - 132.208.30.198 - 26/09/2012 15h14. © Direction et Gestion (La RSG)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%