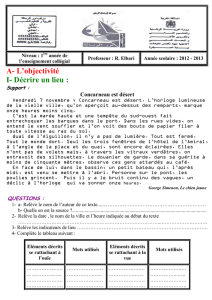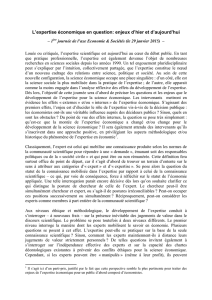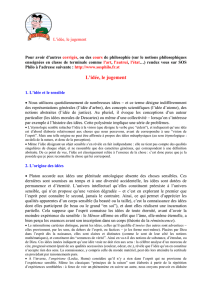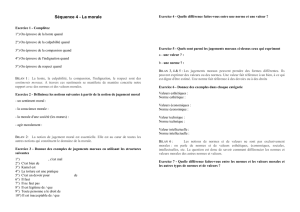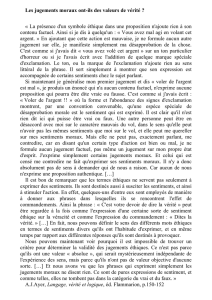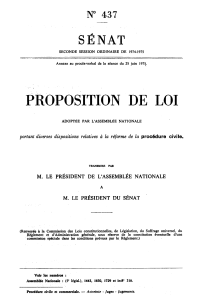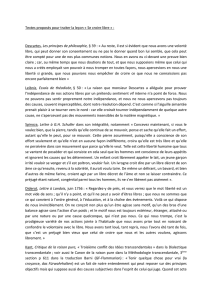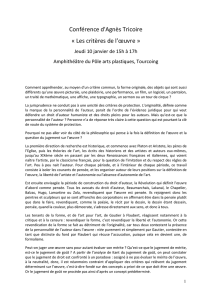Analytique des politiques sociales I: Normativité des

1
Analytique des politiques sociales I:
Normativité des politiques sociales
Séances 4* et 5 - 16 octobre 2008
Enseignant: Jean-François Bickel
*
La séance 4 du 9 octobre a été reportée au 16 octobre
2
Les politiques sociales
et la question de la justice
au croisement de la philosophie morale
et politique et de la sociologie
3
I. Introduction

2
4
Les politiques sociales sont traversées de
jugements moraux du type « X est injuste,
car ... », « il est de la responsabilité de
l’Etat de faire Y, car... », « le dispositif Z
est bon, car... », etc.
Très souvent, ces jugements moraux se
réfère à ce qui est juste ou à l’inverse
injuste
5
En tant qu’objet de jugement moral,
notamment en termes de ce qui est
« juste » ou « injuste », les politiques
sociales d’une part, les situations
auxquelles elles renvoient ou sur
lesquelles elles visent à intervenir de
l’autre, sont susceptibles d’une double
démarche de recherche
6
1) Une première démarche cherche à
définir par le biais de travaux de
philosophie morale et politique un ou
plusieurs principe(s) normatifs qui
l’emporteraient sur d’autres en légitimité
ou en efficacité

3
7
2) Une seconde démarche vise à rendre
compte, à l’aide de recherches
empiriques
a) des normes et valeurs auxquelles
adhèrent les personnes (certaines
valeurs et normes étant cristallisées
dans des politiques sociales)
8
b) des facteurs susceptibles d’expliquer
cette adhésion
c) des conséquences de cette adhésion
pour le comportement des individus et le
fonctionnement des groupes, y compris
lorsque le groupe est une communauté
nationale, voire supra-nationale
9
Souvent ces deux démarches sont
menées séparément, sans communication
entre elles
Sans se confondre l’une avec l’autre, elles
sont pourtant complémentaires, et peuvent
faire l’objet d’un dialogue heuristiquement
fécond

4
Commentaire :
La séparation de ces deux démarches, lorsqu’elle est justifiée, s’appuie sur l’idée générale qu’il
existe une stricte séparation entre le fait et la valeur, et l’argument selon lequel de ce qui est (dont
s’occupe entre autres les sciences sociales, et notamment la sociologie) on ne peut tirer aucune
conclusion relative à ce qui doit être (domaine des théories normatives). On en vient dès lors à
exclure toute possibilité de relations étroites et fécondes entre philosophie morale et politique
d’une part, sciences humaines et sociales de l’autre.
Pour en rester sur le plan philosophique, Ruwen Ogien (2005) montre, de manière
convaincante à mon avis, qu’une telle perspective ignore certains principes du raisonnement
moral : par exemple celui qui veut que l’on traite des cas similaires de façon similaire, ce qui
conduit à devoir prêter attention à ce que sont les cas et à disposer de critères factuels permettant
de distinguer les cas similaires des autres. Et qu’il est également des théories normatives qui
permettent le passage, et même le favorise, entre raisonnement éthique et démarche de sciences
sociales. Il en va notamment ainsi de différentes sortes (i) d’éthiques des vertus, qui s’intéressent
essentiellement à la personne (et accessoirement aux actes et conséquences) et dont la question
principale est « Quel genre de personnes dois-je être ? » ; et (ii) d’éthiques conséquentialistes, qui
se centrent sur les états de choses qu’il faut promouvoir. Dans l’un et l’autre cas, il est possible de
tirer des conclusions normatives à partir de prémisses factuelles sur ce qu’est la personne ou l’état
de chose, ou du moins que les secondes participent de ce qui conduit aux premières.
10
a) La philosophie morale et politique peut
être une source d’inspiration pour la
recherche empirique, par exemple en
portant à l’attention des questions
nouvelles

5
11
b) Elle offre également un cadre de
référence à partir duquel mettre à
distance la réalité sociale dont le
sociologue se fait l’observateur, mais
dans laquelle il est aussi immergé
12
c) A l’inverse, il appartient aux sciences
sociales, et en particulier à la sociologie,
d’une part de questionner les hypothèses
des théories « idéalistes »: ces
hypothèses sont-elles pertinentes? est-
ce bien ainsi que les gens fonctionnent?
etc.
13
d) D’autre part, de montrer dans quels
systèmes de contraintes opèrent les
principes normatifs posés par les
théories; c’est-à-dire évaluer les chances
comparées de divers programmes en
matière morale
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%