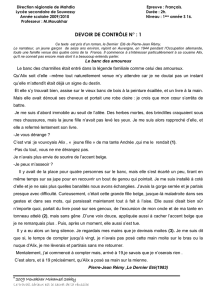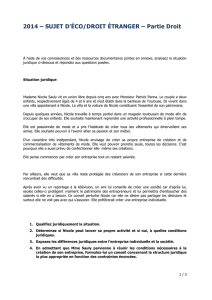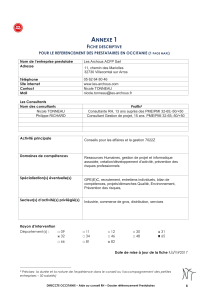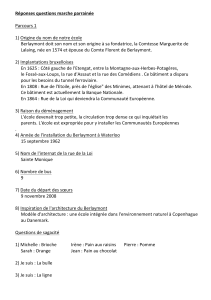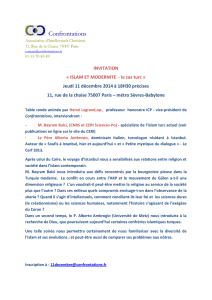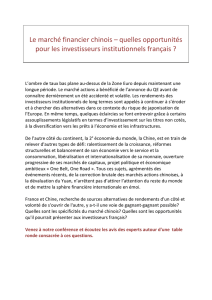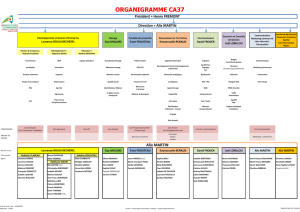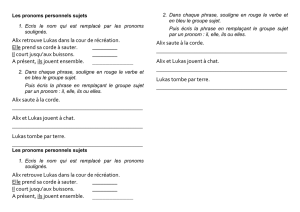Télécharger le compte-rendu dans son intégralité

Nicole ALIX
1
et
PUISSANCE ET LIMITES DES INDICATEURS OU MESURES D’IMPACT :
Objectifs, enjeux, acteurs
SEMINAIRE CDC/Confrontations Europe
10 février 2015 15h-19h30
Isabelle Laudier, responsable de l’Institut CDC pour la Recherche, accueille Confrontations Europe et
les intervenants, qu’elle remercie de s’intéresser à un sujet transversal à plusieurs entités de la Caisse
des Dépôts : le département stratégie de la CDC, où se situent le département ISR et l’Institut pour la
Recherche, ainsi que le Département Développement Economique et Economie Sociale et Solidaire, à
la recherche d’indicateurs de développement durable dans les territoires. Guillaume Couarraze, au
nom de Géraldine Walter qui dirige désormais ce département, apprécie l’ouverture européenne et
le décloisonnement du sujet au-delà de la seule Economie sociale et solidaire (ESS), dont le rôle
contracyclique sur l’emploi et le développement durable mériterait de « percoler ».
L’impact social lui paraît au croisement du long terme et l’intérêt général. Un nouveau chapitre de
l’histoire de l’ESS s’ouvre peut-être : la loi de 2014 lui accorde une reconnaissance et, en même
temps, introduit des critères tels que l’utilité sociale, dans un univers sous contrainte financière. La
mesure de l’impact social fournira-t-elle le langage de la preuve ? Au regard de son expérience sur la
création d’entreprises, la CDC mesure toute la complexité de ce type de questions.
La "mesure" de l’impact social est censée permettre aux investisseurs, privés et publics, de disposer
des outils qui leur ont manqué jusqu’à présent pour guider leurs affectations budgétaires et
financiers et, notamment, des investissements sociaux dans un contexte de raréfaction de ressources
publiques.
DECRYPTAGE DES TRAVAUX SUR LA MESURE D’IMPACT SOCIAL AU PLAN EUROPEEN
Décryptage à deux voix des travaux sur la mesure de l’impact social au plan européen et
international, Nicole Alix, en charge de l’ESS au sein de Confrontations Europe et Antonella Noya,
analyste senior à l’OCDE/LEED.
De la définition de l’entreprise sociale à la mesure d’impact
Nicole Alix indique qu’il ne s’agit pas de traiter toutes les questions sur l’évaluation, mais de croiser
celles qui ont trait à la mesure et à l’investissement, concomitantes aux évolutions de 4 mondes :
monde de l’évaluation, monde bancaire et financier, politiques publiques, monde de l’économie
sociale et des entreprises sociales.
(cf schéma http://www.confrontations.org/images/confrontations/Conference/2015/2015-02-
Nicole-Alix-Puissance-limites-mesures-impact.pdf).

Nicole ALIX
2
L’Initiative pour l’entrepreneuriat social de la Commission européenne, en octobre 2011, a écarté
toute « définition normative qui déboucherait sur un corset réglementaire » de l’entreprise sociale
pour retenir une définition en 3 dimensions :
- un objectif social ou sociétal d'intérêt commun, raison d'être de l'action commerciale,
- des bénéfices principalement réinvestis dans la réalisation de cet objet social,
- un mode d'organisation ou système de propriété reflétant la mission (principes démocratiques ou
participatifs, ou visant à la justice sociale).
L’Acte pour le Marché unique I d’avril 2011 préconisant d’« utiliser le formidable levier financier que
constitue l'industrie européenne de la gestion d'actifs», l’Acte pour le Marché unique II d’octobre
2012 propose de « se mettre d’accord sur de nouveaux outils pour montrer … l’impact positif qu’ont
les entreprises sociales ». « Une méthode pour mesurer les gains socio-économiques qu’elles
produisent » requiert des « outils rigoureux et systématiques {pour} mesurer l’impact des entreprises
sociales sur la communauté {sans bureaucratie}, pour démontrer que l’argent investi dans celles-ci est
source d’économies et de revenus importants ».
Finalement, au sens du règlement EuseF (European Social Entrepreneurship Funds) d’avril 2013, est
une entreprise sociale une entreprise qui :
• ii) a pour objectif principal (statuts ou tout autre document constitutif) de produire des effets
sociaux positifs et mesurables, pour autant que l'entreprise :
– fournisse des biens ou des services à des personnes vulnérables, marginalisées,
défavorisées ou exclues,
– utilise une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation
de son objectif social, ou
– apporte un soutien financier exclusivement aux entreprises sociales
• iii) utilise ses bénéfices, avant tout, pour atteindre son objectif social principal (…) de telle
façon que les distributions de bénéfices ne compromettent pas son objectif essentiel ;
• iv) est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par
l'association de son personnel, de ses clients et des parties prenantes concernés par ses
activités économiques.
Le Programme for Social Change and Innovation (EaSI, juil. 2013, microfinances et entreprise sociale),
qui vise à « développer l’innovation sociale par « la collecte de données sur sa faisabilité »,
« élaboration d’outils et de méthodes statistiques », « mise en place d’indicateurs communs », fondés
« sur des critères qualitatifs et quantitatifs », indique (art 25) que « l’entreprise devra fournir des
informations sur ces activités et ses résultats, y compris en termes de… impact social, création
d’emploi et soutenabilité ».
Le GECES, groupe d’experts sur l’entreprise sociale mis en place par la Commission européenne, a
donné en 2014 un « cadre commun » de référence européen pour la mesure de l’impact social :
• l’impact social (par différence avec les concepts de production ou de résultat ) est la «
mesure des conséquences sociales à court et long terme d’une organisation corrigées des
effets attribuables à d’autres (‘alternative attribution’), de ceux qui se seraient produits en
tout état de cause (‘deadweight’, effet d’aubaine), des effets négatifs indésirables
(‘displacement’) et de ceux qui diminuent avec le temps (‘drop off’) (Trad. NA).
• Il se définit en 5 étapes : identifier objectifs, parties prenantes, types de mesure ; mesurer,
valider, évaluer ; rendre compte et améliorer.
Désormais, un marché de « l’impact investing » tente de se structurer. Les "nouveaux entrants »
(groupes de la finance internationale, banques d’affaires, fondations américaines et acteurs de la
nouvelle philanthropie) sont les principaux promoteurs de l’Impact Investing, qui se définit ainsi « Les
Impact investments sont des investissements dans des sociétés, des organisations et des fonds dans

Nicole ALIX
3
l'intention de générer un impact social et environnemental mesurable aux côtés du rendement
financier. Ils peuvent être faits dans des marchés émergents ou développés et visent des rendements
qui vont d'au-dessous du marché au taux du marché, en fonction des circonstances" (thegiin.org).
Dans un document considéré comme fondateur, JP Morgan fait de « l’impact investment » une
catégorie d’actif à part entière (et donc un nouveau marché), qui nécessite des techniques de
management spécifiques et des « experts » de l’impact investment, avec des instances de régulation
propres (le GIIN), des indicateurs (GIIRS) et une mouvance d’entrepreneurs, alimentés par des
conférences, de la formation ….
A l'initiative du Royaume-Uni, le G8 a créé une « taskforce » sur "l'impact investing", à laquelle la
France a participé (cf intervention de Hugues Sibille, qui a présidé le groupe de travail français). Pour
« catalyser le marché mondial de l’investissement à impact social » pour « changer la vie des pauvres
dans le monde »
1
, des recommandations pratiques ont été livrées en septembre 2014 afin de créer
une communauté internationale et des références communes, mieux comprendre le potentiel du
marché et d’« aller vers la standardisation de la mesure d’impact ». A la définition du GECES, le G8 a
ajouté deux critères (le social et l’environnement) et la référence à la chaîne de création de l’impact
(‘impact value chain’, identifier liens causaux).
Enfin, l'emploi du terme « investissement social » s’étend dans les institutions publiques, avec le
même corollaire : la nécessité de la mesure d'impact. Commentant le paquet « Social investment
package for growth and cohesion » (Commission européenne, 2013a, non traduit), le directeur de la
DG Emploi de la Commission européenne évoque « l’Etat investisseur social, héritier de l'Etat
providence". Plusieurs documents de travail de la Commission font référence à la notion de
"portefeuille de projets"
2
sociaux. Le financement public comme le don sont souvent assimilés à des
investissements, dans une approche relevant du "capital risque" : stratégie de sortie de la part de
l'investisseur et mesure de l'impact, avec reporting et rating (notation) méthodiques.
L’analyse de la complexité :
Antonella Noya présente les résultats de l’analyse menée à la demande de la Commission
Européenne sur les mesures d’impact social à partir des travaux menés par le groupe de travail du
GECES (Groupe d’experts sur l’entreprenariat social) institué par la Commission Européenne et ceux
menés par la Task Force G8. On peut constater que :
- un consensus sur la notion, les pratiques et méthodes de mesure de l’impact social est encore loin
d’être trouvé, même si les débats qui ont lieu au niveau international et dans les différents pays
pourront contribuer à établir une vision plus partagée ;
- le champ des mesures d’impact social est en construction, tout comme celui de la définition
d’entreprise sociale elle-même. Il est donc judicieux que la mise en oeuvre des mesures d’impact
social se fasse en parallèle avec celle de la reconnaissance formelle et de la règlementation de
l’entreprise sociale, ce qui n’est pas encore le cas dans tous les pays de l’Union européenne. Une
certaine prudence est donc nécessaire ;
- les discussions et les décisions sur les mesures d’impact social ne doivent pas être principalement
orientées par les besoins des investisseurs privés, mais plutôt résulter d’un processus de dialogue
entre les différentes parties prenantes concernées et, notamment, les acteurs publics, les
bénéficiaires des activités des entreprises sociales ainsi que les usagers et les entreprises sociales
elles-mêmes ;
1
“G8 Social Impact Investment Forum, Outputs and Agreed Actions », Cabinet Office, G8 UK, juillet 2013. P. 3
et p.7.
2
cf « Strengthening social innovation in Europe; journey to effective assessment and metrics», 2012 ; « A better
Future : results of the network for better future of social economy », 2012 ; « Financing social impact ; funding
social innovation in Europe-mapping the way forward », 2012.

Nicole ALIX
4
- le choix des métriques à utiliser ne devrait pas être fait «a priori » mais être lié à l’objectif qui
justifie la mesure. Or, dans la majorité des cas, cet objectif dépendra des besoins d’information des
différentes parties prenantes avec lesquelles les entreprises sociales travaillent. La métrique à uti
liser devrait donc être décidée en accord avec l’entreprise sociale sur la base d’un dialogue avec
toutes les parties prenantes concernées et non pas imposée par une ou plusieurs parties prenantes.
Cela veut dire que l’on ne mesure pas de la même manière l’impact social d’une entreprise sociale
pour les besoins :
- des investisseurs privés (et notamment ceux qui font de l’impact investing), qui sont généralement
aussi intéressés à un retour financier de leur investissement ;
- des financeurs publics qui cherchent souvent à comprendre l’allocation la plus efficace des
ressources publiques ;
- de la communauté locale qui demande l’évaluation pour connaître le niveau de satisfaction des
bénéficiaires des services offerts par l’entreprise sociale.
Pour montrer cela l’OCDE, dans le policy brief préparé
3
, a analysé trois exemples concrets montrant
les forces et faiblesses de chaque méthode utilisée :
- une métrique d’analyse de coûts/bénéfices classique, mais adaptée aux spécificités des entreprises
de réinsertion professionnelle des publics en difficulté en Italie, pour montrer les gains pour
l’autorité locale qui finance ces entreprises,
- le système de rating du Comptoir de l’Innovation Sociale en France qui répond aux besoins des
investisseurs privés,
- le système de Social Accounting and Audit (audit social) dans une entreprise de communauté
anglaise.
Les trois méthodes se sont révélées chacune appropriée par rapport aux besoins auxquels elles
répondaient, mais pas parfaites en soi. La même entreprise peut donc utiliser différentes
méthodologies selon les parties prenantes avec lesquelles elle interagit.
Le Policy Brief souligne enfin qu’il n’existe pas encore une culture généralisée de la mesure de
l’impact social et que, pour accompagner la création de cette culture –qu’il est nécessaire d’acquérir-
il faut encourager les expérimentations, tout en sachant aussi que les entreprises sociales et les
organisations d’économie sociale souvent n’ont pas les moyens financiers et humains pour s’engager
rapidement dans la mesure de l’impact social. Or, mesurer l’impact social est une des tâches les plus
difficiles dans les sciences sociales et requièrt des compétences spécifiques.
Le Policy Brief rappelle aussi l’importance du respect du critère de proportionnalité. Il faut mesurer
seulement si cela contribue effectivement à la prise de décision et si les coûts des mesures ne
dépassent pas les bénéfices que l’on peut en retirer. Enfin, il soulève une série de questions
problématiques liées aux mesures d’impact social :
- comment s’assurer que les mesures d’impact social aident les entreprises sociales à augmenter leur
impact et puissent donc être plutôt des sources ultérieures de création de valeur (les ES n’ont pas
attendu d’être mesurées pour produire de la valeur sociale) plutôt que d’être considérées seulement
comme un outil de mesure et reporting ?
- comment éviter que les mesures d’impact social ne pénalisent l’innovation sociale en imposant des
lignes directrices trop rigides et en incitant comme conséquence les entreprises sociales à choisir des
objectifs sociaux plus faciles à réaliser ?
- comment éviter que les impacts difficiles à mesurer, car ils se produisent dans un temps éloigné ou
car il s’agit d’impact intangibles, ne découragent les entreprises sociales à s’investir dans des activités
qui sont certes difficiles à mesurer mais importantes socialement ?
- comment être certains que le critère de proportionnalité est respecté ?
3
http://www.oecd.org/cfe/leed/PB-SIM-Web_FINAL.pdf

Nicole ALIX
5
- comment être certains que les entreprises sociales ont les ressources nécessaires pour mesurer
l’impact social ?
- comment s’assurer que les besoins des investisseurs et des entreprises sociales soient cohérents et
compatibles ?
Antonella Noya conclut en soulignant qu’il s’agit de questions importantes que les décideurs publics
devraient considérer quand ils réfléchissent – comme ils devraient le faire- à l’impact des mesures
d’impact (et de l’impact investing aussi) sur le développement futur du secteur social au sens large.
Pourquoi favoriser des investissements à impact social et comment innover financièrement pour
innover socialement ?
Hugues Sibille, président du Comité français sur l’investissement à impact social dans le cadre du G8,
relève qu’un débat est nécessaire sur ces sujets : le monde change, la poursuite de l’intérêt général
est désormais répartie entre différents acteurs ; les résultats sociaux n’ont pas, par ailleurs, toujours
été à la hauteur de ce qu’on avait escompté.
Des investisseurs souhaitent allier retour social et retour financier et ont ainsi besoin que l’impact
soit mesurable de façon continue. Se différenciant de l’investissement socialement responsable, ils
visent des entreprises dont le social est le cœur de métier.
Les entreprises d’insertion par l’économique ont démontré que 1€ investi chez elles font revenir 2,3€
dans les caisses de l’Etat. Alors que le coût moyen d’un chômeur est de 14 000 €, le poste d’insertion
est subventionné à 10 000 €. Ces mesures contribuent à leur apporter du soutien.
L’investissement à impact social vise un effet levier, un co-investissement :
- l’argent n’est pas perdu, au contraire de la subvention (même s’il faut rappeler qu’on a besoin des
deux, bien sûr).
- c’est un système qui associe plusieurs parties prenantes de nature différente, dont l’Etat et les
collectivités locales ou pas.
- l’engagement est à 3 ou 5 ans, soit mieux que l’actuelle instabilité des financements publics
- le processus peut générer de la co-production entre différentes parties prenantes.
C’est tout un processus (pas une procédure), qui repose sur une méthode de mesure du point de vue
des bénéficiaires. Il ne peut pas être à la main des financiers, dont l’expérience, Hugues Sibille peut
en témoigner, n’est pas adaptée. C’est aux acteurs sociaux de faire le travail. Le rapport du GECES
(cité ci-dessus) n’est pas normatif, puisqu’il laisse les parties prenantes se mettre d’accord, en évitant
que les besoins des financiers prévalent. En ce sens, Hugues Sibille s’est opposé à l’idée de la création
d’une nouvelle classe d’actifs.
En tout état de cause, il faut regarder les difficultés, s’en parler, dans une visée de co-production.
Cf http://www.confrontations.org/images/confrontations/Conference/2015/social-impact/2015-02-
Hugues-Sibille-social-impact-investlent.pdf
Questions des participants :
Hicham Aichi, entreprise d’insertion et étudiant au CNAM : faut-il accepter la notion de performance
dans le social, y compris dans la production de connaissances ? comment décliner la question de la
mesure sur un territoire ? comment hybrider les ressources ?
Anne Ramonda, E&Y : comment amorcer la pompe pour que les entités elles-mêmes ne soient pas
dépendantes des financiers ? le mouvement patine, qui est prêt à financer les recherches, sans
produire des usines à gaz ? le système d’information a un prix, qui va payer ? notamment dans les
petites structures ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%