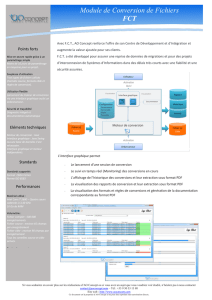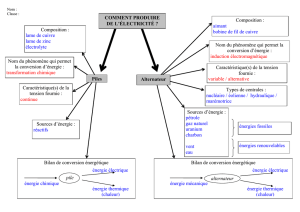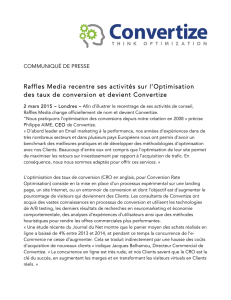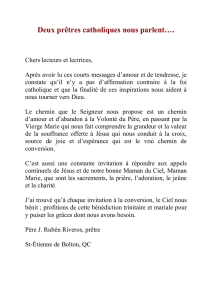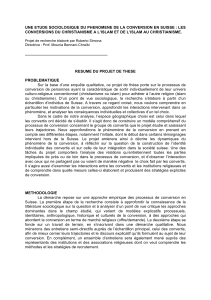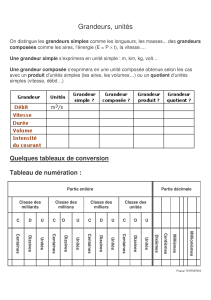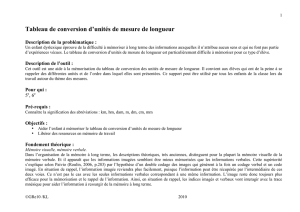Atelier

Conversion et engagement social et politique
Organisateurs :
Géraldine Mossière, Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de
Montréal
Christophe Monnot, Université de Lausanne Institut de sciences sociales des religions
contemporaines (ISSRC) et Arbeitsgruppe für Empirische Religionsforschung, Université de
Berne
Loïc Le Pape, IDEMEC (Institut d'ethnologie européenne, méditerranéenne et comparative,
AMU-CNRS)
Les phénomènes d’individualisation et de mobilité religieuses contemporains ont fait des
conversions un archétype des mutations des sociétés, concentrées dans les registres
spécifiques du social et du symbolique. Le phénomène jouit pourtant d’une grande
profondeur historique, et a traditionnellement été abordé comme le fruit d’un rapport de
pouvoir entre groupes majoritaire et minoritaire, mené dans le cadre de conflits guerriers,
de compétitions économiques ou d’invasions culturelles (islamisation, évangélisation, etc.).
Dans les années 1970, l’apparition des nouveaux mouvements religieux (NMR) au sein de
sociétés sécularisées a suscité de nouvelles approches axées sur les facteurs sociologiques
et psychologiques pouvant expliquer les changements de religion, les diverses tentatives de
systématisation du geste de conversion s’appuyant parfois sur l’hypothèse de fausse
conscience du converti. D’autres études se sont intéressées aux conversions évangéliques,
particulièrement sous l’angle du récit de conversion et de l’usage de standards discursifs.
Récemment, la pluralité des sociétés modernes forçait à considérer les changements de
religion comme un des multiples avatars de la diversité religieuse. Activée par les brassages
d’idées et de populations permises par la globalisation, la conversion amène à réorganiser
les liens sociaux : l’appartenance se construit et se raconte au sein d’un nouveau groupe
doté de structures et de modes de différenciation spécifiques tandis que les frontières
sociales se redessinent autour de nouveaux marqueurs.
Peu d’études ont examiné le changement de vision, d’idéal et d’agir social que la
modification de croyances et de pratiques religieuses du quotidien pouvait induire. Il ne
s’agit pas ici de focaliser sur la radicalisation comme figure contemporaine de la conversion
dans un monde fluide, mouvant, impalpable et contradictoire (elle n’en représente qu’une
forme marginale quoique frappante). Nous proposons de comprendre la conversion comme
le produit d’un contexte social dont les convertis se pensent et se décrivent comme vecteurs
de changement. Notre lecture de la conversion religieuse articule donc les motivations aux
intentions sociales, tout comme les récits de vie articulent biographie personnelle et
intégration dans une communauté (qui peut être idéelle). Si l’analyse englobe, sans s’y
limiter, les conversions à l’islam et les phénomènes de radicalisation, elle vise avant tout les
contextes, idéaux, activismes, isolements sociaux et récits qui gravitent autour de l’adoption
d’une nouvelle religion. En somme, l’atelier que nous proposons apportera un regard
critique face aux significations politiques et sociales qu’endossent les gestes de conversion,
dans leur variabilité et complexité.

Notre atelier comprendra deux volets : dans un premier temps, les présentations de
conférenciers invités (confirmés), puis des présentations sélectionnées suite à un appel à
présentations diffusé via le site de l’AISLF.
Participants :
Le Pape, Loïc, « Stigmates. Les usages sociaux de la conversion religieuse », IDEMEC
(Institut d'ethnologie européenne, méditerranéenne et comparative, AMU-CNRS)
Monnot, Christophe, « Le témoignage de conversion est-il une donnée fiable pour les
sciences sociales? », Université de Lausanne Institut de sciences sociales des
religions contemporaines (ISSRC) et Arbeitsgruppe für Empirische
Religionsforschung, Université de Berne
Allievi, Stefano, « Changer de religion pour changer le monde. Militants et activistes
convertis à l’islam : pourquoi ? pour quoi faire ? », Département de philosophie, de
sociologie, d’éducation et de psychologie appliquée, Université de Padoue
LeBlanc, Marie-Nathalie, « Les enjeux sociaux de la "re-conversion": regard croisé
sur deux générations de jeunes musulmans en Côte d'Ivoire »
Mekki-Berrada, Abdelwahed, Département d’anthropologie, Université Laval
« Radicalisation et contemplation en islam »
Tank-Storper, Sébastien, CNRS, Paris « Entrer par la gauche, arriver par la droite ?
Parcours politiques de convertis au judaïsme en France ».
Hamel-Charest, Laurence, Département d’anthropologie, Université de Montréal,
« Croire pour guérir le social: dynamiques interculturelles et conversions chez les
Anicinabek du Québec »
Commentateur/discutant : Mossière, Géraldine, Faculté de théologie et de sciences des
religions, Université de Montréal.
1
/
2
100%