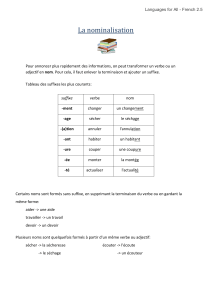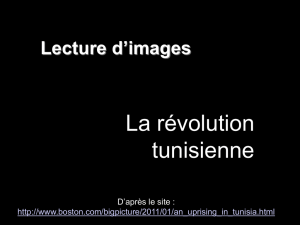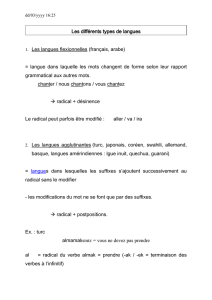as a PDF

Une langue du Nord-ouest amazonien : le barasana
Elsa Gomez-Imbert*
Plusieurs caractéristiques font du barasana une langue singulière. En voici des
exemples. La nasalité n’y est pas un trait phonémique mais morphémique,
propriété relevée à ce jour dans peu de langues en dehors de l’aire amazonienne1.
Les tons forment un système interprétable, soit comme des mélodies tonales, soit
comme de l’accent tonal (ce qui rappelle certaines langues bantoues ainsi que le
japonais), dont une des complexités majeures est l’existence de préfixes tonals
sans support segmental. Du côté segmental, la dynamique des processus saillants
— épenthèse et gémination vocaliques, fusion consonantique — trouve sa
cohérence dans une analyse de la structure prosodique où les unités de base sont
des mores. Notez que ces propriétés phonologiques résistent aux approches
structurales classiques. Il y a deux classes de mots : nom et verbe. Le verbe a un
système élaboré de marqueurs de modalité cognitive, qui offre au locuteur le
choix d’exprimer : une connaissance directe, constat plein (visuel) ou restreint
(non visuel, auditif de préférence) ; ou bien une connaissance indirecte,
événement inféré (traces visuelles) ou rapporté (traces auditives). Les mots
nominaux sont marqués par un paradigme important de morphèmes, appelés
traditionnellement classificateurs, que la phonologie partage en fait entre des
racines et des suffixes d’après leur structure en mores. L’ordre de base des
constituants de la phrase est OVS, ordre typologiquement rare. Enfin, le rôle de
langue identitaire que le barasana partage avec une quinzaine d’autres langues
apparentées, dans un système d’exogamie linguistique où la filiation patrilinéaire
est marquée par l’usage de la langue paternelle, est exceptionnel.
On se limite dans cette présentation sommaire à une ébauche de quatre points :
1) l’exogamie linguistique, 2) la nasalité, 3) les préfixes tonals qui marquent la
personne grammaticale, 4) l’ordre des constituants de la phrase2.
1. EXOGAMIE LINGUISTIQUE
Les groupes de la branche orientale de la famille linguistique tukano sont connus
dans la littérature ethnographique par leur exogamie linguistique et le
* ERSS, UMR 5610, CNRS et Université Toulouse-Le Mirail.
1 En gokana (Hyman 1982) et dans d’autres langues d’Afrique de l’ouest (Clements &
Osu, à paraître).
2 Pour un traitement des caractéristiques énumérées voir Gomez-Imbert (1997a) ; pour la
structure prosodique voir aussi Gomez-Imbert (1997b).

2 Laurent Danon-Boileau
multilinguisme généralisé qui en est le corollaire3. Les Barasana, qui habitent
dans le bassin de la rivière Piraparaná en Colombie (affluent de l’Apaporis), sont
un de ces groupes exogames. Leur vrai nom est ~hadérá, ou encore jebá-~baca
‘gens de Jebá’, d’après le nom de leur ancêtre mythique, le jaguar Jebá4. Les
Barasana sont estimés à cinq cents sujets, mais le nombre de locuteurs potentiels
de leur langue se situe au delà de ce chiffre, car les sujets de langue maternelle
barasana ne sont pas comptés comme des Barasana. Observez la figure (1) qui
schématise la filiation paternelle et les alliances entre trois groupes linguistiques
partenaires dans l’exogamie : les Barasana (dessin sur fond clair), les Tatuyo
(dessin sur fond foncé) et les Bara (noir). Suivez d’abord dans le schéma la ligne
de filiation ascendante des deux familles nucléaires barasana de la plus jeune
génération, celle de la couche du bas : leurs pères et leurs grand-pères paternels
sont Barasana, leurs mères sont Tatuyo. Suivez ensuite la ligne de filiation des
familles tatuyo et bara de la couche suivante ; en remontant à la génération de
leurs parents, vous constatez que les mariages se font entre partenaires de lignage
paternel différent : si l’homme est Bara la femme est Tatuyo ; si l’homme est
Tatuyo la femme est Bara ou Barasana.
Que la filiation soit patrilinéaire est un fait banal ; ce qui l’est moins est la
fonction dont sont investies les langues comme repère de cette filiation. La
langue est conçue par ces groupes comme l’expression de l’essence d’un
individu, c’est-à-dire de l’identité héritée par lignage paternel : la langue
paternelle est promue alors au rôle de langue identitaire que l’on exhibe comme
un document attestant l’origine. Voici comment l’enfant arrive à abandonner sa
langue maternelle pour parler exclusivement sa langue paternelle. Comme dans
la plupart de sociétés, l’enfant grandit auprès de sa mère et apprend d’abord sa
langue maternelle. L’unité résidentielle où il vit, village ou maison commune, est
patrilocale et linguistiquement hétérogène, puisque les épouses viennent d’autres
groupes linguistiques et parlent chacune sa langue paternelle, langue qui peut
être commune à plusieurs d’entre elles. Les conditions d’acquisition ainsi créées
sont particulières : l’enfant est exposé à la langue maternelle et à la langue
paternelle durant ses premières années, mais de façon inégale car il vit davantage
dans l’intimité du monde féminin de la mère et des autres femmes du groupe
local. Vers l’âge de cinq ans l’enfant est conduit à n’utiliser que sa langue
paternelle, par des arguments du genre : “ Puisque tu es Barasana tu dois parler
3 Leur territoire traditionnel est localisé dans le Nord-ouest amazonien en Colombie (le
Vaupés) et au Brésil (le Uaupés). Les noms qui identifient couramment ces groupes sont :
bara, barasana, desano, edúuria (ou taiwano), karapana, kubeo, makuna, piratapuyo,
pisamira, siriano, tanimuka, retuama, tatuyo, tukano, tuyuka, wanano, yuruti. La famille
tukano est divisée en deux branches, occidentale et orientale, qui n’ont pas de contact
actuellement. La branche occidentale est localisée dans le Sud-ouest colombien,
l’Equateur et le Pérou. Le nom donné à la famille est celui d’une langue de la branche
orientale.
4 Leur langue est appelée ~hadérá oká ‘langue des ~hadérá’. Le tilde préposé à un
morphème indique que ce morphème est nasal. Tous les segments du nom ~hadérá se
prononcent nasals [hèaèn :e@è\èa@è] ; la nasalité est souscrite de façon à permettre
une notation aisée du ton.

Une langue du Nord-ouest amazonien : le barasana 3
la langue des Barasana ”. La langue paternelle devient ainsi celle que tout
homme ou femme doit utiliser car elle marque son identité sociale : relations
familiales, alliances et échanges de toute sorte. Ce modèle d’exogamie
linguistique est explicitement considéré comme la norme à suivre dans les
mariages : épouser quelqu’un de même langue paternelle relève d’une relation
incestueuse.
(1)
Ce contexte d’acquisition — ainsi que les voyages, que ces groupes affectionnent
— produisent une société polyglotte, où les langues sont employées néanmoins
de façon spécifique : celle du père de façon active, les autres — y compris celle
de la mère — de façon passive5. On passe à une langue autre que celle du père
5 La différence de statut de la langue paternelle et des autres langues est marquée par
l’emploi de deux verbes différents : un individu ne peut ‘parler’ ~jagó-re que sa langue
paternelle ; quant aux autres langues, y compris la langue maternelle, il ne peut que les
‘imiter’ kecóó-ré. Pour des détails sur l’exogamie voir Sorensen (1967), Jackson (1983),
Gomez-Imbert (1991, 1996). Il y a deux ouvrages ethnographiques sur les Barasana : C.
Hugh-Jones (1979) et S. Hugh-Jones (1979).

4 Laurent Danon-Boileau
lorsque celle-ci n’est pas comprise par l’interlocuteur, en cherchant un terrain
d’entente. En dehors du Piraparaná, et en particulier côté brésilien, la langue
tukano est devenue langue générale, en grande partie grâce aux missionnaires et
à l’école. Si jamais il y avait une langue générale dans le Piraparaná, ce serait
sans doute le barasana. L’inventaire des langues connues par une personne
(surtout âgée aujourd’hui de plus de quarante ans) se situe autour de la dizaine.
La conséquence de ce contact étroit entre langues est que certaines — en général
celles parlées par des groupes qui entretiennent des relations d’exogamie
préférentielles — se différencient minimalement. Un cas extrême est celui du
parler des Barasana et des Edúuria, qui se distingue essentiellement par les tons
(Gomez-Imbert 1999).
Bien que des ethnologues et des linguistes se soient intéressés de près à
l’exogamie, on est encore loin d’une réelle compréhension de certains aspects, en
particulier du processus d’acquisition des langues. Des psycholinguistes y
trouveraient d’ailleurs un terrain unique pour tester des hypothèses sur
l’acquisition par l’étude des réactions aux langues des bébés élevés en milieu
bilingue, voir multilingue) comme celles décrites dans Mehler (1998). Ils nous
aideraient à mieux comprendre la relation entre ces langues. On aimerait savoir
l’âge où un bébé est capable de distinguer le barasana du tatuyo, le barasana du
bara. Savoir si un nouveau-né est sensible à la différence entre la langue des
Edúuria et la langue des Barasana, c’est-à-dire aux tons, puisque les bébés
auraient tendance à se concentrer sur la mélodie des langues. Enfin, avoir la
confirmation que la langue maternelle est bien la langue dominante et la langue
paternelle, celle qui sera utilisée quotidiennement par l’adulte, la deuxième
langue.
2. NASALITE
Il y a en barasana des sons orals et des sons nasals comme en français : b, a, m,
ã. Mais, à la différence du français, les combinaisons bã ou ma n’y sont pas
attestées ; seules ba et mã sont possibles. La nasalité, phonétiquement
omniprésente, imprègne des suites de segments, deux au minimum, qui sont soit
des mots entiers soit des morphèmes, lexèmes ou suffixes. On arrive en fin de
compte à réduire le système à six voyelles et onze consonnes orales (2)6. La
nasalité phonétique résulte de la diffusion d’un trait autosegmental propre au
morphème (suprasegment ou prosodie en termes plus traditionnels). (C)V(V) est
la syllabe canonique.
(2) Segments
a. voyelles
i
i
u
e
a
o
[haut]
+
+
+
-
-
[arrière]
-
+
+
-
+
+
[arrondi]
-
-
+
-
-
+
6 La voyelle i étirée, haute et d’arrière est semblable à celle du japonais.

Une langue du Nord-ouest amazonien : le barasana 5
b. consonnes
labial
coronal
[+ant]
coronal
[-ant]
dorsal
laryngal
[-résonant][-voisé]
[-continu]
p7
t
c
k
[+continu][glotte ouverte]
h
[-résonant][+voisé]
[-continu]
b
d
j
g
[+résonant][+continu]
w
r
On ne trouve dans le lexique que des oppositions entre racines orales [-N] et
racines nasales [+N], comme celles présentées en (3). Certains suffixes sont
variables, tantôt orals et tantôt nasals, suivant la propriété du constituant qui se
trouve en amont dans le mot : c’est le cas de -re et -ce en (3)8. La nasalité propre
aux racines de la colonne (3b), indiquée dans la transcription phonologique par
un tilde préposé, nasalise tous les segments de ces racines et du suffixe, hormis
les segments sourds [-voisé] : les voyelles a → [ã] etc. ; les consonnes plosives
voisées /b/ → [m] /d/ → [n] /j/ → [ñ] /g/ → [η], les résonantes /w/ → [w], /r/ →
[r] et l’aspiré laryngale [h]9.
(3) a. Racine orale [-N] / b. Racine nasale [+N]
/b/ báá-ré [baá-ré] ‘nager’ ~báá-ré [mããre´] ‘saisir par poignées’
bíbí-ré [ ] ‘ciller’ ~bibí-ré [ ] ‘sucer’
/d/ widí-ce [wid:íce] ‘broussailleux’ ~widí-cé [ ] ‘senteur’
tudí-ré [ ] ‘retourner’ ~túdí-ré [ ] ‘pondre (poissons)’
/j/ júu-re [ ] ‘avaler’ ~júu-re [ ] ‘viser’
jaá-ré [ ] ‘bâiller’ ~jaá-cé [ ] ‘maladie’
/g/ cígé-ré [ ] ‘pincer’ ~cígé-ré [ ] ‘frotter’
gidá-ré [ ] ‘excrément-O’ ~gidá-ré [ ] ‘déféquer’
/w/ waá-ré [ ] ‘fendre (objet rond)’ ~waá-ré [ ] ‘saigner’
weá-ré [ ] ‘déboucher’ ~weá-ré [ ] ‘suspendre (hamac)
/r/ wáré-ré [ ] ‘frôler, caresser’ ~wáre-re [ ]‘veiller, être éveillé’
ruú-ré [ ] ‘noyer’ ~ruú-ré [ ] ‘égréner’
/t/ tiá-ré [ ] ‘coudre’ ~tíá-ré [ ] ‘nourrir le feu’
/c/ ciá-ré [ ] ‘nouer, attacher’ ~cíá-ré [ ] ‘tuer’
/k/ boká-re [ ] ‘rencontrer’ ~boká-re [ ] ‘s’envoler’
/h/ hahá-ré [ ] ‘se redresser’ ~hahá-ré [ ] ‘entrer (dans affluent)’
cahá-cé [ ] ‘consommable’ ~cahá-ré [ ] ‘entrer’
Les suffixes variables, non spécifiés [øN], apparaissent en fin de mot jusqu’à
trois successifs (4a,b). La diffusion de la nasalité se fait progressivement dans le
7 /p/ n’apparaît en surface que dans des idéophones et des emprunts ; /p/ intervient aussi
dans un processus de fusion consonantique qui aboutit à /h/ en surface.
8 Les racines verbales sont présentées à l’infinitif, forme de citation. –re crée des infinitifs
des verbes d’action, à référent concret ; -ce des infinitifs de verbes qualitatifs et à référent
abstrait. Un suffixe nominal homophone –re marqueur de cas, partage ces propriétés.
9 Par ailleurs, les plosives ont une réalisation géminée en position interne de morphème,
toujours intervocalique, qu’elles soient orales ou nasales : [b:], [m:], [d:], [n:] [j:], [ñ:],
[g:], [η:], [p:], [t:], [c:], [k:].
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%