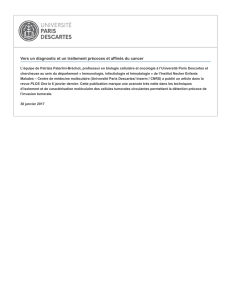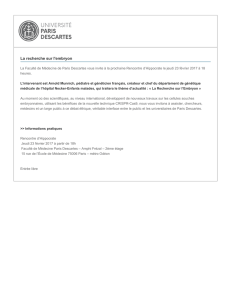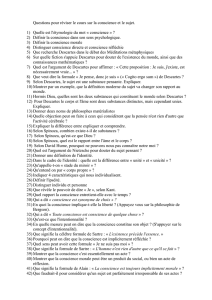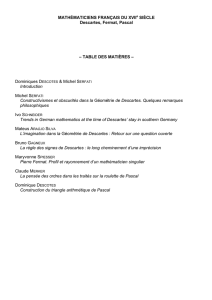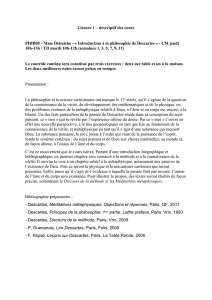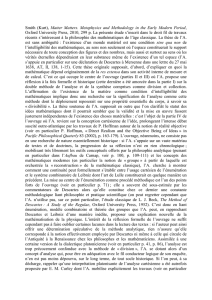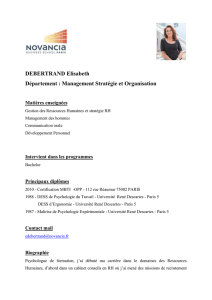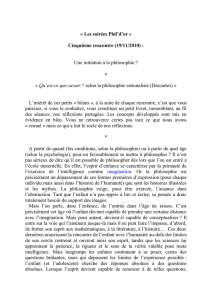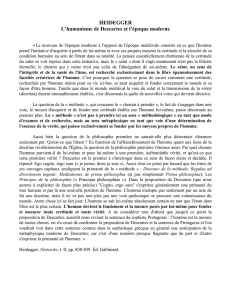Discours de la méthode de Descartes

Helena Villa Cardona TL
Terminale L – Fiche de lecture n°4 à rendre le mardi 10/05/16
Discours de la méthode, I, II, III et IV parties, in Lire les philosophes, pp.197-216 (la
raison et le réel)
1) Quel est l’objet du Discours de la méthode de Descartes ? Pourquoi la
méthode est-elle nécessaire ? (3 points)
Le Discours de la Méthode se présente sous forme d’un discours où Descartes essaye,
non pas imposer une méthode, mais rédiger de manière personnelle le cheminement de sa
pensée dans la recherche d'une vérité métaphysique, c’est à dire une vérité certaine ; en
fait, dans les premières pages de son ouvrage Descartes explique que le lecteur peut bien
choisir de ne pas prendre en compte le méthode qu’il développe tout le long de son récit
"Ainsi mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien
mener sa raison : mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la
mienne". À travers différents domaines, aussi bien philosophiques, métaphysiques et
scientifiques, le thème du Discours de la Méthode une recherche raisonnée de la Vérité
dans les sciences. Ainsi, Descartes affirme en effet que son but est de « parvenir à des
connaissances fort utiles à la vie et qu’au lieu de cette philosophie spéculative qu’on
enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle,[…], nous les
pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi
nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » C'est-à-dire que Descartes
cherche à trouver le point fixe et incontestable pour établir la philosophie.
Grâce à cela, on comprend que la Méthode est nécessaire car au moment où tout le
monde utilise une méthodologie pour organiser la pensée, tel comme les sciences
mathématiques le font, ainsi, c’est plus simple « d’expliquer à autrui les choses qu’on
sait » et permet d’augmenter la connaissance de peu à peu.
2) Dégagez l’idée directrice et les idées principales de la 1ère partie (4 points)
Dans la première partie du Discours de la Méthode, Descartes se focalise surtout dans les
sciences humaines comme la littérature, la philosophie, entre autres et expérimentales
comme les mathématiques, et il remet en question l’existence d'une vérité certaine. Alors,
Descartes expose le cheminement de sa raison à travers des considérations sur quelques
sciences ; notamment, les mathématiques avec lesquels il s'y est intéressé pour les
certitudes et les évidences de leurs raisons ; la lecture de livres anciens qui sont une
discussion agréable avec d'honnêtes gens ; ensuite, l’écrits païens sur les mœurs car ils
montrent les défauts mais n'aident pas à les corriger ; De plus, la théologie puisqu’elle
concerne aussi bien les ignorants que les doctes. De même, il critique la philosophie qui
fonde les sciences même si rien n'y est assuré : "Je ne dirai rien de la philosophie, sinon
que, voyant qu'elle a été cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuis
plusieurs siècles, et que néanmoins il ne s'y trouve encore aucune chose dont on ne
dispute, et par conséquent qui ne soit douteuse". Donc ces considérations le conduisent à

Helena Villa Cardona TL
abandonner les sciences comme moyen d'accéder à une vérité absolue, car leur
fondement n'est pas certain.
Ainsi, il s'intéresse dès lors au "livre du monde" pour en acquérir une expérience, mais
réalise finalement que tout connaître des siècles passés et des différents peuples lui
éloigne du siècle présent, c'est pourquoi il se replie sur une connaissance qui ne pourrait
être plus proche de lui que lui-même en décidant une sorte d'introspection.
3) Quels sont les quatre préceptes de la méthode (2e partie) ? (4 points) 205
Dans la Deuxième partie du Discours de la Méthode, puisque la raison est universelle, et
que l'esprit le plus simple peut arriver aux mêmes conclusions que tout le genre humain,
Descartes décide d'être la matière de son raisonnement, en se distinguant de ceux qui se
précipitent dans leur raisonnement, et de ceux qui se contentent de se référer à des
autorités intellectuelles. Alors, la conduite choisit par Descartes pour organiser sa pensée,
lui mène à s'imposer quatre principes de la méthode : D’abord, il conclu qu’il ne faut pas
prendre pour vraie une chose tant qu'il n'est pas sûr du fait, c'est-à-dire, il cherche à éviter
la précipitation et la prévention même s’il ne cherche pas à mettre en doute son esprit.
Après, Descartes dit qu’il faut diviser les difficultés à analyser au maximum pour mieux
les résoudre. Ensuite, il parle de tout traité en allant du plus simple au plus compliqué
pour avancer en degrés et en les organisant dans un ordre logique ou naturel. Enfin, il
demande de ne rien omettre en démultipliant les domaines d'investigations.
Ainsi, il va structurer une méthode si versatile qu’elle est capable d’être utiliser dans les
mathématiques ou la philosophie, entre autres domaines.
4) Que désigne la « morale par provision » ? Pourquoi Descartes la forme-t-il ?
(3e partie) ? (2 points)
La morale par provision est l'exposition de quelques règles d'action que Descartes se
donne, dans la troisième partie du Discours de la méthode, comme valables dans le
champ de l'action, en attendant de trouver la certitude des principes moraux car on ne
peut arrêter d'agir et mieux vaut donc agir tout en étant dans l'incertitude, que de ne pas
agir du tout. De plus, cette méthode permet de maintenir la pensée dans une suite logique
et ne pas perdre de vue l’objet de la recherche : trouver une vérité certaine et universelle.
Ainsi, la morale par provision provient d’une tension entre le projet intellectuel cartésien
et les exigences pratiques qu’on ne peut pas négliger car à la fin, la plupart de nos
croyances, loin d’être fondées en raison, sont juste des préjugés que nous avons intégrés
au point de ne plus ressentir le besoin de les examiner.
Descartes, juge nécessaire d’instaurer une morale par provision pour se défaire de toutes
ses opinions et de reprendre depuis le commencement en n’acceptant que les opinions
qu’il juge fondées en raison ; donc, cette morale par provision est censée lui fixer une
ligne de conduite en l’absence de certitudes morales.
5) Quelles sont les maximes de cette « morale par provision » ? (3 points)

Helena Villa Cardona TL
La morale par provision est formée par trois Maximes :
La première maxime est de suivre les coutumes de son pays, il s’agit de la règle de
conformisme. D’abord, pour Descartes, être libre ne consiste pas à s’opposer aux mœurs
de ses contemporains. Le non-conformisme social est pour Descartes une attitude tout à
fait superficielle ; en effet, on peut adopter un comportement de façon purement
extérieure, en conservant son "quant à soi". Cette attitude est d’ailleurs indispensable
parce qu’on ne vit pas tout seul, et que l’opposition systématique au reste de la société
formerait plus de problèmes qu’elle ne nous rendrait libres. Par contre, Descartes apporte
une précision en donnant un critère de discrimination: il s’agit de suivre les opinions les
plus modérées parmi celles qui sont également sensées. Le bon sens joue un grand rôle
car il faut être modéré, parce qu’en l’absence de la connaissance certaine, l’opinion la
plus modérée apparaît la plus raisonnable et la plus facile à corriger au cas où on
découvre qu’elle est fausse. Alors, l’application de cette règle de modération permet de
déterminer comment on peut faire pour rester libre : il faut toujours garder, pour
Descartes, surtout dans une morale provisoire, une sorte de distance de pensée, ne pas se
livrer totalement à une opinion, incertaine par nature.
Ensuite, dans la seconde maxime, Descartes prend le certain comme probable.
Néanmoins, on pourrait se demander s’il n’y a pas une contradiction entre la fin de la
première maxime et le début de la seconde. En fait, il ne faut pas que cette distance de
pensée nous conduise à l’impuissance dans l’action, parce que dans la pratique, il faut
choisir et se déterminer ; la difficulté est complètement levée si l’on revient à la
distinction entre l’entendement et la volonté : il faut intellectuellement garder une
distance de pensée, mais la volonté doit être ferme et résolue. On constate qu’il y a donc
en morale une forme de pari, puisqu’en l’absence de la connaissance de la vérité certaine,
on ne peut que se fier à la probabilité.
Enfin, la troisième maxime, il s’agit de changer ses désirs pour ne pas désirer
l’impossible. Cette maxime affirme que la liberté de la volonté et son autonomie sont
infinies ; alors, Descartes reprend très évidemment une grande partie de la thèse
stoïcienne mais avec une grande différence : la physique a changé et le monde n’est plus
un cosmos. De ce fait, la confusion stoïcienne entre éthique et physique n’est plus
possible, alors, faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de
nous, ce n’est plus faire la différence entre la nécessité physique et les représentations
que j’ai des événements, mais c’est montrer l’infinité de la volonté car la liberté, c’est un
pouvoir de dire non à tout, à tout ce qu’on n’a pas et qu’on pourrais désirer. Alors, plutôt
que d’être soumise aux choses, la volonté se soumet toutes choses en n’adhérant pas à ce
qui nous est refusé. La liberté va donc consister à bien distinguer ce qui dépend de nous
et ce qui ne dépend pas de nous. Or, ce qui dépend de nous, ce sont nos désirs et nos
passions. Mais changer ses désirs ne veut pas dire renoncer à tout désir, cela veut dire
régler ses désirs en jugeant ce qui est en notre pouvoir. C’est parce que la volonté est
absolument libre qu’elle peut s’arracher à la tyrannie des désirs et nous rendre heureux.
Par contre, Descartes ne rejette pas les passions et les désirs, mais il condamne le
dérèglement que peut introduire notre imagination dans notre rapport aux choses. Or, être
libre, c’est une certaine façon de regarder les choses consistant à ne pas désirer ce que

Helena Villa Cardona TL
l’on ne peut avoir. On constate que Descartes ne présente pas absolument la liberté
comme un choix fondamental ; au contraire, il faut s’exercer à être libre, prendre
l’habitude de se détacher de ce qui ne dépend pas de nous.
6) Dégagez l’idée directrice et les idées principales de la 4e partie ? (4 points)
Dans la quatrième partie, Descartes développe une preuve ontologique de l'existence de
Dieu et de l'âme humaine, sa recherche exclusive de la vérité le conduit à rejeter pour
faux tout ce qui présente le moindre doute ; notamment les sens puisque les sens
trompent quelques fois comme dans les rêves, donc ils se trompent toujours ; de même
tous les raisonnements sont faux car en raisonnant, les hommes se trompent quelques fois
puisqu'il peut subir des illusions extérieures, alors, tout ce qui lui est extérieur est faux.
De plus, dans cette parti du discours, il se rend compte que pendant qu'il pense que tout
est faux à cause d’une doute radicale, lui qui pense est forcément quelque chose, et que la
proposition suivante "Je pense donc je suis" est suffisamment certain pour qu'il puisse en
faire le premier principe de sa philosophie. Ainsi, la première déduction qu'il fait de ce
principe est qu'il est une substance dont toute l'essence est de penser, ce qui l'amène à la
certitude que l'âme est distincte du corps, qu'elle est plus facile à connaître que ce dernier.
Enfin, examinant sa certitude, il généralise : la pensée étant la certitude de l'être, ce que
l'on pense "clairement et distinctement" est vrai. De plus, s'interrogeant sur le fait qu'il y
eu des doutes, il en conclut son imperfection, et se demande en quelqu’un ou quelque
chose plus parfait que lui : Dieu, car ce que l'on pense distinctement de Dieu, c'est qu'il
est, en autres, parfait mais il serait une imperfection de la part de Dieu qu'il n'existe pas,
donc il existe, et n'est pas composé d'un corps. Ceci s’illustre par la citation suivante :
"Mais aussitôt après je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était
faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose : et remarquant
que cette vérité, Je pense donc Je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus
extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai
que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je
cherchais."
1
/
4
100%