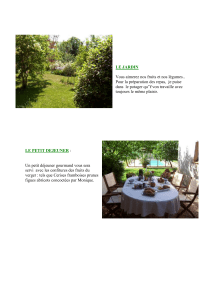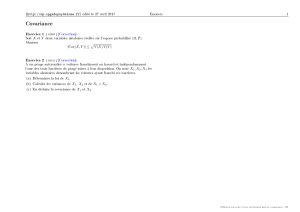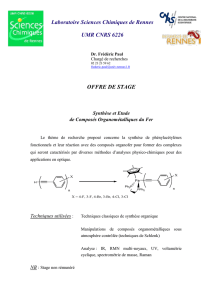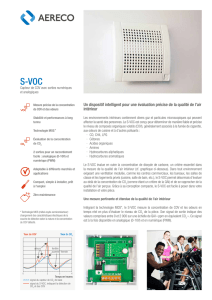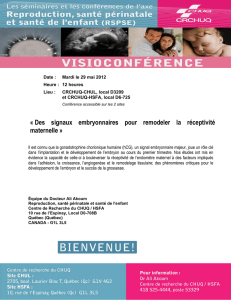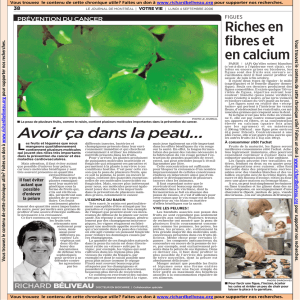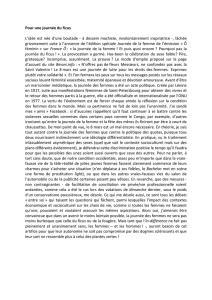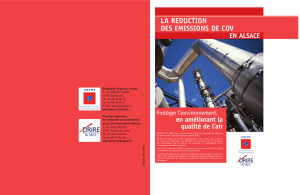Variation du signal olfactif lié à la pollinisation chez des plantes

UNIVERSITÉ MONTPELLIER II
SCIENCES ET TECHNIQUES DU LANGUEDOC
Mémoire de Master 1
Variation du signal olfactif lié à la pollinisation chez des plantes
Néotropicales : cas des Aracées et des Ficus en Guyane française
Mathieu Duvignau
Du 1er Mars au 31 Août 2011
Sous la direction de : Marc Gibernau (CNRS, UMR 8172 EcoFoG)
Marion Chartier (CNRS, UMR 8172 EcoFoG)
Finn Kjellberg (CNRS, UMR 5175 CEFE)
Lucie Conchou (CNRS, UMR 5175 CEFE)
Laboratoires d’accueil : UMR EcoFoG Campus agronomique -BP 316- F-97379 Kourou
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive – UMR 5175 -1919
Route de Mende – F34293 Monpellier cedex 5


Table des matières
I. Introduction…………………………………………………….………...1
II. Matériel et méthodes………………………………………….………….5
1. Interaction Aracées-Cyclocephala.................................................5
2. Interaction Ficus-insectes associés………………………………7
III. Résultats
1. Interaction Aracées-Cyclocephala……………………………….11
2. Interaction Ficus-insectes associés………………………………13
IV. Discussion…………………………………………………………………16
V. Conclusion……………………………………………………….………..20
VI. Références bibliographiques
VII. Webographie
VIII. Annexes
IX. Résumé


Introduction
La pollinisation entre les insectes et les plantes à fleurs remonte à environ 135 Ma
(Barth, 1991). Elle a accompagné les angiospermes depuis leur origine jusqu’à leur apogée
(Labandeira et al. 2007). Ce processus de pollinisation nécessite l’attraction d’un insecte au
minimum à deux reprises : une première fois pour prélever le pollen des étamines, et une
seconde fois pour le déposer sur des stigmates réceptifs. L’insecte pollinisateur, qui visite les
fleurs pour obtenir à l’origine une ressource, est donc un facteur sélectif important qui joue
directement sur le succès reproducteur de la plante. Comment attirer un insecte ? Par un signal
(visuel, olfactif) associé à une récompense (nourriture, site de ponte…). Lorsque le signal est
honnête, on peut qualifier cette interaction de mutualiste car le bilan global de l’interaction est
positif pour les deux protagonistes. Il existe cependant des cas de pollinisation par duperie.
Dans ce cas, la plante diminue ses coûts énergétiques en émettant un signal mais sans fournir
de récompense pour l’insecte pollinisateur : le signal véhicule alors une information
malhonnête. Par exemple, certains Ophrys (Orchidaceae) miment les phéromones et la forme
d’un partenaire sexuel potentiel pour attirer des abeilles mâles (Ayasse et al. 2000).
Les signaux olfactifs peuvent varier, que ce soit dans le temps (par exemple avec les
différents stades de maturation d’une fleur), et dans l’espace (entre plusieurs populations)
(Chartier et al. 2011). La nature de ces variations peut être quantitative (nombre et proportion
relative de composés émis) et qualitative (nature des composés) (Raguso et al. 2008).
Le but de cette étude est d’une part d’évaluer la nature et la quantité de composés volatils
émis chez des plantes de deux familles d’Angiospermes différentes et d’autre part d’étudier
les variations interspécifiques et temporelles de ces mêmes composés. Ces variations
semblent être intimement liées aux interactions que les plantes partagent avec différents types
d’insectes. La première partie portera sur un mutualisme de pollinisation entre quatre genres
d’Aracées néotropicales (Figure1) et leurs relations spécialisées avec les coléoptères du genre
Cyclocephala (Figure3). La seconde portera sur la relation de parasitisme entre une espèce de
Ficus (Figure 4) et sa guilde d’insectes parasites (Chalcidiens) (Figure 5) venant pondre dans
les figues par l’extérieur et donc sans les polliniser.
1
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
1
/
50
100%