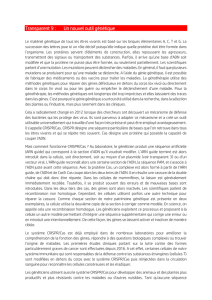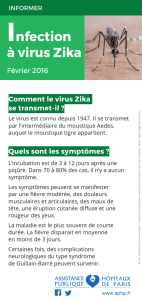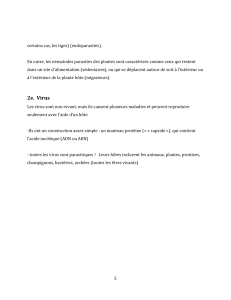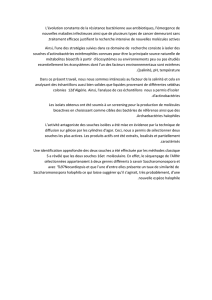RDP n 315 CCNE

1
ÉTHIQUE
Peut-on créer (et utiliser) du cuir à partir de la
peau d’Alexander McQueen ?
Le Monde du 20 juillet 2016 par Luc Vinogradoff
Pour son projet de fin d’études à l’école britannique de mode Central Saint Martins, Tina Gorjanc a
présenté des vêtements et des accessoires en cuir faits à partir de peau de cochon. Rien
d’extraordinaire, jusqu’à ce qu’on apprenne que ce n’était qu’une première étape. Elle voulait une
texture la plus ressemblante possible à la peau humaine (taches de rousseur, coups de soleil,
tatouages), car l’objectif final est de réaliser des sacs et des vestes à partir de la peau (recréée grâce
à l’ADN), du créateur de mode Alexander McQueen, mort en 2010.
Le projet est à l’état de théorie, mais il est techniquement possible et, apparemment, légal. En 1992,
McQueen lui-même avait incorporé ses propres cheveux dans sa première collection de fin
d’études. Tina Gorjanc veut récupérer ces mèches, en extraire le matériel génétique nécessaire et,
grâce à une culture cellulaire en laboratoire, en faire de la peau qui serait « tannée et transformée en
cuir humain, dans le but de l’utiliser pour des sacs, des vestes et des sacs à dos ». Elle a déposé une
demande de brevet pour les « échantillons d’information génétiques [de McQueen] comme base
pour une procédure qui aboutirait à créer du cuir fait de tissu humain dans un laboratoire ». Ce qui
veut dire qu’elle « deviendrait propriétaire de ce matériel, qui inclut l’information génétique
d’Alexander McQueen ».
Sauf que personne ne va s’habiller demain avec la peau d’un des plus grands créateurs de mode du
XXème siècle. Derrière la provocation (que McQueen aurait sûrement appréciée), les sacs humains
sont une façon « de pointer les manquements dans la protection de notre information biologique »,
dit Tina Gorjanc. « Une étudiante comme moi a pu déposer une demande de brevet pour du
matériel extrait de l’information biologique d’Alexander McQueen et il n’y avait aucune législation
pour m’en empêcher. Imaginons ce que de grandes entreprises, avec de grands budgets, vont
pouvoir faire dans le futur. »
« McQueen n’était pas, techniquement, propriétaire de ses propres cheveux »
En matière de bioéthique, la loi varie de pays en pays, mais semble, comme le suggère Tina
Gorjanc, un peu dépassée par la technologie. Par ailleurs, la déclaration universelle sur la bioéthique
et les droits de l’homme de l’Unesco de 2005 affirme que tout acte médical doit être fait « avec le
consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée ». Mais ne fait pas mention des
actes artistiques ou commerciaux.
En France, le Comité consultatif national d’éthique a prononcé dès 1990 le principe de non
patrimonialité du corps humain, qui interdit tout commerce ou négoce du corps ou de ses produits.
Mais qu’en est-il des choses que l’on pourrait recréer avec vos organes ou vos cellules, comme avec
le cheveu de McQueen ?
En Grande-Bretagne, le Human Tissue Act de 2004 encadre l’utilisation du matériel génétique
humain dans la recherche médicale, mais ne dit rien de leur éventuelle utilisation commerciale.
Interrogé par Quartz, Jeff Skopek, spécialiste de loi et d’éthique médicale à l’université de
Cambridge, ajoute ceci, pour rendre la situation un peu plus anxiogène :

2
« La règle de base en Grande-Bretagne est qu’il n’y a aucun droit de possession en ce qui concerne
le tissu humain. Donc, McQueen n’était pas, techniquement, propriétaire de ses propres cheveux. »
Même chose aux Etats-Unis. Les cheveux que vous laissez derrière vous chez le coiffeur ne vous
appartiennent plus, même si, légalement, personne ne peut les ramasser et déposer un brevet pour
les posséder. Une histoire illustre d’ailleurs le flou de la loi. Dans les années 1970, un certain John
Moore subit une ablation de la rate après une leucémie. Il ignore que les docteurs garderont des
cellules de sa rate pour les étudier. Ils créent une lignée cellulaire, efficace dans le traitement contre
les cancers, qui leur rapportera beaucoup d’argent après avoir été breveté. Lorsqu’il apprend, une
décennie plus tard, que ces médecins se sont fait de l’argent sur ses cellules, Moore intente un
procès. La justice américaine le déboute : il n’a aucun droit sur un brevet qu’il n’a pas inventé,
même si ce qui a été breveté contient des parties de son ADN.
Les sacs en peau de McQueen, s’ils existent un jour, ne seront pas commercialisés, assure leur
créatrice. Ils auront leur place dans un musée ou une galerie, peut-être dans une exposition sur le
thème « La mode déborde les frontières de la science-fiction ». Elle peut être critiquée ou
ridiculisée, mais, pour Tina Gorjanc, cette approche « Frankenstein » de la mode est utile pour
comprendre un milieu qui a besoin d’aller toujours plus loin pour se réinventer : « La demande de
produits personnalisés, uniques et raréfiés ne cesse de grandir. Tout comme l’obsession de la
célébrité, sans même parler des avances biotechnologiques, qui pourraient changer la façon dont
on fabrique les vêtements et leurs tissus. »
La révolution Crispr-Cas9 testée en Chine
pour soigner le cancer du poumon
Huffington Post du 22 juillet 2016 par Grégory Rozières
Si les tests de nouvelles techniques dans la recherche contre le cancer sont réguliers, celui-ci
va être scruté de près. La revue Nature révèle ce jeudi 21 juillet que des chercheurs chinois
vont utiliser Crispr-Cas9, une technique révolutionnaire de modification génétique, sur des
patients atteints d'un cancer du poumon.
C'est la première fois que Crispr sera utilisé sur des humains adultes. Mais au fait, de quoi parle-t-
on ? D'une méthode, désignée découverte capitale de l'année 2015 par le magazine Science, qui
permet de réaliser des modifications de l'ADN de tout être vivant plus facilement que jamais. En
gros, c'est une enzyme programmée pour cibler un gène précis et le couper de l'ADN. Elle intéresse
de nombreux pans de la médecine et de la génétique (un chercheur veut même cloner des
mammouths grâce à elle). Ce que Lu You, oncologiste de l'université chinoise de Sichuan, va tester
avec son équipe, c'est de modifier les lymphocytes T des patients avec Crispr-Cas9. Ces cellules
sont les soldats de notre système immunitaire et sont censées attaquer les virus et les tumeurs.
Libérer notre défense de ses propres freins
Le problème, c'est que souvent, dans le cas de cancer, ces fameuses cellules T n'attaquent pas les
tumeurs, car elles n'arrivent pas à reconnaître en ces cellules malades des ennemis étrangers au
corps humain. Une grande partie des recherches actuelles contre le cancer cherchent donc à trouver
un moyen de forcer les lymphocytes T à attaquer les tumeurs. Ce que les chercheurs chinois vont
tenter de faire, c'est d'extraire du patient ces cellules de défense, puis d'utiliser Crispr-Cas9 pour
"couper" un gène bien particulier, appelé PD-1.

3
Ce gène, normalement, va dire au lymphocyte T s'il a le feu vert pour attaquer une cellule. En le
mettant hors circuit, les scientifiques espèrent ainsi que le lymphocyte va pouvoir s'attaquer à la
tumeur. La cellule génétiquement modifiée sera ensuite multipliée in vitro, puis elles seront toutes
réinjectées dans le corps du patient.
Un test très encadré
Avant de réinjecter les cellules modifiées, celles-ci seront vérifiées par une société de
biotechnologie pour être certain que d'autres modifications impromptues n'ont pas eu lieu. Car si
Crispr-Cas9 est incroyablement plus précis que les précédentes méthodes de modification
génétique, il y a toujours un risque d'effets secondaires. De plus, précise Nature, seuls des patients
atteints d'un cancer du poumon avancé et pour lesquels les méthodes de traitements actuels ont
échoué pourront participer à ce test. Reste également la question des effets secondaires. En enlevant
leur inhibiteur aux lymphocytes T, n'y a-t-il pas un risque que celles-ci attaquent des cellules saines
? Interrogé à ce propos, Lei Deng, un des chercheurs de l'équipe, est plutôt confiant, car d'autres
méthodes (plus aléatoires et moins efficaces) ont été testées pour bloquer ces gènes. Or, le taux de
réponse auto-immune (les lymphocytes T attaquant les cellules saines) ne s'est pas révélé
significatifs. Les premiers essais, qui auront lieu en août, seront effectués sur une dizaine de
personnes, progressivement, afin de vérifier qu'il n'y a pas d'effets secondaires indésirables.
La Chine en avance (parfois trop)
L'hôpital où aura lieu cet essai clinique a approuvé éthiquement l'opération le 6 juillet. La Chine
n'est pas la seule à vouloir tester Crispr-Cas9 pour soigner les maladies, mais sera clairement la
première à le faire. Aux Etats-Unis, précise Nature, un essai similaire est en attente d'une
autorisation de la FDA, le gendarme américain de ce qui touche à la santé. L'autorisation pourrait
arriver d'ici la fin de l'année. Une start-up américaine spécialisée sur Crispr et financée par Bill
Gates souhaite également réaliser ses premiers essais sur un être humain pour venir à bout d'une
maladie rare touchant les yeux. Si cette fois, la Chine devance d'un cheveu les Etats-Unis, elle a
également été accusée d'utiliser trop facilement Crispr-Cas9. L'annonce d'embryons génétiquement
modifiés par des scientifiques chinois, en avril 2015, avait provoqué un tollé, même si les embryons
testés n'étaient, de base, pas viables. Mais mine de rien, moins d'un an après, la Grande-Bretagne
donnait l'autorisation à une équipe d'utiliser Crispr-Cas9 sur des embryons humains (à condition de
les détruire au bout de 14 jours).
Nous saurons sûrement dans quelques mois si cette technique est concluante pour lutter contre le
cancer. Une chose est sûre : dans ce domaine ou ailleurs, vous n'avez pas fini d'entendre parler de
Crispr-Cas9.
Après l’attentat, homélie « diabolique » ?
Mediapart du 29 juillet 2016 par Jean-Noël Cuénod
Pour une fois que votre Plouc parpaillot – d’ordinaire méfiant envers toutes les institutions
ecclésiastiques – avait dit du bien de l’Eglise romaine, le voilà puni…
Après l’assassinat du père Jacques Hamel à l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, les dirigeants du
catholicisme français avaient fait preuve de sang-froid, de hauteur de vue et de fermeté d’âme en
appelant à cette unité que, justement, les djihadistes veulent briser. Ils offraient ainsi un réconfortant
contraste à l’indécent spectacle des politiciens qui, obnubilés par la présidentielle de 2017, se sont
déchirés en de lamentables polémiques pour soirées Pastis.

4
Mais voilà, l’homélie du cardinal André Vingt-Trois – prononcée mercredi lors de la messe à Notre-
Dame de Paris en l’honneur du père Hamel –, nous a fait brusquement retomber sur terre. Opposant
au mariage homosexuel, l’archevêque de Paris n’a pas pu se retenir de fustiger : « Le silence des
élites devant les déviances des mœurs et la législation des déviances ». Même si elle est formulée
de chafouine manière, la pique visait clairement la loi qui a légalisé le mariage homosexuel.
Devant les protestations que ce bout d’homélie a suscitées, le diocèse de Paris a effectué un
rétropédalage très politicien : « En aucun cas, il (le cardinal) ne voulait cibler une mesure en
particulier, surtout pas le mariage pour les couples homosexuels. Il ciblait plutôt l’ensemble des
évolutions sur la bioéthique, la fin de vie, la gestation » (Le Huffington Post). Le cardinal Vingt-
Trois ayant participé très activement aux « Manifs pour tous » qui combattaient le projet de loi sur
le mariage gay, on peut légitimement mettre en doute la bonne foi de cette explication.
Et quand bien même le cardinal aurait sincèrement voulu ne s’attaquer, comme le soutient son
diocèse, qu’à « l’ensemble des évolutions sur la bioéthique, la fin de vie, la gestation », ce n’était
vraiment pas le lieu ni le moment pour mettre sur l’autel les sujets qui séparent les citoyens. A
Notre-Dame, ces citoyens avaient besoin de se retrouver unis en mémoire du père Jacques Hamel,
de faire la paix avec les autres et eux-mêmes. Ils n’avaient nul besoin d’ouïr un prélat leur débiter la
doctrine de l’Eglise sur la bioéthique, doctrine qui n’est qu’un point de vue humain parmi d’autres.
Certes, comme n’importe quel citoyen, l’archevêque de Paris a le droit d’exprimer ses opinions
contre le mariage homosexuel et de promouvoir ce qu’il pense être juste en matière de bioéthique et
de fin de vie. Mais pas n’importe où, pas n’importe quand. Monseigneur Vingt-Trois a prononcé
des paroles de division au moment où il fallait faire l’unité. Dans la mesure où l’étymologie du mot
diable en grec – « diabolein » – signifie « qui divise, qui sépare », ce bout d’homélie ne serait-il pas
quelque peu « diabolique » ? Un diable dont on sait qu’il niche dans les détails. En tout cas, avant
de prononcer ses paroles, le cardinal aurait dû se rappeler deux versets de Qohelet (Ecclésiaste), III-
1 et III-7 : Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux (…); un temps pour
déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler.
GPA : Décision controversée au Québec
autorisant l'adoption de jumelles par un
couple homosexuel
La Presse.ca du 28 juillet 2016 par Isabelle Mathieu
Un couple homosexuel québécois, Jacques et Louis, s'est rendu en Inde pour passer un contrat avec
une mère porteuse, en dépit du Code Civil canadien qui condamne tout contrat où une femme
s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui en échange de rétribution. Un tel
contrat est considéré comme « nul de nullité absolue ». Deux jumelles sont nées après insémination
avec le don de sperme de Jacques, le père biologique. Après la naissance, la mère porteuse signe
« une déclaration assermentée, dans laquelle elle mentionne qu’elle remet les deux petites filles à
leur père biologique, et qu'elle n'a pas d'objection à ce qu'il quitte l'Inde avec les enfants (...) Plus
tard, elle affirmera être aussi en accord avec le fait que Louis adopte légalement les fillettes ».
En 2013, le couple entame les démarches pour que Louis puisse adopter légalement les deux petites
filles. Mais la procureure générale du Québec s'oppose à l'adoption, déclarant que Jacques et Louis
avaient délibérément contourné la loi québécoise, jugeant que « plusieurs clauses du contrat de
gestation sont abusives et contraires à nos principes juridiques et à l'ordre public».

5
Elle ajoute que Jacques et Louis ont « porté atteinte à la dignité humaine, à l'instrumentalisation du
corps de la femme et à la marchandisation de l'enfant ».
Après trois ans de procédure, le juge Viviane Primeau, de la Cour du Québec, chambre de la
jeunesse*, en a jugé autrement. Elle convient qu'on peut « s'interroger sur l'aspect moral et éthique
du commerce entourant les contrats de gestation en Inde », mais qu'il ne lui appartient pas de
sanctionner la conduite des parties. Dans l’intérêt des fillettes, elle accorde leur placement auprès du
couple en vue d’une adoption légale. Elle estime que « le débat entourant la question des mères
porteuses ne doit pas se faire aux dépens des enfants ici concernées ». Le juge Primeau souligne
également « qu'il serait souhaitable que le législateur clarifie les règles en matière de filiation des
enfants nés d'une procréation assistée ».
*La Cour du Québec, chambre de la jeunesse, est un tribunal de première instance dont la
décision est susceptible d'appel si le procureur général du Québec en décide ainsi.
Soupçon de GPA à l’étranger : le Quai
d’Orsay condamné
Libération du 4 août 2016
Depuis début juillet, Valérie*, une quadragénaire française, attendait de pouvoir quitter l’Arménie
avec son fils d’à peine plus d’un mois. Mais le consulat français refusait de délivrer un laissez-
passer pour l’enfant. Les diplomates soupçonnaient qu’il soit né d’une gestation pour autrui (GPA),
interdite en France. Le Conseil d’Etat a tranché mercredi et appelé le ministère des Affaires
étrangères à délivrer à titre provisoire tout document de voyage permettant à l’enfant de rejoindre la
France avec sa mère, dans un délai de sept jours à compter de cette décision. Le Quai d’Orsay devra
également verser 3 000 euros à Valérie au titre des frais de justice.
« Lorsqu’elle s’est rendue au consulat d’Erevan début juillet, Valérie a présenté l’acte de naissance
de son fils, établi dans les règles par les autorités arméniennes, et sur lequel est inscrit son nom en
tant que mère, raconte maître Caroline Mecary, l’une de ses avocates. Mais les fonctionnaires du
consulat ont alors fait des histoires, et posé tout un tas de questions sur sa vie privée ou sur son
accouchement. » Le 19 juillet, le consulat fait savoir qu’il ne peut délivrer de laissez-passer.
« Valérie ne peut rester plus de 180 jours sur le sol arménien. […] Si elle ne repart pas avec son
fils, personne d’autre sur place ne pourra s’occuper de lui et elle devra le confier à un orphelinat »,
expliquait alors son avocate. Le 26 juillet, le tribunal administratif de Paris condamne une première
fois le ministère des Affaires étrangères. Celui-ci contre-attaque et porte l’affaire devant le Conseil
d’Etat.
Pour Alexandre Urwicz, le président de l’Association des familles homoparentales (AFDH),
habituée des obstacles administratifs de ce type, le cas de Valérie illustre parfaitement « l’impasse
juridique » dans laquelle la France se trouve : condamnée à deux reprises par la Cour européenne
des droits de l’homme pour son refus de transcrire à l’état civil les actes de naissance des enfants
nés par GPA à l’étranger, mais refusant de bouger, préférant « bafouer le droit par manque de
courage et absence de volonté politique ».
*Le prénom a été changé.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
1
/
73
100%