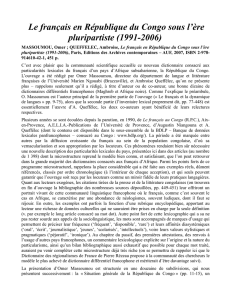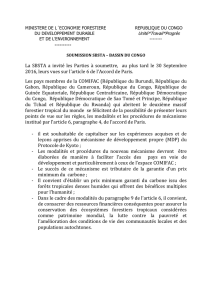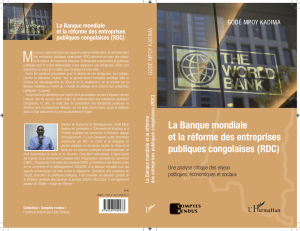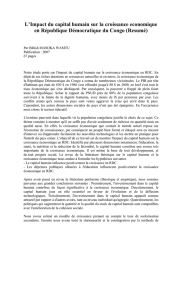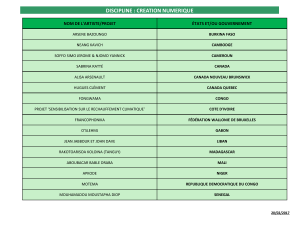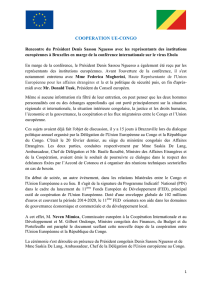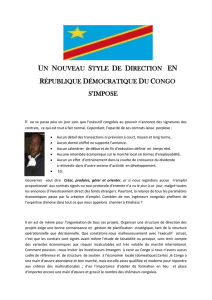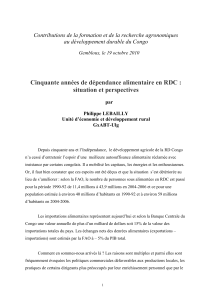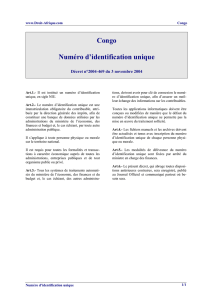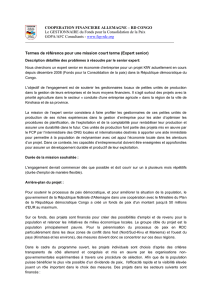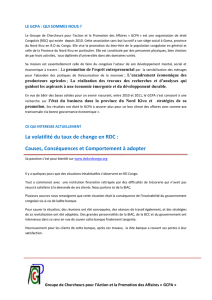Le travail des femmes en République démocratique du

Le travail des femmes en République démocratique du Congo :
exploitation ou promesse d’autonomie ?
Rosalie MALU MUSWAMBA
Historienne

Introduction
Présentation du cadre général de la recherche
Aujourd’hui, dans les différents pays de la région des Grands Lacs en Afrique
centrale, de plus en plus de femmes luttent pour gagner leur autonomie, et cela au niveau
politique, économique, social et culturel. À cet égard, la question des rapports de genre,
des relations entre hommes et femmes devient un élément fondamental dans les choix qui
devront être faits pour le développement durable de cette partie du monde. Cette
autonomisation des femmes paraît d’autant plus importante à la lumière du rôle qu’on
leur reconnaît volontiers dans la résolution des conflits, et cela à un moment où
pratiquement tous les pays de la région ont été ou sont encore en proie aux guerres les
plus violentes, guerres dont les premières victimes demeurent les civils, notamment les
femmes et les enfants (1).
Mais au-delà de leur rôle de promotrices de la paix, rôle qui s’exerce somme toute
dans le cadre d’une société en crise – conflit ou guerre ouverte –, comment intégrer une
éventuelle émancipation féminine dans la longue durée ? Comment promouvoir une
réelle égalité des sexes ? Même si elle a une portée universelle, en ce sens que toute
société humaine est composée d’hommes et de femmes, la question des rapports de genre
s’inscrit toujours dans un contexte culturel donné. Parce qu’elle l’explique – la théorise ?
–, la consacre et la justifie, la culture est bien souvent mise en cause dans l’inégalité
sexuelle dont on observe encore de trop nombreuses manifestations à travers le monde.
Mais les choses sont-elles aussi simples ? En fait, il apparaît de plus en plus à tous ceux
2

qui s’attachent à la promotion des droits des femmes – individus, associations,
administrations nationales ou organisations internationales – que ce combat doit être
mené dans le cadre des références culturelles des communautés considérées. Si certains
éléments d’une culture contribuent à inférioriser la femme, c’est au sein de cette même
culture qu’il faut chercher d’autres éléments pouvant contrer, voire même inverser ce
processus.
Problématique
Située dans le cadre général résumé plus haut, la présente étude est cependant
circonscrite à la République démocratique du Congo et, comme l’indique son intitulé, elle
porte principalement sur le rôle économique des femmes dans ce pays. À la campagne
comme à la ville, que ce soit dans le cadre de l’économie formelle ou informelle, de
nombreuses femmes congolaises sont au travail. Elles sont fonctionnaires, travaillent
dans l’administration, l’enseignement, la médecine, le commerce ; elles sont paysannes,
coiffeuses, font de la couture, œuvrent au sein des ONG, etc. Au travers de toutes ces
activités, les Congolaises contribuent de plus en plus aux revenus des ménages. Or, dans
un contexte de paupérisation globale tel que le connaît la RDC aujourd’hui, ce
dynamisme féminin se révèle indispensable au bien-être ou tout simplement à la survie de
la plupart des familles. Les Congolaises peuvent-elles tirer avantage de cette situation
pour parvenir à une réelle égalité avec les hommes et dans quelles conditions ?
En effet, face à l’enjeu que constitue l’autonomisation des femmes, à savoir la
conquête par ces dernières de la maîtrise de leur destin, il s’agit ici de déterminer
3

comment, dans le cadre de la culture congolaise, l’accès ainsi que les conditions de
l’exercice d’une activité économique peuvent s’insérer dans cette dynamique. Par
l’importance qui lui est accordée aujourd’hui, par la part qu’il tient dans la vie des
individus, au niveau matériel d’abord mais aussi au niveau personnel, le travail semble
porter en lui la promesse d’une indépendance possible pour les femmes du Congo.
Pourtant, dans une société frappée par la pauvreté, voire même la misère de la plus
grande partie de ses membres, le travail peut se combiner avec d’anciennes et/ou de
nouvelles contraintes sociales pour générer l’exploitation des femmes la plus féroce, au
moins en ce qui concerne les plus vulnérables d’entre elles.
La problématique de cette étude se situe ainsi sur deux niveaux. D’abord, elle
s’articule autour des notions d’autonomisation et d’exploitation – deux éléments
antinomique – des femmes congolaises, et ensuite, elle permet de voir comment cette
dynamique autonomie/exploitation peut fonctionner dans la vie professionnelle de ces
mêmes Congolaises.
Ce travail se divise en trois parties. La première précisera les enjeux de
l’autonomisation des femmes au Congo, notamment à travers le rôle économique de ces
dernières. Elle permettra aussi de définir les notions d’autonomie et d’exploitation ainsi
que celle de travail tout en soulignant l’importance de celui-ci, non seulement dans la
dynamique d’une société, mais aussi dans la réalisation personnelle des individus, en
particulier les femmes.
Dans la seconde partie, on pourra voir comment la confrontation des valeurs
auxquelles se référaient les sociétés traditionnelles congolaises, et celles introduites par la
colonisation, se sont combinées pour changer la perspective dans laquelle s’inscrivait le
4

travail féminin. Il sera ainsi possible d’appréhender les racines culturelles de la condition
féminine au Congo, à savoir l’image de la femme et son rôle dans la société traditionnelle
avant de voir comment les transformations politiques, économiques, sociales et
culturelles ont affecté ces derniers depuis plus d’un siècle, notamment à travers la
colonisation.
La troisième partie offrira un regard plus actuel sur la situation de la Congolaise,
entre la réalité d’une émancipation qui s’impose peu à peu mais aussi celle d’une
exploitation qui puise à la fois dans les traditions et les contraintes modernes,
spécialement dans le monde du travail.
Enfin, la conclusion de l’article permettra de faire la part de ce qui, dans l’activité
économique des femmes congolaises, renforce l’autonomisation de celles-ci, et de ce qui
tient de l’exploitation.
Méthodologie, sources et documentation
Cette étude sera abordée selon une double perspective. Une première approche
diachronique permettra de voir le contexte historique dans lequel s’est formée la
condition de la travailleuse congolaise, et par là d’en appréhender les ressorts culturels.
Une seconde approche plus ancrée dans le présent et son contexte de paupérisation et de
guerre montrera comment ces mêmes ressorts culturels jouent aujourd’hui, comment ils
se combinent avec les exigences de la modernité, et surtout les nouvelles espérances des
femmes.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
1
/
117
100%