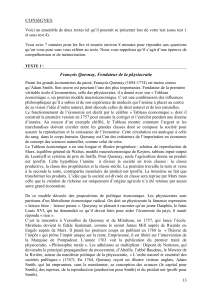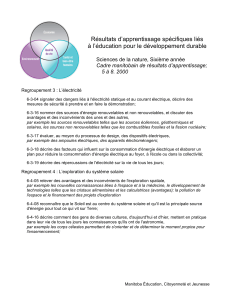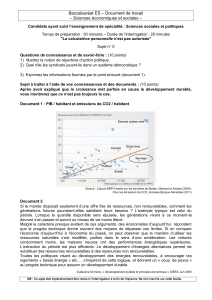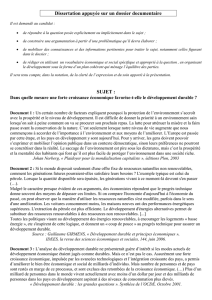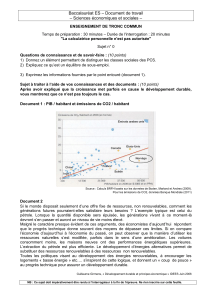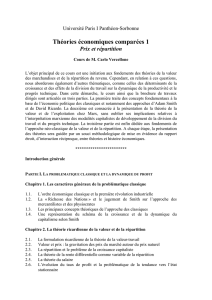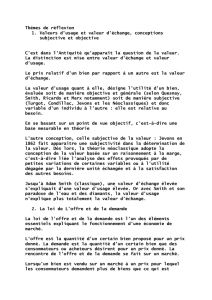Que peuvent nous dire d`intéressant les Physiocrates et les

1
1er Congrès Jean-Baptiste Say. 27-30 août 2014. Boulogne-sur-Mer
Le rôle de la nature dans la production : qu’est-ce qu’une production soutenable ?
Pierre Le Masne*
Résumé : Les approches économiques divergent quant au rôle de la nature dans la production. Ce
papier propose, à partir d’une lecture d’économistes classiques et post-classiques (dont J. B. Say) une
réflexion sur le rôle de la nature dans la production et sur la production soutenable. Une définition de
la production soutenable est donnée. La production soutenable prend en compte les relations entre les
fonds de la nature et les flux de ressources qui en sont issus. Elle fait systématiquement la différence
entre ressources renouvelables et non-renouvelables, et insiste sur la nécessité de protéger les fonds
naturels à l’origine des flux de ressources.
Abstract: The Role of Nature towards Production: what is a sustainable Production? The
economic approaches diverge concerning the role of nature towards production. This paper proposes,
relying on a lecture of classical and postclassical economists (among which J. B. Say), a reflection on
the role of nature toward production and on sustainable production. A definition of sustainable
production is given. Sustainable production takes account of the relations between the funds of nature
and the floods of resources. She makes a systematic difference between renewable and non-renewable
resources and insists on the necessity to protect the natural funds at the origin of the floods of
resources.
Introduction
La notion de production est loin d’être claire, surtout si on examine le rôle qu’y joue la nature. Selon
l’INSEE (2011), la production est une « activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d'une
unité institutionnelle qui combine des ressources en main-d'oeuvre, capital et biens et services pour
fabriquer des biens ou fournir des services, et [le] résultat de cette activité. Les processus purement
naturels sans intervention ou contrôle humain ne font pas partie de la production ». Le rôle de la
nature reste énigmatique selon cette définition ; on peut penser que la nature ne contribue pas à la
production.
Ce manque de clarté paraît lié aux divergences entre les courants économiques quant au rôle de la
nature dans la production, qui rend difficile une définition par les instituts statistiques. Pour les
Physiocrates, toute richesse vient de la terre, et le travail ne fait que stimuler la terre. Pour les
Classiques, le travail est essentiel, mais s’applique aux valeurs d’usages produites gratuitement par la
nature. Pour le courant néoclassique « traditionnel », le travail et le capital sont les deux facteurs de
production, et la terre ne produit pas. Le courant néoclassique « rénové » a introduit à partir des années
1970 un troisième facteur, le « capital naturel », destiné à prendre en compte le rôle de la nature. Pour
les économistes énergéticiens, la valeur de la production est liée à son contenu en énergie.
* Pierre Le Masne est maître de Conférences HDR à l’Université de Poitiers, chercheur au CRIEF (EA 2249) et
membre du RRI ; pierre.le-masne@univ-poitiers.fr.

2
Les tensions écologiques contemporaines rendent importantes les conséquences des divergences
précédentes. Toute stratégie de développement soutenable doit s’appuyer sur une analyse précise de la
production et de ses rapports à la nature. K. Polanyi (1975, p. 242) définit l’économie comme « un
processus institutionnalisé d’interaction entre l’homme et son environnement qui se traduit par la
fourniture continue de moyens matériels permettant la satisfaction des besoins ». En s’appuyant sur la
définition précédente, cet article précise les rôles respectifs de la nature et des hommes dans la
production et définit ce que pourrait être une production soutenable, après un détour auprès
d’économistes classiques ou post-classiques. La production soutenable prend notamment en compte
les relations entre les fonds de la nature et les flux de ressources qui en sont issus, et fait
systématiquement la différence entre ressources renouvelables et non renouvelables.
La première partie examine la notion de production pour des économistes précurseurs, et les relations
qu’ils établissent entre terre, travail et capital. La deuxième partie analyse les relations entre
reproduction économique et reproduction naturelle, et les approches de la production comme
régénération. La troisième partie définit la production soutenable, et la quatrième partie revient sur
quelques méthodes susceptibles de la développer.
I. Production, terre et travail pour quelques économistes précurseurs
Qu’est-ce que « produire » ? Le cadre de départ est fixé par William Petty (1662, p. 57), pour qui « le
travail est le père et le principe actif de la richesse, de même que la terre en est la mère ». La terre est
un bassin de ressources, elle est la source première de la production, et en la fécondant par le travail,
les hommes lui font produire des richesses. Richard Cantillon (1997, p. 1-2) est proche du cadre de
Petty : « La terre est la source ou la matière d’où l’on tire la richesse ; le travail de l’homme est la
forme qui la produit : et la richesse elle-même n’est autre chose que la nourriture, les commodités et
les agréments de la vie ». Petty (1691, p. 63) aimerait trouver une équivalence entre terre et travail de
façon à pouvoir évaluer la valeur de toute chose : « Ceci m’amène à considérer la question la plus
importante en économie politique, à savoir celle d’établir une équation et une égalité entre la terre et
le travail, de manière à exprimer la valeur de chaque chose par l’un ou l’autre de ces deux termes ».
Cantillon (1997, p. 16-17) suit la même démarche, en se demandant, dans le prix d’un seau d’eau, quel
est le prix de l’eau et celui du travail pour l’amener chez le client. Petty et Cantillon échouent à trouver
une équivalence générale entre terre et travail.
Les Physiocrates
Pour Mirabeau et Quesnay (1763, p. 3), la production vient de la terre : « Dans ce rouage si bien
assemblé, on découvre néanmoins clairement d’où part le mouvement. La terre est la source de la
production ; mais elle ne produit, au gré de nos besoins, que par le moyen du travail et des facultés de
ceux qui la cultivent. C’est à bon droit que nous appelons la classe des cultivateurs classe
productive ». Mirabeau et Quesnay restent à l’intérieur du cadre général défini par Petty, mais donnent
plus d’importance à la terre et moins au travail. L’agriculture et la terre sont seuls productifs.
L’industrie transforme ce qui a été produit par la terre et ne produit rien elle-même.
Smith et Ricardo
Smith fixe le cadre classique d’analyse de la production et avance sur deux points importants par
rapport à Quesnay quant au rôle de la nature. Il introduit explicitement les notions de valeur d’usage et
d’échange. Il renverse la logique de Quesnay : c’est le travail qui produit, à partir des valeurs d’usage
fournies gratuitement par la nature. Les hommes stimulent la nature par le travail et s’approprient ses
valeurs d’usage. Ces dernières peuvent être ensuite vendues en tant que valeur d’échange, puis
transformées. La production humaine présuppose l’existence de la nature et de ses valeurs d’usage
gratuites. Ricardo (1977, p. 25) remarque : « L’eau et l’air, dont l’utilité est si grande, et qui sont
même indispensables à l’existence de l’homme, ne peuvent cependant, dans les cas ordinaires, être
donnés en échange pour d’autres objets. L’or, au contraire, si peu utile en comparaison de l’air ou de

3
l’eau, peut être échangé contre une grande quantité de marchandises. Ce n’est donc pas l’utilité qui
est la mesure de la valeur échangeable, quoi qu’elle lui soit absolument essentielle ». En séparant
valeur d’usage et valeur d’échange, les Classiques affirment qu’une chose utile peut ne pas avoir de
prix. Un ensemble de biens ou d’éléments naturels restent en dehors du monde marchand : la chaleur
du soleil, le climat, l’eau, on ne peut leur donner de valeur d’échange. Smith et Ricardo sont dans une
époque où la capacité de la nature à produire des valeurs d’usage paraît illimitée, ce qui n’est plus le
cas aujourd’hui, et conduit à poser la question de la reproduction des valeurs d’usage de la nature.
Smith continue à penser que l’agriculture est plus productive que l’industrie (Smith (1991, t. 1, p. 453-
454) :
« Mais aucun capital, à somme égale, ne met en captivité plus de travail productif que celui du
fermier.. Jamais une pareille quantité de travail productif, employé en manufactures, ne peut
occasionner une aussi riche reproduction. Dans celles-ci, la nature ne fait rien ; la main de l’homme
fait tout, et la reproduction doit toujours être nécessairement en raison de la puissance de l’agent.
Ainsi, non seulement le capital employé de la culture met en activité une plus grande quantité de
travail productif que tout autre capital pareil employé en manufactures, mais encore, à proportion de
la quantité de travail productif qu’il emploie, il ajoute une beaucoup plus grande valeur au produit
annuel des terres et du travail du pays, à la richesse et au revenu réel de ses habitants. De toutes les
manières dont un capital peut être employé, c’est sans comparaison la plus avantageuse à la société ».
Dans cette citation (reprise et commentée par Ricardo et Marx), Smith conçoit la production en termes
de reproduction. Ricardo (1977, p. 65), d’accord avec le rôle très important de la nature, réagit
toutefois à l’idée de Smith que la nature ne travaillerait que dans l’agriculture en ajoutant :
« La nature ne fait-elle donc rien pour l’homme dans les manufactures ? N’est-ce rien que la
puissance du vent et de l’eau qui font aller nos machines, et qui aident à la navigation ? La pression
de l’atmosphère et l’élasticité de la vapeur de l’eau, au moyen desquelles nous donnons le mouvement
aux machines les plus étonnantes, ne sont-elles pas des dons de la nature ? Pour ne rien dire des effets
du calorifique qui ramollit à fond les métaux, ni de la décomposition de l’air dans les procédés de la
teinture et de la fermentation, il n’existe pas une seule espèce de manufacture dans laquelle la nature
ne prête son aide à l’homme, et elle le fait toujours avec libéralité et gratuitement ».
En modernisant ce raisonnement, on dirait qu’un ordinateur ou un téléphone portable s’appuient sur
des dons multiples et gratuits de la nature, électricité, capacité des semi-conducteurs de stocker des
informations, transmission par les ondes.
Le capital reste pour Smith un facteur dérivé produit à partir des éléments de la terre et du travail des
hommes ; il n’est pas encore, comme il le deviendra chez les néoclassiques, un facteur premier, sur
l’origine duquel on ne s’interroge plus. Le capital fixe et le capital circulant ont tous deux une origine
matérielle, agricole (matières premières agricoles ou bois) ou industrielle (fer, énergie) (Smith (1991,
t. 1, p. 364)) :
« La terre, les mines et les pêcheries ont toutes besoin, pour être exploitées de capitaux fixe et
circulants, et leurs produits remplace avec profit non seulement ces capitaux mais tous les autres
capitaux de la société … La terre elle-même remplace, au moins en partie, les capitaux qui servent à
exploiter les mines et les pêcheries. C’est le produit de la terre qui sert à tirer le poisson des eaux, et
c’est avec le produit de la surface de la terre qu’on extrait les minéraux de ses entrailles ».
Marx
Marx reste largement dans cadre d’analyse de Smith des rapports hommes - nature, en reprenant la
distinction valeur d’usage - valeur d’échange et en mettant l’accent sur le travail. Il radicalise toutefois
l’approche. Les hommes font partie de la nature. Certaines classes en exploitent d’autres et utilisent
plus les dons gratuits de la nature que d’autres, en établissant des monopoles sur elle.

4
Selon Marx (1968, t. 2, p. 62), « La nature, pour autant qu’elle n’est pas elle-même le corps humain,
est le corps non organique de l’homme. L’homme vit de la nature - ce qui signifie que la nature est
son corps et qu’il doit maintenir des rapports constants avec elle pour ne pas mourir. Dire que la vie
physique et intellectuelle de l’homme est liée à la nature ne signifie rien d’autre que la nature est liée
à elle-même, car l’homme est une partie de la nature ». Les rapports entre les hommes et la nature
sont une affaire interne à la nature. Le travail des hommes est aussi un élément de la nature, l’élément
qui fait qu’une partie de la nature transforme l’autre (Marx (1966), p. 22-23)) :
« Le travail n’est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs
d’usage (qui sont bien, tout de même la richesse réelle !) que le travail, qui n’est en lui même que
l’expression d’une force naturelle, la force naturelle de l’homme... Et ce n’est qu’autant que l’homme,
dès l’abord, agit en propriétaire à l’égard de la nature, cette source première de tous les moyens et
matériaux de travail, ce n’est que s’il la traite comme un objet lui appartenant que son travail devient
la source des valeurs d’usage, partant de la richesse. Les bourgeois ont d’excellentes raisons pour
attribuer au travail cette surnaturelle puissance de création : car du fait que le travail est dans la
dépendance de la nature, il s’ensuit que l’homme qui ne possède rien d’autre que sa force de travail
sera forcément, en tout état de société et de civilisation, l’esclave d’autres hommes qui se seront
érigés en détenteurs des conditions objectives de travail. Il ne peut travailler, et vivre par conséquent,
qu’avec la permission de ces derniers ».
L’accès et le contrôle de la nature permettent à certains groupes sociaux de dominer les forces de
travail. Le travail lui-même n’est pas pour Marx un facteur isolé de la nature et il implique l’homme et
la nature à la fois. Marx (1969, t. 1, p. 180-181) affirme ainsi :
« Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l’homme et la nature. L’homme y joue lui-
même vis-à-vis de la nature le rôle d’une puissance naturelle. Les forces dont son corps est doué, bras
et jambes, tête et mains, il les met en mouvement, afin de s’assimiler des matières en leur donnant une
forme utile à sa vie. En même temps qu’il agit par ce mouvement sur la nature extérieure et la modifie,
il modifie sa propre nature, et développe les facultés qui y sommeillent ».
Le procès de travail combine le travail à un objet du travail tiré de la nature et à un moyen de travail,
outils, machines, « chose ou ensemble de choses que l’homme interpose entre lui et l’objet de son
travail comme conducteurs de son action » (Marx (1969, t. 1, p. 183)). Du fait que l’homme et son
travail appartiennent à la nature, le procès de travail de l’homme implique la nature dans ses trois
dimensions : le travail est un produit de la nature, les machines résultent de la nature et du travail,
l’objet du travail (agricole ou industriel) appartient à la nature.
Malgré son erreur sur la stérilité de l’industrie, Quesnay met selon Marx l’accent sur un problème que
Smith a oublié : l’agriculture joue un rôle spécifique, car elle fournit de la nourriture et des matières
premières dont l’industrie dépend. L’ouvrier a besoin du produit de l’agriculture, il ne peut manger les
produits de l’industrie. L’agriculture a aussi besoin de l’industrie, engrais ou charrues, mais il s’agit
d’une dépendance seconde. Marx admet ce primat de l’agriculture dans le circuit économique (Marx
(1974, t. 1, p. 36-37)) :
« Deuxièmement. Si l’on fait abstraction du commerce extérieur, ce que les physiocrates ont, à juste
raison, fait, et qu’ils étaient obligés de faire pour procéder à leur analyse abstraite de la société
bourgeoise - il est évident que la masse des ouvriers travaillant en manufacture, etc., complètement
séparés et détachés de l’agriculture - ces « bras libres », comme les appelle Steuart- est déterminé par
la masse de produits agricoles que les cultivateurs produisent en excédent de leur propre
consommation… La possibilité du surtravail et de la plus-value résulte donc d’une force productive
donnée du travail, productivité qui permet à la puissance de travail de reproduire plus que sa propre
valeur, de produire au-delà des besoins qu’impose son processus vital. Or il faut que cette
productivité, le degré de productivité pris comme base de départ, soit présente d’emblée dans le

5
travail agricole, comme nous l’avons vu au deuxièmement ; elle apparaît donc comme un don de la
nature, une force productive de celle-ci ».
La contrainte agricole dont parle Marx a évolué depuis l’époque. Il faudrait plutôt parler aujourd’hui
d’une contrainte de reproduction des matières premières, de l’énergie, et des milieux naturels.
Les auteurs précédents, qui considèrent tous la production comme une reproduction, insistent tantôt
sur la dimension économique et tantôt sur la dimension matérielle de cette reproduction, ce qui amène
à examiner les différences entre les deux conceptions.
II. La production : régénération, reproduction naturelle et reproduction économique
La conception des Physiocrates de la production comme régénération est présentée, puis la
régénération est abordée à partir de la question des ressources renouvelables ; on montre qu’il existe
différentes façons de produire, et que l’approche néoclassique apporte peu.
Les Physiocrates et la production comme régénération
L’approche physiocratique est biologique, la production est production de vie. L’industrie (au moins
celle du 18e siècle
1
) ne peut reproduire la vie. Le travail peut orienter la fécondité de la nature, mais,
pour être productif, doit porter sur un objet du travail fécondable ou reproductible, le blé mais pas le
fer. Baudeau (1846, t. 2, p. 823) affirme selon cette logique : « Le grain, le vin, sont en même temps
des présents de la nature et des fruits du travail.. Le minerai ne se sème pas, il ne se multiplie pas ».
De son côté, Dupont de Nemours (1846, t. 1, p. 373) définit ainsi la reproduction : « La reproduction :
c’est la renaissance future des produits de la terre, qui doivent recommencer l’année prochaine à
nourrir les hommes » ; la reproduction est matérielle, physique plus qu’économique. Quesnay (2005,
p. 974)) définit la production comme une régénération : « L’idée de production, ou de régénération,
qui forme ici la base de la distinction des classes générales de citoyens, est resserrée dans des bornes
physiques, réduites si rigoureusement à la réalité, qu’elles ne sont plus conformes aux expressions
vagues usitées dans le langage ordinaire ». L’agriculture, mais aussi la pêche sont productives, car ce
sont des secteurs qui se régénèrent. L’industrie ne produit pas le minerai qu’elle utilise, elle n’est pas
productive. Quesnay (2005, p. 647) parle de la « machine économique » comme d’une « machine
régénératrice » et comme d’un organisme vivant. L’agriculture est le secteur premier dont viennent les
ressources naturelles renouvelables.
Reproduction et régénération chez Marx
Marx a été influencé par les Physiocrates (A. Hornborg (2014)) et leur analyse de la reproduction. La
reproduction économique et la reproduction matérielle de la nature s’interpénètrent et Marx (1969, l. 2,
t.. 1, p. 15) fait l’éloge des Physiocrates à ce propos : « Le procès de reproduction économique, quel
que soit son caractère social spécifique, est dans ce domaine (l’agriculture) toujours enchevêtré avec
un procès de reproduction naturel. Les conditions tangibles du second nous éclairent sur celles du
premier et évitent cette confusion d’idées que seuls font naître les aspects trompeurs de la
circulation ». Dans l’agriculture, les conditions naturelles de production nous éclairent sur la
dimension économique : le consommateur qui achète du vin peut penser qu’un cru de 2007 est
meilleur qu’un cru de 2008, parce que le soleil a été plus abondant cette année là. Mais Marx n’évoque
pas les effets inverses de la reproduction économique sur la reproduction naturelle : par exemple
aujourd’hui la poursuite de la pêche menace certaines espèces. Marx semble de plus limiter
l’enchevêtrement des procès économiques et naturels de reproduction à l’agriculture, alors que ces
procès sont également enchevêtrés dans l’industrie ou dans les services.
Marx pose parfois le problème de l’épuisement des terres par le capitalisme, en envisageant la
production comme un métabolisme entre l’homme et la terre (Marx (1969, p 565-566)). Marx critique
le capitalisme et la pollution parce que ceux-ci dégradent les conditions de vie de la population mais
1
Aujourd’hui, l’industrie peut pratiquer des cultures de tissus cellulaires et produire aussi la vie.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%