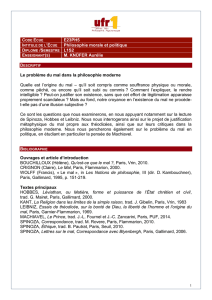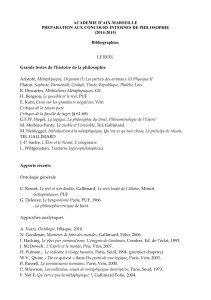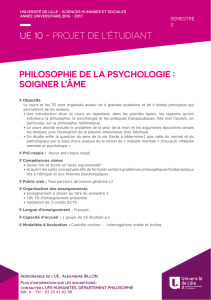3 L3 brochure pédagogique 2015 2016

ENSEIGNEMENTS DE TROISIEME ANNEE
DE LICENCE PHILOSOPHIE
2015-2016
1
er
semestre
PHILOSOPHIE GENERALE – SEMESTRE 1
Lundi 14-16h
Éric MARQUER, Connaissance et probabilité
Que veut-on dire lorsque l’on qualifie une opinion ou un événement de « probable » ? Ce
mot a-t-il dans les deux cas le même sens ? Faut-il distinguer connaissance et probabilité,
ou bien y a-t-il un sens à parler de connaissance probable ? La possibilité d’une estimation
des probabilités conduit-elle à nier le hasard ? Telles sont les questions que nous
aborderons dans ce cours.
Bibliographie
Textes classiques
Aristote, Topiques, Organon V, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 2004.
Arnauld et Nicole, La logique ou l’art de penser, ed. D. Descotes, Paris, Champion, 2014.
Hume, Traité de la nature humaine, trad. P. Baranger et P. Saltel, Paris, GF-Flammarion,
1995 (Livre 1, troisième partie, « De la connaissance et de la probabilité »).
Hume, Enquête sur l’entendement humain, trad. M. Malherbe, Paris, Vrin, 2008, section VI.
Laplace, Pierre Simon, Essai philosophique sur les probabilités (éd. De 1825), Paris,
Christian Bourgois Editeur, 1986.
Leibniz, L’estime des apparences, 21 manuscrits de Leibniz sur les probabilités, la théorie
des jeux, l’espérance de vie, Paris, Vrin, 1995.
Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain, Paris, GF, 1993 (IV, 2 et 16).
Locke, Essai sur l’entendement humain, trad. Coste, éd. P. Hamou, Paris, Le livre de Poche,
2009 (livre IV, chapitres 14 à 17).
Pascal, Pensées, Fragment 233 (éd. Brunschvicg).
Autres ouvrages et articles
Bouveresse, L’homme probable. Robert Musil, le hasard, la moyenne et l’escargot de
l’histoire, Paris, Editions de l’Eclat, 1993.
Carnap, R., « The Two Concepts of Probability : The Problem of Probability », Philosophy
and Phenomenological Research, Vol. 5., No. 4. (Jun., 1945), p. 513-532.
Hacking, I., L’émergence de la probabilité, trad. M. Dufour, Paris, Seuil, 2002.
Hacking, I., The Taming of Chance, Cambridge University Press, 1990.
Musil, R., L’homme sans qualités, trad. P. Jaccottet, Paris, Seuil, 2004.
Shapiro, B., Probability and certainty in Seventeenth-Century England. A Study of the
Relationship between Natural Science, Religion, History, Law, and Literature, Princeton
University Press, 1983.
Lundi, 18h30- 20h30
Paul RATEAU, L’identité
Sur quels principes la pensée s’appuie-t-elle pour juger que deux choses numériquement
distinctes sont pourtant les mêmes, qu’une chose est ce qu’elle est, ne peut pas être et ne
pas être en même temps ? Mais encore : qu’est-ce qui demeure exactement et qu’est-ce qui

change ? L’objet de ce cours est d’étudier les diverses acceptions de l’identité et les critères
sur lesquels se fonde le jugement d’identité (sont-ils les mêmes dans le cas d’un corps
matériel et dans le cas d’une personne ?).
L’enjeu de cette notion est à la fois logique, métaphysique, moral, puisqu’il ne s’agit pas
seulement des réquisits de l’énonciation ou du jugement vrai(e) (A est A ; x est identique à
y), mais de ce qui fonde ce discours dans les choses mêmes, notamment au regard des
personnes tenues, tout au long de leur existence, pour responsables de leurs actes. Si tout
ce qui existe est soumis au devenir, si un homme peut en arriver à oublier son passé et
jusqu’à son propre nom, l’identité est-elle réelle ou n’est-elle qu’une fiction, une illusion sur
nous-mêmes et sur un monde auquel nous cherchons désespérément à donner ordre et
unité ? Le cours s’appuiera notamment sur le recueil de textes édité par Stéphane Ferret,
L’identité (Garnier-Flammarion, 2011).
Mardi, 13h-15h
Guy-Félix DUPORTAIL, L’intersubjectivité
La quête d’une réponse à la question de l’intersubjectivité nous donnera l’occasion d’une
confrontation entre, dans un premier temps, la problématique Hégélienne de la formation
historico-dialectique d’un Esprit (Geist) et la problématique Husserlienne de la constitution
orientée d’une communauté culturelle à partir d’un monde premier dont le monde culturel est
l’horizon. Puis, dans un second temps (au second semestre), avec Lévinas, Kierkegaard et
Habermas, nous verrons comment les critiques contemporaines de la phénoménologie de
l’Esprit et de la phénoménologie transcendantale permettent de reprendre à nouveaux frais
ces questions.
Premier semestre : on sait que la Phénoménologie de l’Esprit fut présentée par Hegel
comme la science de l’expérience de la conscience. Mais, passée la section « Raison », le
cheminement de l’Esprit n’est plus celui d’une conscience individuelle, mais celui d’une
expérience historique. Toutefois, le dépassement de la conscience par l’Esprit, passe par les
expériences malheureuses de la conscience accédant à l’universel. Aussi, la
phénoménologie de Hegel, sans être une phénoménologie de la conscience est une
phénoménologie qui reste dans l’élément de la conscience.
Sur ce terrain une rencontre avec la phénoménologie husserlienne de la conscience est
possible, et même nécessaire. Nous l’organiserons à partir d’une lecture patiente du tome I
de la Phénoménologie de l’Esprit (sections conscience de soi et raison) ainsi que des
Méditations Cartésiennes de Husserl. Nous opposerons dès lors la problématique de la
reconstitution dialectique d’une totalité brisée, à celle de la constitution de l’intersubjectivité à
partir d’un monde premier égologique.
Mardi 14h30-16h30
Florencia di Rocco, Le langage : une approche analytique
L’objectif de ce cours est de revisiter quelques propositions de la philosophie du langage, à
partir du tournant wittgensteinien –souvent mécompris– jusqu’à l’école analytique anglo-
saxonne (Quine, Strawson, David Lewis). Nous lirons quelques propositions analytiques en
laissant apparaître en filigrane la théorie « classique » du langage –de la modernité
lockéenne jusqu’à Frege- : la notion des jeux de langage, la substitution du sens par l’usage,
le principe de non-clôture conceptuelle, la notion des familles de ressemblance, l’idée de
schème conceptuel, l’indétermination de la traduction et la relativité des ontologies, les
notions d’analyse, de réseau de concepts et de gamme conceptuelle, ainsi que les règles
conversationnelles d’accommodement –de présupposés, de permissibilité et des trais
saillants–. Nous montrerons comment ces différentes perspectives sur le langage –ordinaire,
idéal– aboutissent à une trivialisation ou, bien au contraire, à une refondation de la
métaphysique.

Bibliographie minimale :
David Lewis, « Compter les points dans un jeu de langage », Philosophie du langage (II):
sens, usage et contexte, Vrin, 2011
Gottlob Frege, « Sens et dénotation », « Concept et objet », Ecrits Logiques et
philosophiques, Editions du Seuil, 1994
John Locke, Livres II et III, Essai sur l’entendement humain, Broché, 2009
Ludwig Wittgenstein, Recherches Philosophiques, Gallimard, 2014
Strawson, Analyse et métaphysique, Vrin, 1985
Willard Van Orman Quine, « Parler d’objets », « Relativité de l’ontologie » et Introduction de
Sandra Laugier, Relativité de l’ontologie et autres essais, Aubier, 2008
Mercredi 11h-13h
Ronan de CALAN, Théories critiques de la littérature:
A partir de la fin du XIXe siècle, la littérature, qui détenait encore le monopole de la
représentation synthétique du monde social et de la psychologie individuelle, rencontre ses
plus grands concurrents dans les sciences humaines élevées à l'état positif: l'histoire tout
d'abord, mais aussi la sociologie, la psychologie et particulièrement la psychanalyse. Non
seulement ces disciplines isolent la littérature, influent sur elle, mais elles s'en emparent
comme d'un objet de science. Naissent alors les premières théories critiques de la littérature:
critiques au sens où elles interrogent les conditions historiques, sociales, psychologiques de
possibilité de la littérature, de ses formes, de ses thèmes, etc. Critiques aussi dans la
mesure où elles ne se satisfont pas des critères purement internes fournis par la littérature
elle-même pour l'évaluation des œuvres littéraires, que ceux-ci soient de nature poétique,
rhétorique, esthétique, etc. On tentera donc de dresser une généalogie et un panorama de
ces théories critiques de la littérature et de leurs principales problématiques, du tout premier
XXe siècle à nos jours.
Bibliographie indicative:
G. Lanson, Essais de méthode, de critique et d'histoire littéraire (1900 et sq.), Hachette
Freud, S., [1924].1985. « Petit abrégé de psychanalyse ». In : Résultats, idées, problèmes II.
Paris : PUF. Freud, S.,[1908]. 1985. « Le créateur littéraire et la fantaisie ». In : L’inquiétante
étrangeté et autres essais. Paris : Gallimard. Freud, S., [1917]. 1985. « Une difficulté de la
psychanalyse ». In : L’inquiétante étrangeté et autres essais. Paris : Gallimard. Freud, S.,
[1907]. 1986. Le délire et les rêves dans la Gradiva de W.Jensen. Paris : Gallimard. 20
Freud, S., [1909]. 1973. « Le roman familial des névrosés ». In : Névrose, psychose et
perversion. Paris : PUF.
G. Lukacs: La théorie du roman (1920), Tel Gallimard
W. Benjamin, Baudelaire (1940), La Fabrique.
Th. Adorno, Notes sur la littérature (1930 et sq.), Champs, Flammarion.
J.-P. Sartre, Qu'est-ce que la littérature? (1947), Gallimard; Baudelaire (1946), Gallimard;
Mallarmé (1951), Gallimard; L'idiot de la famille (1971-1973), Gallimard.
G. Dumézil, Du mythe au roman, PUR, 1970
M. Robert, Roman des origines, origines du roman, Grasset, 1972.
J. Dubois, L'institution de la littérature, Nathan, 1978.
P. Bourdieu, Les règles de l'art, Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 1992.

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE – SEMESTRE 1
Groupe 1 : Mardi 10-13h - Cavaillès
Pauline KOETSCHET
Introduction à la philosophie arabe médiévale : quelques grands problèmes.
Ce cours propose de livrer quelques clés pour appréhender et comprendre les
débats philosophiques qui s'exprimèrent en langue arabe du IX
e
au XV
e
siècle. De
Bagdad à Tunis en passant par Hamadan et Cordoue, il propose un parcours
décloisonné, fondé sur des textes appartenant principalement à la tradition héritée de
la philosophie grecque, mais aussi à la théologie et aux sciences. Il s'efforcera de
présenter à travers ces textes les grandes figures de la philosophie arabe médiévale
et esquissera leur influence sur le Moyen-Âge latin.
Bibliographie succincte :
- Averroès, Le discours décisif, trad. Marc Geoffroy, Paris, GF-Flammarion, 1996.
- Averroès, L'Islam et la Raison (textes traduits par M. Geoffroy), Paris, GF-
Flammarion, 2000.
- Al-Fârâbî, Philosopher à Bagdad au Xe siècle, (textes traduits par Stéphane
Diebler), Paris, Le Seuil, , 2007.
- Razi, La médecine spirituelle, trad. Rémi Brague, Paris, GF-Flammarion, 2003.
- Adamson, Peter, et Taylor, Richard C., The Cambridge Companion to Arabic
Philosophy, Cambridge University Press, 2005.
- Koetschet, Pauline, La philosophie arabe, Paris, Le Seuil, 2011.
- De Libera, Alain, La philosophie médiévale, Paris, PUF, 1993.
Groupe 2 : Mercredi 9h-12h, Cavaillès
Véronique DECAIX
Introduction à la philosophie médiévale latine: « Qu’est-ce que penser au Moyen-
Âge ? »
Depuis Descartes, il nous semble naturel de concevoir la pensée comme l’opération
d’un sujet, un ego cogitans. Ce cours d’introduction à la philosophie médiévale se
propose de retracer les infléchissements singuliers que les médiévaux (Abélard,
Maître Eckhart, Guillaume d’Ockham …) apportent à la question « Qu’est-ce que
penser ? ». À la croisée de la psychologie et de la théologie, au cœur de la
métaphysique, se noue le problème de la personnalité intellectuelle : « Qui
pense ? », ou plutôt, « qu’est-ce qui pense en nous ? ». En explorant la variété des
problématiques et les innovations majeures au Moyen Âge, ce cours fournira un
panorama de la philosophie de cette période. Ce sont des questions telles que celles

de l’essence de l’homme, de son unité, de son statut entre Dieu et bêtes, tout comme
celle de la béatitude qu’il peut espérer en ce monde, qu’il conviendra d’examiner.
Bibliographie :
Note : La connaissance du latin n’est pas requise. Le cours fournira toutes les
traductions utiles et les instruments nécessaires à la compréhension des textes
médiévaux.
Flasch, K., Introduction à la philosophie médiévale, 2
e
édition augmentée d’une
postface, Fribourg, Vestigia, 2010
Gilson, É., La Philosophie au Moyen Âge. Des origines patristiques à la fin du XIV
e
siècle, (1
e
édition 1949), rééd. Paris, Payot, 1988
Libera (De), A., Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, Point Essais, 1996
Libera (De), A., La Philosophie médiévale, réédition, Paris, PUF, Quadrige, 2014
Groupe 3 : Mercredi12h30-15h30, Lalande
Aurélien ROBERT
L’éthique d’Aristote : la vertu, le bonheur et le raisonnement pratique
L’éthique d’Aristote revient sur le devant de la scène philosophique depuis plusieurs
années, notamment en bioéthique, mais ces lectures contemporaines font
généralement subir à la pensée aristotélicienne des distorsions importantes, qui sont
le plus souvent le résultat d’une relative ignorance de sa technicité. Il s’agira donc
d’examiner quelques-uns des concepts centraux de l’éthique aristotélicienne (la vertu
ou excellence, le bien, le bonheur ou encore la structure du raisonnement pratique),
afin de saisir sa singularité dans le champ de la philosophie antique, notamment par
rapport à Platon. Pour ce faire, nous étudierons principalement l’Ethique à
Nicomaque et, dans une moindre mesure, l’Ethique à Eudème. Ce n’est qu’au terme
de ce travail que nous pourrons poser à nouveaux frais la question des
prolongements contemporains de l’éthique aristotélicienne.
Bibliographie :
Aristote, Éthique à Nicomaque, traduction et présentation par Richard Bodéüs,
Flammarion, Paris, 2004.
Pierre Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1963.
Sarah Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford, Oxford University Press, 1994.
(Une bibliographie plus complète sera distribuée en début de semestre)
Groupe 4 : Jeudi 8h-11h, Halbwachs
Dimitri EL MURR
Lecture de la République de Platon
La République de Platon est un dialogue dont la notoriété ne doit pas faire oublier le
caractère extraordinaire. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer les deux thèses
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
1
/
46
100%