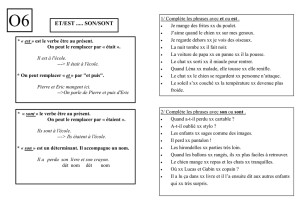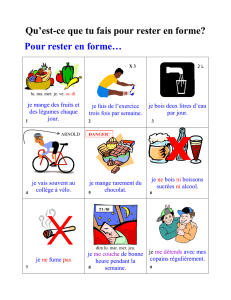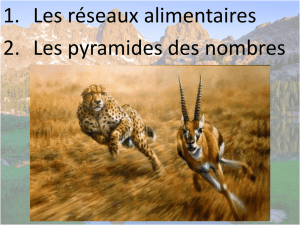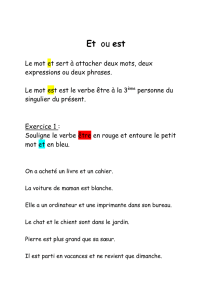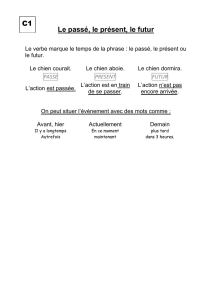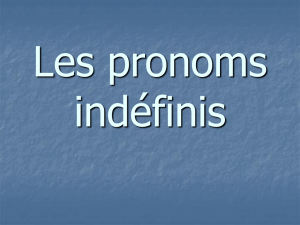L1-4-syntaxe Fichier

4 UNE PRÉSENTATION DE LA SYNTAXE 1
4 Une présentation de la syntaxe
Jusqu’ici, en morphologie, nous avons abordé les éléments un par un : les séries dénies
(paradigmes, opérations de exion et de dérivation) nous montrent comment substituer (ou
”commuter”) des éléments qui permettent de varier des informations sémantiques à l’intérieur
d’un élément isolé : pour une même unité (par exemple, un nom, un verbe), il s’agit de voir de
quelle manière il est possible de faire varier les rapports de diérenciation (on change le genre,
le nombre, ou bien le temps, le mode, la personne). Néanmoins, une telle approche n’est pas
susante, car les locuteurs ne se contentent pas d’empiler de telles unités les unes à côté des
autres au sein d’une phrase, comme des pierres dans un mur, où chacune serait indépendante
du reste. Nous avons déjà pu observer à certaines occasions que les unités pouvaient s’inuencer
mutuellement : en phonétique, on parle d’assimilation pour décrire l’eet d’un phone prononcé
sur ceux qui suivent ou précèdent, et en sémantique, nous avons déni l’anaphore comme le
fait que le sens d’un ”mot”, au départ toujours relativement impropre, se trouvait précisé par
l’inuence sémantique des autres mots présents dans la phrase. Cette inuence qu’exercent les
unités les unes sur les autres s’observera tout particulièrement dans la syntaxe : néanmoins, il
ne s’agira pas ici de la prononciation ou du sens des mots, mais l’objectif sera d’observer les
contraintes formelles que les diérentes unités s’agençant dans une phrase exercent les unes
sur les autres. Puis-je avoir tel mot sans tel autre ? Est-il possible de déplacer celui-ci librement
dans la phrase, ou bien sa position est-elle contrainte par les autres, et si oui selon quelles
régularités ? Si j’ajoute tel type de mot dans une phrase, quelle conséquence cela aura-t-il sur
les autres ? Ce sont les questions posées par la syntaxe.
(Remarque : alors que les cours précédents présentaient des notions et analyses relati-
vement consensuels au sein de la linguistique, dans le domaine de la syntaxe, l’écart est
particulièrement sensible entre les diérents courants théoriques. Il existe ainsi plusieurs
grands courants, inuencés par des auteurs connus (par exemple Noam Chomsky, André
Martinet, Lucien Tesnière, Gustave Guillaume, etc.), qui proposeront des analyses
divergentes : les unités ne seront pas découpées ni nommées de la même manière, les rela-
tions syntaxiques et les contraintes de structuration de la phrase renverront à des schémas
et des notions diérents. Ce cours n’a pas pour but de proposer une comparaison entre
ces diérents courants : par commodité, nous présentons ici des analyses inspirées par le
courant théorique dit ”de la médiation”, forgé par Jean Gagnepain, et diusé surtout à
Rennes. Le cours ne vise pourtant pas à ce que les étudiants maîtrisent ce cadre d’analyse
particulier : l’objectif est plutôt de proposer une initiation à un raisonnement syntaxique,
en partant d’une théorie située, qui pourra ensuite servir de point de départ pour une
comparaison avec les autres.)
4.1 Qu’est-ce qui constitue une unité ?
La première question à se poser en syntaxe est de savoir ce qui peut être dégagé comme
constituant une unité autonome. Face à un ”mot”, il convient donc de se demander : pourrais-je
le trouver tout seul ? Par exemple, une phrase qui ne contiendrait que je,tu ou il passerait
pour incomplète : on les trouve généralement avant un verbe, que leur présence appelle. Il en
va de même pour le ou la, déterminants, qui ne seront pas considérés comme autonomes, mais
comme constituants d’une unité plus large, dans la mesure où leur présence n’existe que dans
une relation de dépendance envers un nom qu’ils précèdent.
(Remarque : Pour reformuler plus précisément la question ”Puis-je le trouver tout seul ?”,

4 UNE PRÉSENTATION DE LA SYNTAXE 2
on pourrait se demander : qu’est-ce qui pourrait constituer une réponse minimale mais
(grammaticalement) complète à une question spécique ? Il faudrait exclure les usage
métalinguistiques, où le langage est pris pour objet du discours : par exemple il prononce
très bien ses "je", ou bien le premier mot de cette phrase est : "le". À ce titre,
je ou le ne constitueraient pas une réponse, puisqu’une réponse minimale mais complète
serait au moins : je mange, ou le chien.)
À partir de ce constat selon lequel certains éléments n’existent jamais de manière auto-
nome mais se situent dans ensembles plus larges au sein duquel ils sont solidaires de certains
autres, nous pouvons proposer de nommer ”unité” cet ensemble. La notion de ”morphème”,
déjà présentée en morphologie, peut ici être utilisée pour désigner les éventuels constituants
d’une telle unité. Ainsi, nous pourrons dire que l’unité le chien contient les deux morphèmes
le et chien : ainsi, si je ne constitue pas une unité (car on ne le trouverait pas tout seul), je
mange en est une : cela peut constituer une réponse minimale mais complète à une question
qui serait posée.
(Remarque : Dans la terminologie du courant théorique proposé, on parle d’”unité”, mais
l’on trouverait des sens relativement proches pour les notions de ”groupe” (groupe nominal,
groupe verbal), ”syntagme” (syntagme nominal, syntagme verbal), ou ”ensemble” dans
d’autres courants. Malgré les éventuelles diérences liées à la conceptualisation de chaque
courant théorique, on retrouve derrière ces notions une idée commune de rassemblement
d’éléments solidaires entre eux et qui n’auraient pas pu être délimités comme des
unités autonomes.)
4.1.1 Jusqu’où vont les unités ?
Si nous avons vu que le chien ou je mange constituent chacun une unité, on peut se
demander à quel endroit celles-ci s’arrêtent :
L’unité nominale :
le chien
avec le chien
et avec le chien
L’unité verbale :
je mange
je le mange
je le mange -rai
je ne le mange -rai pas
car je ne le mange -rai pas
pour que je ne le mange pas
Dans une telle description, on perçoit donc que ce que l’on appelle ”verbe” ou ”nom” n’est
plus un mot isolé (comme chien ou mange), mais bien cet ensemble, que l’on peut analyser

4 UNE PRÉSENTATION DE LA SYNTAXE 3
comme un programme au sein duquel certains éléments peuvent être présents ou non. Ce que
l’on nommera ”verbe”, en tant qu’unité, sera donc aussi bien je mange que pour que je ne le
mange pas. Alors que la grammaire traditionnelle considère que c’est mange qui est un verbe,
nous pourrons le dénir quant à nous comme constituant le lexème de l’unité verbale. Ce
lexème est entouré d’autres morphèmes qui composent l’unité, ces derniers pouvant être présents
ou absents.
4.1.2 Les morphèmes dans les unités
Nous pouvons maintenant observer et catégoriser ces morphèmes qui entourent les lexèmes :
Les morphèmes de l’unité nominale :
conjonction préposition déterminant lexème suxes (nombre, genre)
et avec les chien -s
Les morphèmes de l’unité verbale :
prép. conj. PP nég. 1 MC lexème suxes (tps., mode, pers.) nég. 2
car je ne le mange -rai pas
pour que je ne le mange pas
Ce schéma appelle quelques remarques générales :
les prépositions et conjonctions sont parfois décrites, dans d’autres cadres théoriques, comme
unités à part entière : ici, elles sont intégrées comme faisant partie des unités (verbale ou
nominale), au début de celles-ci (sauf quelques cas particuliers).
”PP” désigne le ”préxe de personne” dans le modèle présenté. On considère qu’il est solidaire
du ”suxe de personne”, puisque les variations de l’un et de l’autre sont conjointes : on
est dans un cas de marquage discontinu (cf. cours de morphologie) : un seul morphème
mais qui est fragmenté en diérents lieux. La grammaire traditionnelle parle de ”pronom
personnel” pour je, tu, il / elle / on, etc., mais nous réserverons ici la notion
de ”pronom” à quelque chose qui pourra constituer une unité entière (il s’agira d’une
variante de l’unité nominale) : pour éviter une confusion terminologique qui ferait utiliser
”pronom” soit comme un morphème à l’intérieur d’une unité, soit comme une unité, nous
n’appelons donc pas ”pronom” cette série de termes.
la négation subira elle aussi un phénomène de ”marquage discontinu” : elle sera marquée à
la fois par le ne et par le pas, qui sont solidaires au sein de l’unité : on ne peut enlever /
insérer l’un sans faire de même pour l’autre 1.
1Cela varie selon les registres de langue : on peut trouver des locuteurs disant pas sans ne, voire l’inverse,
mais cette variation relève de la sociolinguistique.

4 UNE PRÉSENTATION DE LA SYNTAXE 4
”MC” désigne l’appellation ”morphème complémentaire”. Ici aussi, la grammaire tradition-
nelle parle de ”pronoms” (”clitiques”, ”atones”, etc.), mais, pour la même raison que plus
haut, nous réserverons la notion de ”pronom” à des éléments qui constitueront un type
spécique d’unité nominale 2.
les suxes : celui de personne est solidaire du préxe de personne, comme nous l’avons vu.
Selon les verbes et les conjugaisons, il peut être assez facile de bien distinguer chaque mor-
phème : nous mangerions :mang- lexème, -er- marque de innitif / futur / conditionnel,
-i- conditionnel, -ons personne. Dans d’autres cas, il est plus dicile de les distinguer
car les morphèmes connaissent un amalgame, et le lexème du verbe peut lui-même être
amalgamé : par exemple : il a.
De manière générale, on perçoit que ces unités, ”nominale” et ”verbale”, sont structurées
autour d’un lexème, qui peut être environné ou non par d’autres morphèmes. Nous considérerons
que le chien est une unité nominale, tout comme et avec le chien : si, dans certains cas,
tous les morphèmes potentiels ne sont pas présents, on décrira simplement l’unité avec ou sans
ces morphèmes (on pourra parler d’absence signicative, cf. cours de morphologie), mais on
leur donnera le même statut. De même, je mange et pour que je ne le mange pas seront
tous deux considérés comme des unités verbales au même titre, mais la seconde contient plus
de morphèmes explicitement présents ; néanmoins, la première les contient aussi virtuellement,
puisque l’on peut établir des rapports d’opposition pertinents entre je mange et je mange-rai,
je le mange,je ne mange pas, et observer dans tous les cas une régularité dans la position
des diérents éléments.
4.1.3 Diérentes formes d’unités :
L’approche que nous avons proposée se concentre autour de deux types d’unités principales,
nommées ”unité nominale” et ”unité verbale”. En établissant les morphèmes qui peuvent ou non
s’y trouver, elle propose un schéma relativement simple pour expliquer la plupart des construc-
tions syntaxiques du français. Néanmoins, elle soulève deux dicultés : premièrement,, l’état
actuel de ce que nous avons présenté ne permet pas de rendre compte de l’existence de notions
présentes dans la grammaire traditionnelle : adjectifs, pronoms, adverbes ; deuxièmement,,
elle ne rend pas compte de toutes les constructions possibles du français.
Pour résoudre ces deux dicultés, il faut considérer que les schémas donnés pour les unités
nominale et verbale ne sont que des formes canoniques qui connaissent ensuite un certain
nombre de variantes ou formes.
Les formes de l’unité verbale :
Par exemple, sans prétendre ici donner une liste exhaustive de toutes les constructions
possible, on observera que l’unité verbale pourra connaître un certain nombre de changements
selon les cas, où certains morphèmes se trouveront ou non présents, et leur ordre inversé :
2Il serait possible de revenir de manière plus détaillée sur ces éléments : on y observerait l’existence de deux
séries : me, te, le / la, nous, vous, les et me, te, lui, nous, vous, leur, et d’autres éléments comme
en,y. La première série correspond aux relations ”objet direct”, où l’unité verbale est mise en relation avec une
autre unité, sans préposition, et la seconde, aux relations dites ”objet indirect”, introduites par la préposition
à. On verrait aussi que certaines combinaisons sont possibles : le lui,lui en,l'en.

4 UNE PRÉSENTATION DE LA SYNTAXE 5
La forme interrogative :
nég. 1 MC MC lexème suxes (tps, mode, pers.) PP nég. 2
Ne les lui donn- -er-as -tu pas ?
La forme impérative :
Lexème su. MC MC
Donn- -ons -les lui !
La forme innitive :
nég. 1 nég. 2 MC MC lexème su. inf.
Ne pas les lui donn- -er
Etc.
Les variantes de l’unité nominale
Nous pouvons aussi considérer que l’unité dite ”nominale” connaît plusieurs formes. Au prix
d’un écart alors assez grand envers les classications de la grammaire traditionnelle, il serait
possible de retrouver des notions comme ”adjectif”, ”pronom”, et ”adverbe”, comme autant
de variantes de ce type. Le modèle que nous avions présenté sera alors considéré comme la
”variante substantive” de l’unité nominale :
conjonction préposition déterminant lexème suxe (nombre)
et avec les chien -s
On constatera que d’autres catégories grammaticales partagent avec cette unité un certain
nombre de ressemblances, même s’il faut prendre en compte des particularités pour chacun des
cas.
La variante adjectivale :
• Elle n’est pas prédéterminée en genre : alors que la variante substantive possède généra-
lement un genre imposé (la maison et non *le mains,le bureau et non *la bureau,
etc.) 3, la variante adjectivale n’a pas de genre contraint : elle peut être au masculin ou
au féminin, selon les contraintes de l’unité substantive avec laquelle elle sera en relation :
grand /grande ;petit /petite, etc.
• Elle peut accueillir un intensif : on peut ajouter si ou très avant une unité adjectivale,
ce que l’on ne peut pas faire avant une substantive : une si grande /*une très maison
4.
Son schéma serait donc :
3Quelques cas de variantes substantives pourraient s’opposer à cette classication : ainsi les noms d’animaux :
chien /chienne,chat /chatte, etc. Mais il n’est pas facile de généraliser à ce sujet, puisque l’on a des couples
marqués par des lexèmes radicalement diérents (vache /taureau,cheval /jument,cochon /truie, etc.), et
d’autres marqués par un nom épicène, qui désigne à la fois le mâle et la femelle : grenouille,crapaud, etc.. Les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%