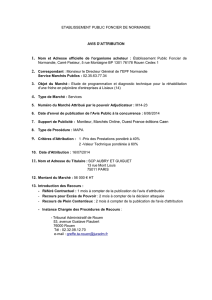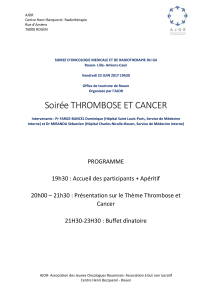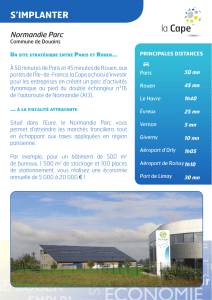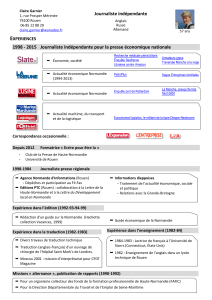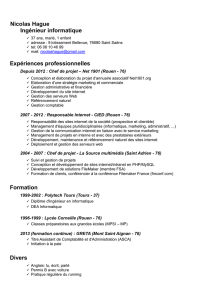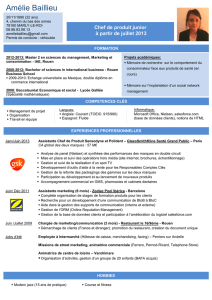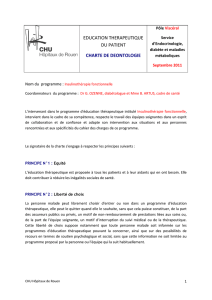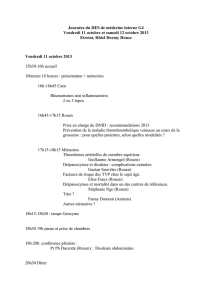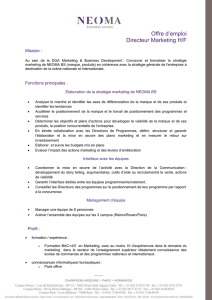Les Juifs de Normandie

Jeudi 3 novembre 2011
Office de tourisme de Rouen Vallée de Seine
Journée d’étude
organisée par l’association
La Maison Sublime de Rouen
en partenariat avec la Ville de Rouen
Les Juifs
de Normandie
dans la société
et la culture médiévales
www.lamaisonsublime.fr
Place de la Cathédrale, Salle Georges d’Amboise
PROGRAMME

PROGRAMME
Accueil (8h30)
Matinée (9h-12h15)
9h00 Ouverture
Jean-Robert RAGACHE,
président de l’association LMSR
Guy PESSIOT,
adjoint au maire de Rouen, président de l’office
de tourisme de Rouen Vallée de Seine
9h10 Les enjeux de la journée d’étude
Jacques-Sylvain KLEIN, délégué de l’association
LMSR, auteur de La Maison Sublime, L’École
rabbinique et le royaume juif de Rouen
Une communauté juive importante existait à Rouen
et en Normandie au Moyen Age. Trente-cinq ans
après la découverte de la Maison Sublime, qui est le
plus ancien monument juif de France (vers 1100),
de nombreuses questions continuent à se poser : A
quand remonte l’implantation de cette communauté ?
Quel était son statut et peut-on réellement parler d’un
« royaume juif » ? Quels métiers exerçaient les juifs
en Normandie et comment se répartissaient-ils sur le
territoire ? Quelles relations entretenaient-ils avec les
chrétiens et avec la communauté juive anglaise ? Quelle
était la topographie du quartier juif de Rouen et où
peut-on situer la synagogue et la yeshiva ? Quelle était
l’importance de l’Ecole rabbinique de Rouen ? Quels
maîtres enseignaient dans cette académie et quelles
relations entretenaient-ils avec les savants français
et étrangers ? Quelle influence les oeuvres produites
par les érudits de Rouen ont-elles eu, en France et
en Europe ? Dans quelles conditions la communauté
juive a-t-elle été expulsée d’Angleterre et de France,
au tournant du XIVe siècle, et quelles conséquences
en ont résulté pour le judaïsme normand ?
Telles sont les principales questions auxquelles
cette journée d’étude se propose de répondre.
9h30 Projection du documentaire
Que cette maison soit sublime
réalisé par Cécile PATINGRE, avec le concours
des étudiants du BTS audiovisuel du lycée Corneille
de Rouen
9h45 La présence juive en Normandie
au Moyen Âge
Présidence de Henry DECAËNS,
vice-président de l’office de tourisme de Rouen
Vallée de Seine, président du conseil scientifique
de l’association LMSR
Rouen et la Normandie au Moyen Âge
Jean-Robert RAGACHE, ancien professeur à l’IUFM
de Rouen, coauteur d’une Histoire de la Normandie
Une Normandie médiévale puissante par son expansion
territoriale, due à des conquêtes ou des alliances, mais
aussi à sa richesse agricole et à sa position maritime
exceptionnelle. A cela s’ajoute une administration
solide, avec un pouvoir central fort incarné par le
duc, auquel est adjointe une Assemblée des barons
qui deviendra Echiquier en 1130, et qui est assisté
localement par des vicomtes dévoués. Longtemps,
Rouen aura le rôle de capitale, par son importance
symbolique (sacre des ducs) et intellectuelle et par
sa puissance économique due à ses productions
industrielles mais aussi à son activité portuaire.
Tout cela crée une bourgeoisie d’argent puissante, à
laquelle va être concédée une Charte communale au
milieu du XIIe siècle, « les Etablissements de Rouen »,
qui lui accorde des privilèges non négligeables.
C’est dans ce contexte que va se développer une
communauté juive importante, qui connaîtra
aux XIIe et XIIIe siècles sa période la plus faste.
Vin de pommes et de poires :
les juifs en Normandie de Guillaume
le Conquérant à Philippe le Bel (1066-1306)
Gérard NAHON, directeur d’études émérite à l’École
Pratique des Hautes Études (Sorbonne)
Cette communication signale d’abord les paysages juifs
de la Normandie en fonction de vestiges toponymiques
extrêmement nombreux suggérant une préhistoire
rurale puis urbaine du judaïsme normand. Elle présente
ensuite les deux siècles proprement historiques de
notre Moyen Age : le XIIe siècle normand et anglo-
normand jusqu’en 1204 et le XIIIe siècle capétien,
depuis Philippe Auguste jusqu’à l’expulsion des Juifs
par Philippe le Bel en 1306. Pour chacune de ces
périodes, elle décrit le statut, la fiscalité, l’économie,
la vie communautaire et privée des juifs normands.
Elle met en lumière la participation normande au
grand œuvre du judaïsme français médiéval, la
translatio du Talmud de Babylone en Europe grâce
à la composition et à la diffusion d’une immense
littérature hébraïque, les tossaphot ou additions, et
particulièrement les tossaphoth de Touques, la base de
nos éditions du Talmud depuis la première impression
d’un traité du Talmud par Israël Nathan ben Samuel
et son fils Josué-Moïse à Soncino ( Italie) en 1484.

L’expulsion des juifs d’Angleterre (1289)
et de France (1306) et ses conséquences sur les
juifs de Rouen et sur le quartier juif
Alain SADOURNY, doyen honoraire de la faculté
des lettres de Rouen
A la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, pour
des raisons quasiment identiques, Édouard Ier roi
d’Angleterre (en 1289) et Philippe IV le Bel roi de
France (en 1306) expulsent les juifs de leur royaume.
Cette communication essaiera de voir, pour les
Juifs d’Angleterre et surtout pour ceux de Rouen,
quelles conséquences eut cette expulsion. Pour ceux
de Rouen, cela signifia la vente de leurs biens et
leur cession à la Commune et au maire de Rouen,
la destruction progressive du Clos aux Juifs et
celle des bâtiments prestigieux qui s’y trouvaient
(notamment ce que l’on appelle la Maison sublime).
La communication se terminera par quelques
considérations sur la réinstallation de quelques Juifs
dans le quartier Saint-Sever dès la fin du XIVe siècle.
11h15-12h15 Débat
12h30-15h
Déjeuner à La Cave, 39 rue aux Ours
Visite guidée de la Maison Sublime
Après-midi (15h-18h30)
15h00 Le rayonnement de l’École rabbinique
de Rouen
Présidence de Max POLONOVSKI, conservateur en
chef du patrimoine, chargé de mission pour la protec-
tion du patrimoine juif au ministère de la Culture
De la Schola Judaeorum au Clos-aux-Juifs :
le quartier juif de Rouen au Moyen Âge
Jacques LE MAHO, chargé de recherche au CNRS
(Centre de recherches archéologiques et historiques
de Caen)
Les origines du quartier juif de Rouen remontent
vraisemblablement à la fin du IXe siècle, lorsque
la transformation de la cité en ville-refuge sous la
menace des incursions normandes entraîna une
restructuration de la voirie et du cadastre dans
le secteur intra-muros. Principalement destinée à
rassembler dans la cité la population des faubourgs
marchands, cette opération fut sans doute réalisée à
l’initiative du roi Eudes, vainqueur des Normands au
siège de Paris (885-887), pour permettre la reprise
des activités économiques sur l’axe de la Seine.
À l’instar des Scholae peregrinorum du bourg de
Saint-Pierre à Rome, mentionnées dans de nombreux
documents de l’époque carolingienne, la Schola
Judeorum de Rouen a d’abord désigné la communauté
juive de la ville, avant de désigner l’ensemble des terrains
et des édifices occupés par cette communauté. À la fin
du Moyen-Âge, ce quartier urbain est identifié comme
« l’École-aux-Juifs » et, au dernier stade de l’évolution
phonétique du vocable, comme le « Clos-aux-Juifs ».
Le quartier s’ordonnait en deux séries de parcelles
alignées de part et d’autre de l’actuelle Rue-aux-Juifs,
entre la paroisse de Notre-Dame-de-la-Ronde (au
sud) et la paroisse Saint-Lô (au nord). On ne dispose
d’aucune information sur l’habitat et son organisation
avant le XIIe siècle. À partir de cette date, l’archéologie
atteste l’existence de plusieurs grandes demeures de
pierre, offrant les caractéristiques habituelles des
manoirs urbains des XIIe et XIIIe siècles : implantation
en retrait de la rue, présence d’un vaste cellier en
partie basse, de puits et de latrines, accès privatifs.
Par leur ampleur et leur qualité architecturale,
par leur plastique murale et la présence de décors
sculptés (édifice de la cour du Palais-de-Justice), ces
belles demeures de notables procèdent d’un souci
de représentation semblable à celui des maisons
des chanoines de la cathédrale à la même époque.
L’École rabbinique de Rouen :
Une brève histoire de sa découverte, du travail
de ses érudits et des ramifications touchant
à l’histoire intellectuelle de la Normandie
et de la France
Norman GOLB, professeur à l’Université de Chicago,
auteur de Les Juifs de Rouen au Moyen Âge, portrait
d’une culture oubliée et de The Jews in Medieval
Normandy
Le véritable début des découvertes touchant à la
communauté juive de Rouen et aux activités de ses
érudits remonte au début des années 1960, avec
la découverte par l’auteur d’un document ancien,
provenant de la Geniza du Caire et conservé à
Cambridge, qui évoquait la figure de Reuben bar
Isaac de Rodom (Rouen/Rotomagus) et la tragique
confiscation de ses terres par le duc de Normandie
au XIe siècle. Cette découverte conduisit l’auteur
à l’identification ultérieure, dans des manuscrits
hébraïques médiévaux, d’une trentaine d’autres
textes ou fragments de texte mentionnés, dans ces
mêmes manuscrits, comme étant d’origine rouennaise.
La plupart de ces textes traitait des activités
académiques de certains érudits juifs rouennais,
activités s’exerçant principalement dans une école
d’enseignement supérieur (yeshiva ou école juive).
Quelques mois seulement après la publication par
l’auteur, au printemps 1976, d’un livre sur le sujet,
les vestiges d’une structure monumentale, datant
des débuts du XIIe siècle, furent découverts dans
la cour du Palais de Justice, à l’endroit précis où

Fondation
duJudaïsme
Français
www.ca-rouen.justice.fr
La journée d’étude bénéficie du soutien de
Conception graphique et photographies - point de vues
l’historien rouennais Charles de Beaurepaire avait
mentionné l’existence d’une « Ecole aux Juifs ».
Les travaux des érudits et des étudiants de l’Ecole aux
Juifs de Rouen, ainsi que la diffusion du savoir de
cette académie vers l’est européen, avant et après l’âge
d’or de cette école, constitueront le sujet principal de
cette communication. L’auteur présentera également,
brièvement, les principales autres écoles rabbiniques
de la France médiévale, dont, malheureusement, plus
aucun vestige ne subsiste aujourd’hui. Par à un concours
de circonstances totalement fortuit, seuls les vestiges de
l’Ecole de Rouen subsistent encore, qui permettent de
témoigner de l’éclat littéraire et intellectuel des érudits
de la communauté juive dans la France médiévale.
Le rôle social du savant itinérant :
l’exemple d’Abraham Ibn Ezra
Gad FREUDENTHAL, professeur à l’Université de
Genève et directeur de recherches émérite au CNRS
Une des lumières de la vie intellectuelle de Rouen
au XIIe siècle était un savant tout à fait étranger à
sa culture : Abraham Ibn Ezra. L’oeuvre d’Ibn Ezra
comprend l’exégèse biblique, la grammaire, la poésie,
l’astronomie et l’astrologie. Ces domaines d’intérêt, de
même que la substance de la pensée d’Ibn Ezra, reflètent
le curriculum de la science gréco-arabe en Andalousie,
son pays natal. Comment se fait-il qu’Ibn Ezra soit
parvenu à Rouen, après avoir séjourné en Italie et en
Provence? Pourquoi est-il devenu un savant itinérant?
Je proposerai à cette question une réponse d’ordre
sociologique. Pour étayer mes propos, je comparerai
le rôle social d’ Abraham Ibn Ezra à ceux d’autres
savants contemporains, notamment Judah Ibn
Tibbon d’un côté et les rabbins de Tzarfat de l’autre.
16h30 Débat
17h30 Conclusion des travaux
Max POLONOVSKI
18h00 Clôture de la journée
Valérie FOURNEYRON, députée maire de Rouen
18h15 Remise de la Médaille de la Ville
à Serge BRARD et Raymond BOSQUAIN, anciens
employés de l’entreprise LANFRY et découvreurs de
la Maison Sublime en 1976
Cocktail de clôture
Jean-Pierre ALLALI,
écrivain et journaliste, dédicacera son roman
Les Vengeurs de la Maison Sublime, paru en
septembre 2011 aux éditions Glyphe
La journée est placée sous la direction
scientifique de Max POLONOVSKI
1
/
4
100%