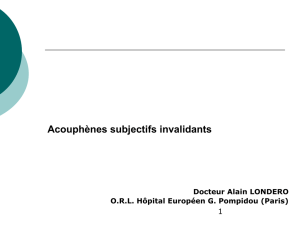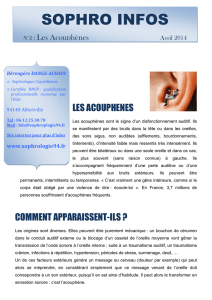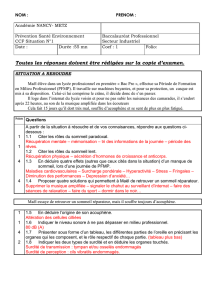Tinnitus Whitepaper

M MM M
M
M
MMM
U
U U
U
U
U U
T
U
Évaluation de l´acouphène
la clé du succès
de sa prise en charge
Wendy Switalski, Au.D
Clement Sanchez, Aud Msc
www.otometrics.fr

www.otometrics.fr 2
1. Introduction
Un audioprothésiste rencontrant un patient se plaignant
d´un acouphène aura besoin d´identifier et de quantifier
le symptôme subjectif. Ceci est nécessaire afin d´établir le
type clinique de l´acouphène mais également pour recom-
mander et pour sélectionner l´instrumentation correcte afin
de traiter la plainte et de soulager le patient. Selon Richard
Tyler, PhD, Professeur d´Otolaryngologie à l´université de
Iowa, «la quantification d´un symptôme est fondamentale
afin de comprendre ses mécanismes et traitements. Si nous
ne pouvons le mesurer, nous ne pouvons l´étudier» (Tyler,
2000). Les chercheurs, cliniciens, et les autres professionnels
qui s´intéressent à l’acouphène subjectif idiopathique ont
tenté de rendre plus objective la mesure de l´acouphène et ont
recherché des méthodes pour sa quantification. Cet article a
pour objet d´énoncer les raisons de conduire une évaluation
de l´acouphène et de décrire comment cette évaluation peut
être facilitée en utilisant des mesures psycho-acoustiques ainsi
que les questionnaires disponibles les plus utilisés.
2. Raisons pour conduire une
évaluation de l´acouphène
Il y a plusieurs raisons pourquoi l´évaluation de l´acouphène
– en tant que partie intégrante de l´examen audiologique du
patient acouphénique – peut être bénéfique pour le patient
ainsi que pour le professionnel.
Améliorer la communication entre le patient et
l´audioprothésiste
Une évaluation de l´acouphène peut fournir la base d´une
communication de qualité entre l´examinateur et le patient à
propos du symptôme. L´évaluation offre à l´audioprothésiste
une cartographie plus objective de l´acouphène comparative-
ment à la description d´un phénomène acoustique avec les
mots du patient. La « qualité » de l´acouphène (tintement,
claquement, sifflement…) n´est pas toujours d´un point de
vue diagnostique intéressante, mais cependant peut alerter
l´otologiste sur des problèmes vasculaires (rythme, souffle)
et/ou d´oreille moyenne (claquement). En général, cepen-
dant la corrélation entre la qualité et l´étiologie n´a pas été
démontrée scientifiquement.
Rassurer et fournir les bases d´un conseil effectif
L´évaluation rassure également le patient qui perçoit enfin
son acouphène dans le réel. En effet pour beaucoup de pa-
tients le simple fait que l´acouphène ne puisse être perçu que
par eux-mêmes augmente le sentiment de détresse. Mesurer
l´acouphène les rassure car cela le rend perceptible par
autrui. L´évaluation permet également de reproduire un son
similaire à celui identifié comme étant celui de l´acouphène
et permet de fournir une démonstration aux proches de ce
que le patient peut ressentir.
Etablir un point de référence
Les paramètres de l´évaluation de l´acouphène fournissent un
point de référence depuis le moment de la première évalua-
tion et pendant le traitement et le contrôle de celui-ci. Ceci a
pour objet d´aider à déterminer si l´acouphène a changé et si
le traitement est en effet efficace.
Fournir des lignes directrices et aider au diagnostic
Les mesures de l´acouphène fournissent également des lignes
directrices. La mesure de la masquabilité ou de la hauteur
tonale peuvent aider le professionnel à régler le niveau et le
spectre du signal utilisé dans la thérapie sonore. Les élé-
ments de l’évaluation apportent également des indices à
l´otologiste quant au site à l´origine de l´acouphène. Selon
Douek et Reid (1968), en général, la hauteur tonale de
l’acouphène dans les cas de maladie de Ménière se situe
généralement entre 125 et 250 Hz tandis que dans les cas de
presbyacousie elle se situerait entre 2 et 8 kHz.
Catégoriser
L´évaluation de l´acouphène permet de distinguer entre dif-
férentes sous catégories d´acouphènes. Cependant, deux pa-
tients peuvent rapporter la même qualité dans la perception
de leur acouphène tel le caractère sifflant de celui-ci, l´un
peut être masquable tandis que l´autre pas. Cela indiquera
quel traitement sera effectif dans un cas et pas dans l´autre.
Sélectionner le traitement
L´évaluation peut aider le professionnel à déterminer si le
patient peut bénéficier de certains types de traitement.
Beaucoup de patients réagissent différemment en entendant
le même stimulus acoustique.

www.otometrics.fr 3
Documenter la présence de l´acouphène dans un cadre
légal
Enfin, l´évaluation de l´acouphène peut être utile dans des
situations où une documentation de la plainte est néces-
saire. Pour des raisons d´ordre légal plusieurs points doivent
être validés tels que la présence de l’acouphène, le degré de
gêne, d´incapacité et/ou de handicape.
3. Mesures psychoacous-
tiques et questionnaires
Cette section explique comment l´acouphène peut être
évalué, non seulement en termes de composants psycho
acoustiques, mais également afin d´évaluer son impact
sur la vie quotidienne du patient au travers des mesures
psycho-acoustique et des questionnaires, le testeur identifie
et quantifie les complaintes subjectives liées à l´acouphène,
et les résultats établissent le type clinique de l´acouphène
et constituent la base de recommandations audiologiques
spécifiques quant à l´instrumentation de « contrôle » de
l´acouphène.
Note : il est important de noter qu´une évaluation cochléo-
vestibulaire complète devrait être réalisée avant l´évaluation
de l´acouphène
3.1 Les mesures psycho-acoustiques
La psychophysique étudie la relation entre les organes
sensitifs et le monde physique. La psycho-acoustique est
une branche de la psychophysique qui étudie la relation
entre le monde perceptif et l´acoustique. Les effets psycho-
acoustiques qui découlent des stimuli acoustiques et qui
constituent les fondements de l ´évaluation de l´acouphène
comprennent:
• La tonie (pitch)
• La sonie (loudness)
• L´effet de masque
• L´inhibition résiduelle
L´équipement
Afin de réaliser ces mesures, le professionnel devra s´équiper
d´un audiomètre bi-canal offrant des stimuli en sons purs,
bruits en bandes étroites et larges bandes. Cet audiomètre
doit permettre la stimulation unilatérale ainsi que bilatérale,
dans les hautes fréquences (20 kHz) avec une résolution d´1
Hz et de 1 dB, de même que le test de confusion d´octave
(OCT).
La méthode de mesure
Stevens a décrit en 1938 sept méthodes de mesures de la
tonie ainsi que de la sonie (ajustement, limites, paires com-
parées, stimuli constant, quantile, ordre de mérite et échelle
de notation). Le propos de ces méthodes psycho-acoustiques
est de trouver des méthodes fiables pour déterminer ce que
l´individu ressent de façon perceptive. À ce jour la méthode
la plus populaire est celle des paires comparées pendant
laquelle le patient doit nécessairement choisir un stimulus
parmi deux différents. Après en avoir choisi un, le second
essai s´appuie sur le stimulus précédemment sélectionné
ainsi que sur un stimulus plus haut (en terme de niveau
ou de hauteur tonale). Cette méthode est répétée jusqu´à
pouvoir sélectionner le stimulus se rapprochant le plus de
l´acouphène. Cette méthode du choix forcé entre deux
alternatives (2AFC) est également suggérée par Vernon et
Fenwick (1984) comme étant celle la plus fiable dans le cadre
de l´évaluation de l´acouphène.
L´oreille testée
Le choix de l´oreille testée peut avoir une influence sur les
résultats. La tonie peut varier selon quelle oreille reçoit
le stimulus (Tyler & Conrad, 1983). Si la stimulation est
ipsilatérale, l´acouphène peut être modifié en réponse à la
présentation. Cependant des résultats imprécis peuvent être
obtenus lorsque la stimulation est controlatérale. Finalement,
la présentation binaurale peut être problématique pour ces
raisons et parce que le patient peut entendre différemment
d´une oreille à l´autre. Cependant, il y a un consensus parmi
les professionnels qui vise à recommander la stimulation
ipsilatérale et monaurale. Le testeur doit également noter
l´oreille « test » (Goldstein, 1997 ; Tyler, 2000).
La stimulation
Les recommandations sont d´utiliser un son pur, mais le bruit
bande étroite est également utilisé en dépit des problèmes
potentiels liés à son utilisation. Une solution alternative est
d´utiliser le bruit FRESH (FREquency Specific Hearing assess-
ment noise, Walker, Dillon, & Byrne, 1984). Ce bruit est un
signal bande étroite dont le spectre présente des filtres aux
pentes très raides. La stimulation continue est préférée aux
sons pulsés plus difficiles à utiliser pour le patient (Mineau &

www.otometrics.fr 4
Schlauch, 1997). Le temps de présentation devrait se situer
aux alentours des 500 ms avec des intervalles de 5 secondes.
Mesure#1 : la hauteur tonale de l´acouphène (Pitch
Matching)
La hauteur tonale (tonie) est la caractéristique psycho acous-
tique qui correspond le plus à la dimension physique de la
fréquence. C’est la mesure la plus commune. L´objectif est
de quantifier l´acouphène en termes de fréquence (Hz). La
tonie peut être utilisée comme point de référence lors de la
consultation mais également dans le cadre de la sélection et
de l´adaptation de l’instrumentation acoustique, ou de trou-
ver le site d´origine de l’acouphène. En dépit du fait que la
description de l´acouphène par le patient lui-même peut être
très différente d´un sujet à l´autre, Meikle rapporte que 92%
d´un échantillon de 1.033 patients peuvent conduire le test
de la tonie. L’estimation subjective utilisant une échelle vi-
suelle de 0 à 10 est typiquement notifiée comme « haut » ou
« aigue ». Par exemple, Stouffer et Tyler (1990) ont rapporté
une note moyenne de 7,12 avec 65% des patients notant
leur acouphène 7 ou supérieur (Slater et Terry, 1987). Pour
la plupart des patients, la tonie de l´acouphène est située
aux alentours de 3 kHz (Reed, 1960 ; Vernon, 1987 ; Meikle,
1995). Il y a une forte corrélation avec la perte auditive as-
sociée des patients située principalement dans les hautes
fréquences. Pour plusieurs chercheurs, il y a un lien entre
la tonie de l´acouphène et la région fréquentielle où se situe
la perte auditive maximale (Mintone, 1923 ; Fowler, 1940 ;
Fraham et Nerby, 1962 ; Douek et Reid, 1968 ; Penner, 1980
; Meikle et al. 1999).
Typiquement la mesure de la tonie suit la procédure comme
indiquée dans l´exemple ci-dessous (tableau). Une sonie
stable entre les fréquences devrait être appliquée. Pour ce
faire l´opérateur peut utiliser les valeurs des seuils de confort
(MCL) dérivées de l’audiométrie tonale.
Stimuli de comparaison
Stimulus jugé comme
étant le plus proche
de l´acouphène
Essais 1 1 kHz vs 2 kHz 2 kHz
Essais 2 2 kHz vs 3 kHz 3 kHz
Essais 3 3 kHz vs 4 kHz 4 kHz
Essais 4 4 kHz vs 5 kHz 4 kHz
Essais 5 4 kHz vs 4.5 kHz 4 kHz
Essais 6 4 kHz vs 4.25 kHz 4.25 kHz
Essais 7 4.12 kHz vs 4.25 kHz 4.12 kHz
Essais 8 4.12 kHz vs 4.18 kHz 4.12 kHz
Essais 9 4.12 kHz vs 4.125 kHz 4.125 kHz
Lorsque la recherche de la tonie est réalisée il est recom-
mandé de confirmer les résultats avec le test de confusion
d´octave (OCT). La confusion d´octave apparaît lorsqu´un
individu identifie une fréquence spécifique comme la tonie
de son acouphène mais avec une investigation plus pous-
sée, l´identification de l´acouphène est en fait localisée
une octave au-delà de la tonie. Dans l´exemple ci-dessus la
tonie identifiée à 4.125 est comparée avec l´octave supéri-
eure (8.250 Hz). Dans les audiomètres modernes, passer à
l’octave supérieure pour contrôler la possibilité d´une confu-
sion se réalise très simplement à l´aide d´un unique bouton
comme représenté ci-dessous.
Mesure#2. La sonie de l´acouphène (Loudness Match-
ing)
La méthode du choix forcé entre 2 alternatives (2-AFC)
peut être substituée par la méthode ascendante des limites
qui commencera légèrement en dessous du seuil absolu
d´audition en comparant la sonie du stimulus avec celle de
l´acouphène. Cette méthode minimise l´effet de l´inhibition
résiduelle. Le résultat devrait aussi être discuté en regard
de la présence de recrutement (distorsion de sonie). La
fréquence de test est la même que celle de la tonie pré-
alablement relevée. Dans les études les études de Reed,
Seuil auditif à
la fréquence
de l’acouphène
(Tonie)
Localisation de
l’acouphène
(tonie et
sonie)
Niveau (sonie) de
l´acouphène – seuil
auditif à la fréquence
de l´acouphène

www.otometrics.fr 5
Donaldson, Bailey, Roeser et Price, et Shailer et Al, tous ont
trouvé que les techniques d´équilibrage de la sonie résultent
généralement en une valeur comprise entre 0 à 20 dB SL.
Nous exprimons les résultats ici en dB SL (Sensation Level)
étant donné qu´il s´agit de la différence entre les résultats en
dB HL et le seuil auditif absolu à la fréquence de la tonie. Gé-
néralement, la tonie ne se retrouve pas dans les fréquences
conventionnelles, donc la recherche d´un seuil à la fréquence
spécifique de la tonie est nécessaire afin de convertir le
résultat en une valeur absolue exprimée en dB SL.
Stimuli de comparaison
Stimulus jugé comme
étant le plus proche
de l´acouphène
Essais 1 55 dB vs 60 dB 60 dB
Essais 2 60 dB vs 65 dB 65 dB
Essais 3 65 dB vs 70 dB 65 dB
Essais 4 65 dB vs 68 dB 65 dB
Essais 5 65 dB vs 66 dB 65 dB
Mesure #3 : l’effet de masque
Le masquage de l´acouphène est souvent considéré comme
la partie la plus importante de l´évaluation de l’acouphène.
Cette procédure permet au professionnel d´évaluer si le
patient est candidat pour un générateur de bruit afin de
contrôler l´acouphène. Il précise également les oreilles qu´il
faudrait appareiller et aide à identifier la cause et le site de la
lésion. Cependant, la corrélation entre la condition et l´effet
de masque n´est pas totalement prouvée. Selon Goldstein
(2000) et Vernon (1987) la population acouphénique pour
laquelle il n´y a pas d´effet de masque est d´environ 18% et
9% et ces patients ne peuvent pas être candidats respective-
ment au masquage acoustique ou à la stimulation électrique.
Le fait que l´acouphène puisse être masqué suggère que
l’acouphène et la réponse à la stimulation acoustique parta-
gent les mêmes canaux neuronaux dans le système nerveux.
Le seuil de masque d´un acouphène fut initialement décrit
par Feldmann dans Audiology (10 :140) en 1971 où différ-
entes courbes de masquage furent classées selon 6 types.
Les courbes de masquage sont établies ipsilatéralement et
controlatéralement en utilisant des bruits blancs et à bandes
étroites. Le masquage en psycho-acoustique diffère du mas-
quage de l´acouphène selon les façons suivantes:
1. Dans des systèmes auditifs sains, le signal à masquer et
le stimulus masquant ont des paramètres bien définis
et la sensation est prédictible. Dans un système auditif
déficient avec acouphène, la sensation est imprédictible
(Feldmann, 1934) étant donné que le signal qu´il faut
masquer est inconnu.
2. Dans les cas d´acouphènes, la relation de dépendance en-
tre l´effet de masque et la fréquence n´existe plus ou peut
être inversée, par exemple les hautes fréquences pouvant
être plus masquantes que les basses fréquences.
3. En situation sans acouphène, on ne peut pas masquer un
bruit blanc par un son pur, en situation d´acouphène, cela
est possible et avec un niveau faible de son pur.
4. Dans le cadre d´un masquage normal, le stimulus mas-
quant peut être appliqué de façon ipsilatérale, sinon le
niveau du stimulus doit être très important pour être effi-
cace (Liden, Nilsson et Anderson, 1959). Dans une oreille
acouphénique, un son très faible appliqué dans l´oreille
controlatérale à l´acouphène peut être très efficace. On
parlera généralement dans ce cas de « masquage central
» (Zwislocki, Buining et Gantz, 1968, Penner, 1987).
5. Le post effet de masque (ou inhibition résiduelle) de-
meure moins d´une seconde dans le cas d´un masquage
classique. Celui de l´acouphène peut être prolongé plus-
ieurs minutes.
Le bruit et les sons peuvent être utilisés durant cette mesure.
La masquabilité est considérée comme positive ou négative
selon qu´il y ait un effet ou non sur l´acouphène.
La mesure de l’effet de masque peut être réalisée à la
fréquence de l´acouphène (tonie) seule, à travers toute la
gamme fréquentielle audiométrique ou les deux. Tout type
de stimulus de masque peut être utilisé mais il est cepen-
dant recommandé d´utiliser les bruits à bandes étroites, les
sons purs ou dans le meilleur des cas le bruit FRESH. Il n´y
a cependant pas de préférence ou indication claire entre le
côté de la stimulation (Ipsi- ou contra- latérale). Ainsi les
deux méthodes peuvent être pratiquées. La comparaison
entre les masques ipsi- ou contra-latéraux suggère que des
mécanismes centraux sont impliqués chez plusieurs patients
(Tyler, 2000) et pourrait aider à distinguer les patients avec
des composants centraux ou périphériques. La méthode
ascendante est généralement utilisée avec une présentation
du stimulus masquant n´excédant pas 2 secondes, puis en
demandant si le bruit peut masquer l´acouphène. La réponse
définit le niveau de masque minimal (MML). Afin d´obtenir
une valeur en dB SL (valeur absolue), avant d´obtenir le
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%