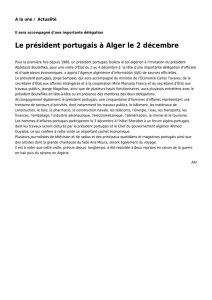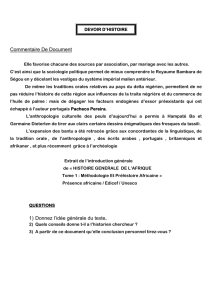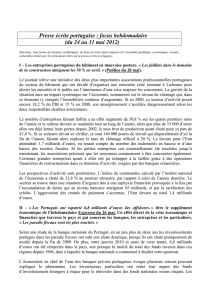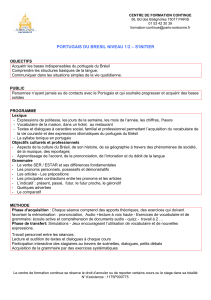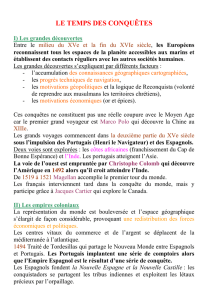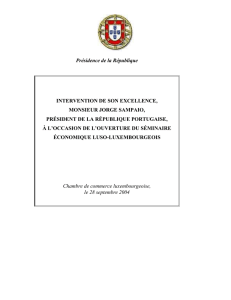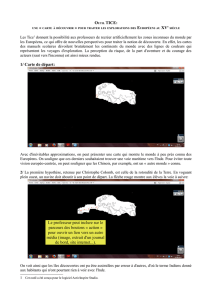Usages du français et double appartenance: le cas des Portugais en

Education et Sociétés Plurilingues n°7, décembre 1999
Usages du français et double appartenance: le cas des Portugais en France
Marie-Claude MUÑOZ
L'immigrazione pone le persone in situazione plurilingue, i loro modi di parlare sono
caratterizzati dall'alternanza, dalla mescolanza dei codici e l'emergenza di una lingua
"mista", risultato di un contatto prolungato tra le lingue presenti. La situazione
plurilingue da luogo a forme di aculturazione linguistica, che vanno dall'acquisizione di
una lingua di comunicazione "dell'urgenza" a quella di una "competenza di
comunicazione più ampia", indice dell'integrazione al sistema culturale del paese
d'accoglienza. Questo articolo presenta l'appropriazione della lingua del paese di
residenza e la trasmissione della lingua d'origine in posizione minoritaria, presso
emigrati portoghesi. Analizza l'utilizzazione del francese e del portoghese, i luoghi
d'espressione nell'una o/e nell'altra lingua (spazio privato, spazio pubblico, paese
d'origine), la scelta delle strutture linguistiche dell'affermazione identitaria delle
generazioni presenti in Francia e la funzione delle lingue nell'espressione e la
realizzazione di un progetto individuale o collettivo.
Immigration places people in plurilingual situations; code-switching and mixing
become typical of their way of speaking, and from prolonged contact between the
languages a "mixed tongue" is born. Plurilingual situations also give rise to various
forms of language acculturation, from acquiring an "emergency" vehicular to a "broader
competence for communication" that marks an individual's personal integration in the
host country. This article presents the acquisition of the host language and the
transmission of their now minority language by Portugese immigrants in France. The
author studies the uses of French and Portugese, in private, in public, and in the home
country. She analyzes the language choices of the new generations in France when
stating their identity, and the function of each in both expressing and carrying through
individual or collective projects.
L’immigration met les locuteurs en situation plurilingue, leurs productions
langagières sont caractérisées par l’alternance, le mélange des codes et
l’émergence d’une langue “mixte” résultant du contact prolongé entre les
langues en présence. La situation plurilingue donne lieu à des formes
d’acculturation linguistique qui vont de l’acquisition d’une langue de
communication de l’urgence à l’acquisition d’une compétence de
communication élargie marquant l’intégration au système culturel du pays
d’accueil. La langue est un moyen de communication sociale et de partage
culturel dont la possession est “un point de rencontre d’enjeux qui
dépassent la stricte compétence instrumentale” (Leclerc-Bovy, 1993). Nous
nous attacherons à l’appropriation de la langue du pays de résidence et à la
transmission de la langue d’origine en position minoritaire par les immigrés
portugais, aux usages du français et du portugais, aux lieux d’expression
dans l’une ou/et dans l’autre langue (espace privé, espace public, pays

M.-C. Muñoz, Usages du français et double appartenance: le cas des Portugais en France
22
d’origine), au choix des supports linguistiques de l’affirmation identitaire
des générations présentes en France et à la fonction des langues dans
l’expression et la réalisation d’un projet individuel ou collectif.
L’immigration portugaise en France
Pays d’émigration transocéanique depuis le 19° siècle, le Portugal voit
changer la destination de son émigration à partir de 1959, désormais elle se
tourne vers les pays industrialisés de l’Europe du nord. Dès le début des
années 60, les Portugais des zones rurales vont partir, pour la majorité,
clandestinement vers la France, poussés par des motifs à la fois
économiques, démographiques et culturels dans un contexte dominé par la
dictature de Salazar et les guerres coloniales. L’émigration économique va
se doubler d’une émigration politique, celle de jeunes gens qui fuient la
conscription pour des guerres coloniales de plus en plus impopulaires.
Composée majoritairement de paysans dans les années 60, l’émigration
touchera également les ouvriers dans les années 70. L’émigration familiale
amorcée dès 1964, s’accentue au début des années 70 par le biais du
regroupement familial. La grande majorité des enfants portugais est née en
France ou y a été scolarisée.
En l’absence de procédure régulière de recrutement et de structures
d’accueil, les liens parentaux, interpersonnels et villageois ont joué un rôle
décisif dans l’organisation sociale des Portugais dans les années 60-70, tout
particulièrement dans les immenses bidonvilles de Champigny, Massy,
Nanterre dans la région parisienne, puis dans la création et l’animation du
réseau associatif dont le dynamisme témoigne aujourd’hui encore de la
vitalité de la communauté portugaise en France.
Evolutions et nouveaux enjeux
Au cours des décennies écoulées, l’immigration portugaise a été marquée à
la fois par les changements politiques intervenus en France (l’alternance au
pouvoir et les politiques d’immigration successives) et par les
bouleversements politiques au Portugal (la fin de la dictature, la fin des
guerres coloniales et de l’empire avec la révolution des oeillets du 25 avril
1974, et dans la dernière décennie, l’entrée dans la Communauté
européenne). Des années provisoires à l’installation en France, on peut
procéder à grands traits à la périodisation suivante: les années 60, années de
clandestinité et de l’auto-organisation; les années 70, années des
régularisations, de la destruction des grands bidonvilles et du relogement
dans l’habitat social, des débuts du mouvement associatif organisé et de la
revendication de cours de portugais aux enfants dans une perspective de
retour, de la construction de la maison au village et du retour effectif de

M.-C. Muñoz, Usages du français et double appartenance: le cas des Portugais en France
23
quelques milliers de Portugais bénéficiaires de l’aide au retour mise en
place par le gouvernement français; les années 80, celles de l’installation en
France, de la mobilité résidentielle – du logement social vers le logement
pavillonnaire et l’accession à la propriété –, du développement du
mouvement associatif du fait de la libéralisation du droit d’association des
étrangers en 1981 et de la démocratisation du Portugal; les années 90,
celles où trois générations sont en scène: les primo-migrants approchent de
la retraite ou y sont déjà et pratiquent le va-et-vient entre la France et le
Portugal, leurs enfants et petits enfants affirment leur double appartenance
et veulent être reconnus par la société française en tant que luso-
descendants.
Aujourd’hui, la construction européenne et les enjeux nationaux et
supranationaux qu’elle implique, changent la position des immigrés
portugais et de leurs enfants: représentations et catégorisations s’en
trouvent modifiées. Les Portugais souffraient d’un déclassement au niveau
symbolique. L’adhésion du Portugal à la communauté européenne en 1986,
l’accès à la libre circulation en 1992 et l’acquisition de la citoyenneté
européenne en 1994, assortie du droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales et au Parlement européen ont eu des incidences tant
symboliques que pratiques pour les immigrés portugais et leurs
descendants. Citoyens européens ces derniers sont le plus souvent
binationaux, la législation portugaise ayant reconnu la double nationalité en
1982.
Quelques données sur la population
On estime à plus de 900 000 les Portugais et les Français d’origine
portugaise en France. Au recensement de 1990, on a dénombré 650 000
Portugais, 22% sont nés sur le territoire français. Les moins de 24 ans
représentent 34,5% de l’effectif et 81% des moins de 20 ans sont nés en
France. 45% des Portugais vivent en Ile de France (à Paris et dans les
départements limitrophes). La population active compte 389 000 personnes
dont 38,5% de femmes. 66% des actifs sont ouvriers. Les hommes sont
dans le secteur secondaire, majoritairement dans le BTS (bâtiment et
travaux publics), les femmes dans le secteur tertiaire des services.
L’enquête (1) de Mobilité géographique et insertion sociale de l’INED
(Institut national d’études démographiques) réalisée en 1992 (Tribalat,
1995), enregistre une légère progression intergénérationnelle dans les
catégories socioprofessionnelles: alors que les pères étaient majoritairement
des ouvriers spécialisés, les fils sont ouvriers qualifiés, techniciens,
contremaîtres et environ 10% ont accédé aux catégories intermédiaires et
supérieures. La mobilité sociale des filles est faible, elles sont

M.-C. Muñoz, Usages du français et double appartenance: le cas des Portugais en France
24
majoritairement employées; 7% exercent des professions intermédiaires et
supérieures. La tendance à une scolarisation plus longue et l’orientation
vers les filières de l’enseignement général et technologique se renforce. On
peut y lire une évolution des projets familiaux: avec le vieillissement de la
population, l’installation en France se confirme et le projet de retour au
Portugal est abandonné ou reporté à l’âge de la retraite. Il ne s’agit plus de
mettre le plus rapidement possible les enfants au travail afin qu’ils
collaborent financièrement à l’économie familiale et à la réalisation du
projet de retour, mais il convient de leur assurer une meilleure formation
scolaire pour un meilleur avenir professionnel en France.
Le rapport à la langue
Dans l’étude du rapport à la langue des immigrés portugais et de leurs
descendants (enfants et petits enfants), il convient de prendre en compte les
deux composantes de la réalité sociale et du vécu: la condition d’immigré
et la relation au pays d’origine. Pour les Portugais, la littérature
sociologique (Charbit et alii., 1997; Oriol, 1983) souligne l’importance du
va-et-vient entre la France et le Portugal tant sur le plan symbolique que
matériel. Les deux langues, le portugais et le français, sont investies
différemment selon que l’on a affaire à la génération des primo-migrants,
ou à celle de leurs enfants ou petits enfants; selon que les parents travaillent
dans un milieu immigré ou français; selon que les familles vivent dans un
environnement portugais, dans un environnement français ou dans un
milieu ethniquement mélangé, en milieu rural ou urbain où les formes de
sociabilité varient; selon qu'il s'agit de couples dont les partenaires sont nés
au Portugal ou en France ou de couples mixtes portugais-français ou d’une
autre nationalité. La vitalité de la langue portugaise est la plus manifeste là
où la densité dynamique de la communauté est la plus forte, où
l’environnement lui offre des lieux de reconnaissance et d’expression (les
associations, les fêtes, les bals, les équipes de football, les chorales, les
groupes folkloriques, les cours de catéchisme, la messe en portugais, les
cours de langue). Cet investissement, s’il est fonction des dynamiques
familiales et environnementales, relève en dernier ressort de choix et de
stratégies individuels d’affirmation identitaire.
La scolarisation précoce, l’environnement et les média mettent rapidement
la langue portugaise en concurrence avec le français. Les frères et soeurs
communiquent entre eux en français, les parents ont acquis une certaine
maîtrise du français et insensiblement le portugais perd du terrain dans la
communication intra-familiale. Il est utilisé en alternance avec le français
selon des règles complexes, en fonction du type d’interactions et des rôles
des locuteurs (registre de l’affectivité, de la plaisanterie ou de l’exercice de

M.-C. Muñoz, Usages du français et double appartenance: le cas des Portugais en France
25
l’autorité). Le français devient prépondérant dans la vie quotidienne. La
maîtrise des codes oraux et écrits du français est une des conditions de
l’ascension sociale. Le portugais est réservé à l’usage informel, intime, des
échanges familiaux ou des échanges à l’intérieur des réseaux
communautaires. Le statut des langues en présence et l’intériorisation par
les locuteurs de ces représentations ont une incidence certaine sur la
transmission. Certains parents, engagés dans un projet de mobilité dans la
société française, ont intériorisé le discours dominant et en particulier celui
de l’institution scolaire, qui a tendance à considérer le bilinguisme des
classes populaires comme un handicap, comme un obstacle aux
apprentissages fondamentaux et à la réussite scolaire, en conséquence ils
ont choisi de ne pas transmettre leur langue à leurs enfants. Rappelons que
la France est un pays monolingue: une seule langue pour tous et que
“l’exception française renvoie à la mystique républicaine de l’unité qui a
fait co(ncider de manière presque parfaite un territoire, une langue et une
culture. Même si la société civile demeure très diversifiée culturellement, le
projet politique n’en demeure pas moins fondé dans l’idéal, sur un
refoulement de la diversité culturelle dans l’espace privé” (Cesari, 1998).
Un des volets de l’enquête de l'INED détaillée plus haut explore les
compétences linguistiques et les pratiques langagières des immigrés.
Connaissance du français et du portugais
75% des Portugais enquêtés, tous âges confondus (20-59 ans), déclarent
une bonne ou très bonne maîtrise du français. 61% des Portugais arrivés
après l’âge de 15 ans parlent bien le français, 51% le lisent, tandis que
seulement 17 % d’entre eux l’écrivent. Les différences entre la maîtrise de
la lecture et de l’écriture trahissent l’apprentissage “ sur le tas ” des
Portugais, qui n’ont pas suivi de cours de français et leur faible durée de
scolarité: la majorité n’a pas dépassé les 4 années d’école primaire.
96% des Portugais arrivés avant 16 ans savent lire et écrire le français et
62% savent lire et écrire le portugais.
Pratiques langagières
Dans la sphère domestique, 17% des parents arrivés en France après l’âge
de 15 ans font un usage exclusif du portugais avec leurs enfants, 26% un
usage exclusif du français et 57% un usage alterné des deux langues. Les
immigrés arrivés avant l’âge de 15 ans et scolarisés en France,
abandonnent la langue maternelle au profit du français. Quand un des
parents a été élevé en France l’usage de la langue maternelle chute
brutalement. Quand le couple parental est mixte (franco-portugais), les
échanges ont lieu quasi exclusivement en français.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%