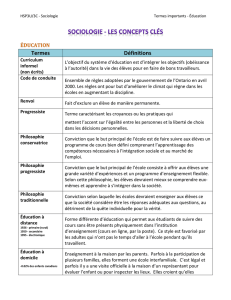Pierre Verstraeten, professeur de philosophie

Pierre Verstraeten, professeur de philosophie
C’était il y a un peu plus de 35 ans. Il y a longtemps. Je m’aventure dans le souvenir, avec ses
imprécisions, mais aussi sa vivacité, sans chercher à vérifier quoi que ce soit. Pierre
Verstraeten était avant tout un professeur de philosophie. Un professeur. Non un
enseignant-chercheur, comme on dit aujourd’hui, qui aurait pensé d’abord à publier et
aurait ensuite exposé le résultat de ses recherches à un public d’étudiants. Non. S’il
cherchait, c’était devant les étudiants, dans le rapport à eux, grâce à eux, et il écrivait peu.
L’oral était son mode d’expression.
Il y a 35 ans et quelque, donc, à l’Université Libre de Bruxelles. Je suis en première année,
en première candidature, disait-on alors, j’étudie le droit car mes parents en ont voulu ainsi.
Je voulais étudier le grec ancien, mais c’est là, à leur avis, une cause irrémédiablement
perdue. A cette époque, choc pétrolier oblige, nous sommes éduqués dans la peur du
chômage, il faut faire des études rentables : le droit en l’occurrence. Nous apprenons les
rudiments de la chose juridique et avons aussi des cours de culture générale, dont un cours
de philosophie, que nous partageons avec d’autres facultés.
L’auditoire Paul-Emile Janson (en belge, auditoire signifie amphi) est bondé. Presque dix
ans ont passé depuis mai 68, mais, quand un professeur fait son entrée, les étudiants font
encore mine de se lever. Certains membres du corps académique, à la faculté de droit,
continuent à considérer avec faveur cette révérencieuse convention, d’autres font un geste
de la main, restez assis, et tout se résout dans un brouhaha décroissant et d’inutiles
grincements du mobilier. Pierre Verstraeten ne laissait sûrement pas ses étudiants se lever
–il avait participé activement au mouvement de mai–, mais je n’ai plus d’image nette à ce
sujet. Par contre, je me rappelle l’entame, l’attaque d’un cours, peut-être du premier, une
phrase de Goethe, dont la littéralité s’est effacée de ma mémoire, et je m’interdis de tenter
de la retrouver en feuilletant Faust ou en exploitant les mille ressources du Web –in illo
tempore inconnu–, mais dont le sens perdure en moi : plus on possède, disait Goethe, plus
on est en danger. L’accumulation rend fragile, expose à la perte. Idée simple : presque une
évidence. Mais pas pour les étudiants de droit et de sciences économiques grandis dans la
hantise du chômage, encore moins pour ceux d’entre eux, et j’en étais, dont les parents
étaient bourgeois et aux yeux de qui la propriété, la prospérité, étaient des assurances
contre les noirs périls de l’époque.
Le ton était donné, l’insécurité avait fait irruption en même temps que la philosophie :
certains d’entre nous pressentaient qu’elles étaient intimement liées et, du coup, cette
« philosophie » devenait autre chose qu’un intitulé de cours parmi d’autres. Tout était
insécurisant, chez ce professeur. Ses phrases étaient longues, sinueuses, périlleuses,
acrobatiques, il ne cherchait pas du tout à être clair et se souciait comme d’une guigne de ce
que son public n’eût jamais fait de philosophie. Il boitait et marchait avec une canne. On
avait l’impression que son « discours » (ce mot était alors fort à la mode et il l’employait
sans modération), lui aussi, était une chute perpétuellement rattrapée, une claudicante
vitesse.

J’avais la nostalgie des langues mortes, j’ai découvert là un nouveau langage, j’ai voulu
l’apprendre. Il n’y avait pas de déclinaisons, de conjugaisons, de liste de verbes irréguliers,
mais les volutes d’une surprenante alchimie, qui mêlait Goethe, Hegel, Borges (ah ! « Les
ruines circulaires »…) et beaucoup d’autres. Finalement, à force de répétitions et de
discussions entre camarades, quelque chose surgissait : le sens. Exactement comme quand,
après un séjour plus ou moins long dans un pays dont on ignore l’idiome, on finit, par
accoutumance, à repérer des constances et à comprendre quelque chose de ce qui se dit.
« On parle dans sa propre langue, on écrit dans une langue étrangère », écrit Sartre. Pierre
Verstraeten, lui, en français, réussissait à parler une langue étrangère (et quand il écrivait,
c’était dans une langue plus étrangère encore). En fonction de la normativité qu’on
enseignait en droit, en économie, en psychologie, ou tout simplement du « train de la vie
ordinaire », ce refuge où l’on se met à l’abri du doute, dont parle Descartes à la fin de la
première Méditation, une grande partie du public du Janson avait tranché : les philosophes
sont fous. D’autres étaient mordus. Au fil des années, plusieurs, à cause de cet
enseignement, bifurquèrent vers la philosophie, ou firent un double cursus. Certains, même,
étaient devenus nos jeunes professeurs, comme Guy Haarscher.
La section de philo (ainsi l’appelait-on) était sise dans un vieux bâtiment biscornu, avenue
Adolphe Buyl. L’on y fumait à qui mieux mieux, étudiants et professeurs (Marc Richir le
cigare, Jean Paumen la pipe), et les escaliers de bois, les murs lambrissés, les parquets
jonchés de mégots ne suscitaient aucune inquiétude ni chez les occupants du lieu, ni chez
les autorités. Le philosophe à la canne, lui, ne fumait ni ne buvait : il lui fallait ascétiquement
garder ses neurones intacts pour les exercices de fildefériste du langage auxquels il se
livrait. Il occupait une sorte de mansarde aux murs surchargés de livres en désordre, tout
en haut, au quatrième étage je crois. Qu’il cavale dans les escaliers nous semblait tout
naturel –et à lui aussi. Il avait son système philosophique, qui était libertaire : Sartre était
son auteur, son levier, son révélateur. Parce que libertaire, ce système, tout systématique
qu’il fût, lui interdisait d’interdire. Cela rimait avec mai 68 et c’était aussi pour Pierre
Verstraeten une certaine manière de mettre en œuvre le principe de l’alma mater, le libre
examen. Il ne nous enfermait pas dans l’existentialisme, mais multipliait les horizons. Il
fallait faire de la philosophie dure : Hegel. Aux étudiants de droit, il avait fait ce cadeau
empoisonné : leur enseigner la Philosophie du droit du susnommé. Au bout de quelques
années de ce régime, on rapatria le professeur en section de philosophie : les étudiants de
droit étaient désormais sains et saufs, ceux de philo n’avaient que ce qu’ils méritaient et
désiraient. Nous désirions, oui, et, outre Sartre, Hegel et Descartes, en ces années fastes
pour la culture et dès lors pour nous, « chez Verstraeten », nous étudions Levi-Strauss,
L’Anti-Œdipe, Différence et Répétion, Logique du sens, Derrida (Glas : le rêve ! Sartre, Hegel,
Genet et Derrida réunis, et le tout, pour le coup, écrit « en langue étrangère »), Lacan et
même les premiers balbutiements de la « nouvelle philosophie », qu’il fallait bien considérer
puisqu’elle était nouvelle. Et la philosophie elle-même s’ouvrait à son dehors, à la
littérature, à la poésie, au cinéma.
Plus tard, j’ai découvert, étonnée et incrédule, qu’ailleurs, les « ismes » souvent régnaient,
qu’ « existentialisme » et « structuralisme » étaient considérés comme incompatibles et
qu’il était d’usage de choisir son camp. Nous sommes très nombreux à lui devoir une liberté
qui nous garda des enrôlements et des adhésions, et qui nous instilla la curiosité, au sens où

la définit Foucault : « non pas celle qui cherche à s’assimiler ce qu’il convient de connaître,
mais celle qui permet de se déprendre de soi-même ». Une ancienne condisciple, qui avait,
elle, poursuivi le droit, m’avait dit un jour qu’elle « pensait à Verstraeten » chaque fois
qu’elle entendait (c’était un tube en 1980) France Gall chanter « Il jouait du piano debout ».
Il jouait du piano debout/c’est peut-être un détail pour vous/mais pour moi ça veut dire
beaucoup/ça veut dire qu’il était libre… Elle ne connaissait pas la passion de « Verstraeten »
pour le jazz, mais elle avait tout compris.
Juliette Simont
1
/
3
100%










![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)